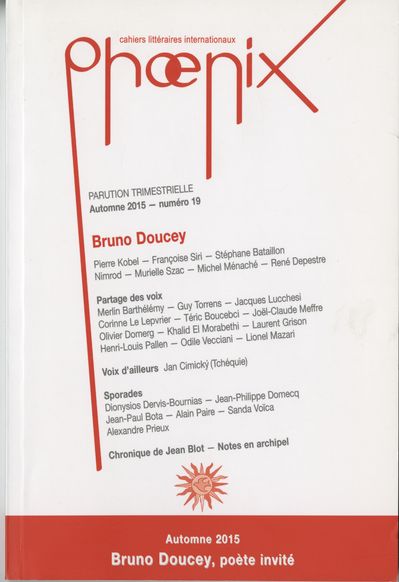
2015-2019
Pendant les dernières années de sa vie, Jean Blot collabore régulièrement à la revue « Phoenix » dont il est un des piliers.
Il donne à ces « Cahiers littéraires internationaux » des textes qui appartiennent à l’ensemble des registres pratiqués par lui depuis les années 50 : notes critiques bien sûr, mais aussi reportages et chroniques, en particulier au sein d’une rubrique qui met au pluriel le titre de l’un de ses propres ouvrages paru en 1979 : « Sporades ».
Chacune de ces interventions est une forme de « digression » à partir d’un ouvrage, mais aussi d’un paysage, voire d’un mot.
Au soir de sa vie, Jean Blot ne se livre pas à de vaines confidences, mais il écrit et égrène, au fil de ses chroniques, un récit en prose sur « l ‘épaisseur insensée de la vie », ouvrage annoncé en 2014 comme devant paraître, un jour, sous le titre « La Marquise sortit à cinq heures… ».
Il nous en a pour ainsi dire donné quelques « Bonnes feuilles » dans la revue PHOENIX, avant de nous quitter.
La Dénoyée
suivi de Troupes
de François BORDES
(Revue Nunc/Éditions de Corlevour)
Compassion et poésie font une sainte alliance. Sainte parce que leur source de même que leur finalité sont identiques, cette alliance paraît aussi naturelle. On est surpris de constater combien rares sont les vers que cette alliance inspire : les Frères humains de Villon, les Petites vieilles de Baudelaire, quelques autres. C’est sans doute que l’interlocuteur du poète n’est pas Autrui mais « un autre moi-même », non le Nous, mais le Moi dans son intimité. C’est cette difficulté que François Bordes a choisie pour séjour.
Poète et historien – de ceux qui cherchent non l’évocation mais la trace et ont accepté la mort du temps –, il avait déjà dans son livre sur Orwell proposé une « enfance » où la canne à pèche du publiciste rebelle, loin de s’opposer à son action politique, en dévoilait la source. Dans La Dénoyée, il va plus loin, plus profond dans la forme et par le sentiment. La poésie y est libre, n’obéit qu’à sa recherche d’un sentiment, à sa propre vibration, à ses nuages qui refusent l’événement pour s’égarer dans « Cent histoires de rien du tout ». Ce vagabondage prépare au surgissement terrible de l’État Civil qui veille férocement sur l’intégralité du passé dont la recherche, par sa complaisance, risque de compromettre. Bordes cite les Archives de l’Allier. Il est un art de la citation : celle-ci glace le sang au récit de Dunoyer Marie, femme de Nicolas, internée dans un asile et dont la folie entre nuages poétique et vérité d’ État Civil va hanter le lecteur et lui faire découvrir l’esthétique de la compassion : « Trop pour toi Marie / Ventres creux & crient-la-faim » – elle sera, non pas ressuscitée comme le rêvait le poète, mais « Dénoyée ».
Par Troupes, le poète rivalise avec l’État Civil dans la peinture au couteau du vrai. La hardiesse est dans la typographie qui coupe le souffle et dénonce ce tragique du Banal dont le Poète-historien est maître. Ainsi d’André qui illustre, loin des hussards de Géricault, la vie d’un simple – en temps de guerre. On retrouvera dans la mort d’un chat ou la crainte de l’échec, cette nouvelle tragédie neuve, loin des excès exubérants de Médée. Dans une prose qui devient vers en tombant goutte à goutte – et chacune a son poids –, le poète convoque dans Mauvaise Troupe, ces moments de conflit dans une relative absence de compassion : « Mais qu’est-ce qu’il a » et la volonté de « s’arrimer au monde » – « dans le vivier du présent et la fraîcheur de ses états » –. Il cherche à « dire juste entre la logique et l’errance ». Dans ce combat, on salue le poète pour son talent artistique et son engagement social, entre la momie du temps retrouvé et la dépouille des Archives. Le combat sera long, le temps d’une œuvre et même d’une vie. On peut faire confiance au Poète-historien qui, au-delà du chaos où il se débat, a su entendre « l’expérience du monde », savourer « son goût d’amour, de sel et de citron ».
Jean BLOT
27.02.2019
La Nef immobile
par Jean-Luc Giribone
Le rêve et sa logique ont joui longtemps d’un prestige prémonitoire. On les croyait prophètes. En accumulant les erreurs, ils ont fini par perdre cette réputation jusqu’au jour où la révolution freudienne leur rendit leur pouvoir et découvrit dans le fantasme les parcelles de la vérité que la réalité cherchait à cacher. Jean-Luc Giribone, normalien qui fut un proche de Lacan et dirigea au Seuil une collection de psychologie et de sciences humaines, ainsi que la collection Écrivains de toujours, appartient à ceux qui, philosophes et poètes, découvrent dans le monde onirique une parabole de l’Inconscient. Dans ses récits (Méditations carnavalesques, comme dans son essai sur le rire), Giribone explorait déjà et balisait ce champ clos où Psyché et Soma entrent en conflit ou s’unissent, ce monde du fantastique où la raison découvre ses raisons et Carnaval comprend que ses masques sont les vrais visages qui se cachaient en se révélant.
Quand le sens est en jeu, et, pour Giribone, c’est cette mise en jeu qui est le sens de son œuvre littéraire, quand la commedia dell’arte prétend au vrai – comment juger le succès et où chercher les règles de son expression. La réponse de Giribone est claire encore que non-dite : l’humour et la beauté. Avec la plus grande discrétion, l’écriture est d’une perfection qui affirme la supériorité de l’esthétique sur le réel. Être c’est être beau. L’esthétique, la qualité de l’écriture, font de l’imaginaire, en le libérant des chaînes du quotidien, un plus vrai que la réalité.
La Nef immobile ? Cet ensemble de récits est plein des mouvements qui mènent des sommets de la réflexion aux bas-fonds des catacombes. Mai la Nef n’appareille pas vers l’horizon et ne cherche de port qu’en elle-même ou/et « dans la profondeur fantastique du réel ». Le Palais du récit nous introduit dans cette aventure où les choses cherchent leur sens et se tiennent prêtes à l’emprunter au fantasme en transposant en pierres et matériaux, perspective et ameublement, la structure de tout récit, qu’il soit dicté par le songe ou par le quotidien. La ville idéale Atella, incarnation de la pulsion psychique qui crée le besoin du lieu, est bordée de rixes qui gardent la violence des scènes primitives qui ont effrayé l’enfance. La vie sociale se révèle aussi fluide dans son paradis que le ciel au-dessus de nos têtes et l’opinion se substitue à la réalité insaisissable. Jusqu’au profond des catacombes rouges où la mort se trompe de couleur, en passant par les collections où l’objet finit par tuer ce dont il devait entretenir le souvenir. « La présence globale du bruit narratif est entretenue. » par des accents dont la palpitation évoque la sous-conversation de Nathalie Sarraute.
La question de l’unité psychique ne change pas quel que soit le milieu où elle se pose. Elle révèle dans le dernier récit, qui porte le nom du recueil, son inspiration humaniste, les amis échouant dans leur effort et « le chant croisé des intonations ». La Nef reste en rade de la vie, les chants sont audibles, les voix sont belles. On nous conte la vie, la mort et cet espoir d’unité humaine que Carnaval sifflote dans les nuits chaudes de l’Italie, patrie seconde (ou première) de l’auteur. Les raisons pour lesquelles l’union avec le prochain est nécessaire pour accéder à une existence plénière, comme celles qui la font impossible, sont trop bien exposées par l’auteur dans son sourire et ses larmes, pour que je cherche à les résumer. Que le lecteur découvre une œuvre d’arrière-saison, plus jeune dans la hardiesse et la compassion que tout printemps.
Jean BLOT
9.12.2018
La canne à pêche de Georges Orwell
par François Bordes (revue Nunc Éditions de Corlevour)
L’enfance est un âge. L’enfance est un esprit et une sensibilité. Ils se forment au cours des premières années, mais leur influence s’étendra à la vie entière. Le grand mérite du poète-historien, François Bordes, est d’avoir compris comment un âge de l’homme pouvait avoir une indépendance idéologique et former un esprit qui métamorphose le réel en idées et celles-ci en images. Dans son livre, La canne à pêche de Georges Orwell, il démontre comment un publiciste engagé devient un poète fantastique et emprunte au fantastique la vérité du quotidien.
Les analyses d’Orwell des catastrophes communistes ne sont pas originales. En revanche, il a le don exceptionnel de donner formes et visages aux angoisses de la vie publique. Il a inventé la langue de bois, le double talk, qui vide les mots de leur sens, le Big Brother qui les manie pour asservir les petits frères et les mener consentants aux camps de concentration. C’est Orwell encore qui a su imposer l’image du totalitarisme triomphant dans sa fable de 1984 ou le portrait de ses dirigeants dans Animal Farm.
Bordes cite Bachelard : « Seul, l’enfant permanent peut rendre le monde fabuleux. » C’est le cas de Éric Blair qui, né au Bengale où son père est fonctionnaire britannique, il prendra pour pseudonyme le nom d’un fleuve anglais : Orwell. Condamné à la solitude ascétique des grandes écoles anglaises (Eton), il s’y trouve « comme un poisson rouge dans un aquarium de brochets ». Après un bref et malheureux passage dans l’enseignement, Orwell découvre son nom et sa vocation d’écrivain dans La dèche à Paris et à Londres. On y trouve déjà cette ardente sympathie pour les pauvres et mal chanceux qui devait le conduire en Espagne dans la guerre contre le fascisme. Il y assiste à la liquidation des anarchistes du POUM par les communistes, revient en Angleterre, retrouve sa passion pour la pêche et pour la solitude. À la lecture de Dickens et de son paupérisme, de Jonathan Swift et de sa satire, sa vocation se précise. Dans la revue Polemics, il devient un leader de l’anti-stalinisme de gauche. Il est ainsi conduit à réfléchir sur les relations de la politique et de la littérature pour aboutir à des chefs-d’œuvre du genre.
Il compte sur l’enfance et son esprit ludique pour ruiner les façades sociales. Le passé se révèle un allié dans 1984. Il est le gardien de l’enfance que Big Brother doit supprimer pour asseoir son règne. Bordes montre avec art comment « l’enfance permanente assure l’espoir de la société ». Le noyau de l’enfance « est au cœur de la révolte », écrit-il. « L’emploi du passé, la trace de l’espoir démontrent qu’un autre lieu existe. »
Par ses réflexions sur l’œuvre de Orwell, l’essai de François Bordes ouvre de singulières perspectives. Des concepts intimes sont traduits en sociologie, la biologie en politique, le conflit des âges en lutte des classes. L’esprit de l’âge n’est pas celui du temps. Rousseau voyait dans la société la corruption de l’homme. Bordes paraît accuser les années. L’entreprise révolutionnaire de Justice et de Paix trouve dans l’intemporalité un caractère trans-historique.
Souhaitons que le poète-historien sache l’explorer. On ne peut que saluer l’espoir d’une telle vocation et faire confiance à celui qui sait, comme il le révèle : qu’ « il faut écrire comme un bébé qui hurle ».
Jean BLOT
28.11.2018
Note de lecture de Jean BLOT
Qu’est-ce qu’un homme de vérité ?
par Jean-Luc GIRIBONE, Indigène Éditions
Hommes et vérités sont deux formidables concepts qui, lorsqu’on s’en approche, deviennent d’inextricables labyrinthes. Il les faudrait pourtant connaître puisque c’est sur eux que toute pensée s’appuie. Dans ce chef-d’œuvre de Dédale, Jean-Luc Giribone nous guide avec autant d’exigence dans la pensée que de bonheur dans l’expression.
Le chef-d’œuvre de Molière, Le Misanthrope, ouvre la réflexion et la mène à l’ambiguïté du personnage, champion de la vérité. Celle-ci le conduit à l’échec et au malheur. « Moi, je veux me fâcher… » déclare Alceste, exigeant que chaque mot prononcé vienne du cœur. Voilà qui paraît admirable, mais Giribone nous rappelle que toute vérité exprimée entre en société et ne peut s’y présenter, non pas masquée, mais correctement vêtue. L’échec d’Alceste tient à son refus de « la tragi-comédie de pouvoir » qui ne quitte jamais la scène du quotidien. La vérité, en conséquence, doit connaître et accepter les conditions sociales, la situation de l’interlocuteur, et se souvenir que « dire la vérité à qui ne veut l’entendre, c’est la défigurer ». Elle présente plusieurs visages, même en science où la lumière est tantôt onde et tantôt particule. Au vrai, il est un reste qui fait que « la pensée débouche sur son inachèvement » et que le principe de réalité de Freud doit être complété par les errements de l’observateur et les pseudo-réalités qu’ils engendrent. Giribone conclut superbement que « avoir raison ne dispense pas de comprendre celui qui a tort ».
Le célèbre linguiste Benveniste avait déjà attiré l’attention sur la distance qui sépare l’énoncé de l’énonciation. Pour Lacan, l’ascèse psychanalytique peut se résumer dans « le sujet vrai qui se révèle dans l’énonciation… trahit ou déforme l’énoncé », révélant par lapsus et silence un espace qui, loin du Je de l’action, dans les secrets inavoués, l’informe des pulsions, attend son cartographe. Selon Giribone, le zen serait un coup de sonde qui, par l’absurdité, secourrait le sommeil de Psyché.
Afin de faire monter le vrai sur la scène de la vie, Giribone ne craint pas de le conduire au théâtre : celui de Peter Brook ou de Grotowski et le faire entrer dans le jeu du faux qui prétend dire sa vérité au vrai. L’homme de vérité n’y change pas de nature, ni d’intention mais bien de méthode et de mode d’action. Grotowski se dit « artisan dans le champ des comportements humains en condition métaquotidienne », c’est-à-dire libérés de leur cause apparente et resitués dans l’altérité et l’intersubjectivité, leur source, domaine et garantie. Dans la gratuité du théâtre, elle peut se libérer de la doxa qui lui dicte vocabulaire, grammaire, mais aussi morale et finalité.
L’énonciation peut devenir son instrument. Par le style qu’elle impose à l’énoncé, elle le resitue en vérité. Giribone cite les styles de Mallarmé et de Lacan cherchant à donner à l’énonciation le style dicté par l’énoncé… poésie pour celui-là, psychologie analytique pour celui-ci. Giribone indique une autre voie qui est celle de la découverte. « La vérité, écrit-il, et la recherche de la vérité sont une seule et même chose ». Dans des pages inspirées, l’auteur nous propose une utopie où la découverte conduisant à la recherche, comme celle-ci l’avait fait pour celle-là, se confondrait à la vie même de l’esprit.
L’analyse de rigueur et de clarté souffre peut-être de ce mal moderne de la mise en abîme de toute observation, témoignage ou pensée – qui fait de l’observateur témoin et penseur une partie intégrante de leur œuvre ou discours, intégration assumée par un autre observateur qui, à son tour, devenant partie, doit être… à l’infini. Une chose est sûre : Giribone est l’un de ces hommes de vérité qu’il recherche, qui, comme le voulait Albert Camus, ne sont pas sûrs d’avoir raison. Son livre en est la défense et l’illustration.
Jean BLOT
08.11.2017
31.10.2017
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Trois Peintres
Une même angoisse
Ce sont trois noms qui diffèrent évidemment par l’origine : Derain, on ne peut plus français ; Giacometti, italien ; suisse-italien ; le troisième, Balthus, moins bien ancré, à l’image de celui qui l’a choisi, paraît à la fois médiéval, catholique, slave, onirique… Ce sont trois peintres dont la valeur est universellement reconnue. Cette reconnaissance semble le seul point commun de ces trois artistes opposés dans la vision, la touche, l’art même. Une amitié les a liés. Elle n’est pas exclusive, ni même privilégiée : ils ont eu d’autres amis ! C’est bien pourquoi l’exposition du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris s’annonce sous le signe de l’incohérence et du défi.
Le mérite des organisateurs est d’avoir su comprendre et montrer des œuvres réunies non par le goût du paradoxe mais bien par une intuition secrète, à peine consciente, mais hégémonique. Il n’est image qui ressemble moins à la pomme ombilique de l’univers, de Giacometti, posée au bord de son ombre, en archétype de la vie silencieuse qu’il illustre plus qu’il ne la découvre – que le nu de Derain, qui rêve du Titien et se voudrait la révélation d’un formalisme idéal – que l’admirable Fenêtre cour de Rohan de Balthus, loin de toute pomme, de toute neurasthénie d’un classicisme plastique, accueillant une sexualité partout présente, obsessionnelle, mais pour une fois, nulle part représentée. Pourtant, pour peu que le regard se détourne de l’évidence, il découvre une hantise commune, une même angoisse chez les trois peintres.
Le temps, la génération ou le tempérament a voulu que ces trois talents soient bénis et affligés par la même double vue : artistique mais aussi critique ; la pomme mais aussi tout ce qu’elle signifie comme meuble du monde, la fenêtre mais surtout l’inconscient des désirs indomptés sur lesquels, dans un silence initiatique, elle s’ouvre ; la femme nue mais drapée ou effacée, dans tout ce que l’on sait de la sexualité devenue aussi éloquente pour la conscience que la cuisse l’est au regard. De même, le bouleversant L’homme qui chavire de Giacometti représente la détresse humaine de telle sorte que, loin d’être démentie par la mort de Dieu, elle en sort épurée et grandie.
Par la compréhension remarquable des trois peintres, de leurs œuvres, de la vision qui les réunit au-delà de toutes les différences existentielles ou artistiques, de l’angoisse qui les habite, l’exposition a su montrer, faire voir, expliquer l’angoisse de l’art s’évanouissant dans la joie démiurgique de Picasso, les subtilités de Matisse, l’anarchie vengeresse de Soutine. L’art avait découvert son sens. Le sens était là, évident, lisible, mais où donc était l’art ? On le cherche depuis, mais jamais avec plus de talent dans l’exposé, de sincérité dans l’expression, d’éloquence dans les moyens que Derain, Balthus, Giacometti – comme le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris vient nous l’enseigner.
Jean BLOT
24.07.2017
Peinture et Paganisme
Naguère, Tito régnait encore. Le Grand Palais accueillait une exposition de la peinture yougoslave des XIX et XXe siècles. Les tableaux reflétaient la richesse en couleurs, presque orientale, des peintres yougoslaves – et une fougueuse imagination dans la perspective et le trait comme dans la hardiesse d’invention. L’intérêt pour moi était ailleurs, ailleurs les questions que je me posais et pour lesquelles je cherche depuis ces années lointaines une réponse. La peinture exposée se divisait en Serbes et Croates sans la moindre hésitations sur leurs origines. Ce n’était pas villages, maisons, églises qui étaient différents mais toute chose représentée et chaque coup de pinceau. Deux visions du monde, également authentiques, s’opposaient avec une égale vigueur – s’affrontant et n’empruntant rien l’une à l’autre. Or, il s’agissait d’un même monde slave que l’histoire avait divisé puis réuni dans les grandes expériences du siècle, guerres et révolutions. Surtout, la langue est formatrice de la sensibilité et de la vision d’un peuple ; ces artistes parlaient le même serbo-croate, avec le même vocabulaire, la même syntaxe, traduisant et baptisant par les mêmes mots empruntés aux mêmes traditions et valeurs la réalité. Leurs hommes se ressemblaient physiquement et par le caractère. Ils vivaient côte à côte dans les mêmes paysages aux mêmes variations et excès. Ils étaient les uns chez les autres sans ressentir d’étrangeté, étant chez eux ici et là. Une seule force les séparait : la religion.
Les Serbes sont orthodoxes, catholiques les Croates. Les religions imposent-elles leur vision du monde aux frères et voisins ? Les rend-elle étrangers dans les formes, couleurs, dans chaque détail matériel, dans toute la gamme de la sensibilité qu’elle forme, structure pour s’opposer à des religions rivales.
L’exposition du Grand Palais mettait en valeur cette puissance de la religion. Elle rappelait la Réforme qui, brisant l’unité européenne, avait, en quelques décennies, construit une vision qui s’opposait à celle du catholicisme, non dans le dogme ou le rite, mais bien dans la perception du monde matériel et humain. Peu de communautés sont aussi proches l’une de l’autre que Flamands et Hollandais. Peu de peintres sont aussi loin de l’autre que Rembrandt et Rubens. Ces deux génies occupent des pôles opposés de la sensibilité, où les réalités, humaine et matérielle, sont si différentes que, en les découvrant on les dirait contradictoires. En fait, complémentaires, elles viennent illustrer la richesse du monde, de ses réflexions et représentations.
L’exposition du Grand Palais posait une autre question encore. Rembrandt et Rubens appartenaient à une époque où la foi était le pain quotidien de la vie intérieure de chacun. Sans enfreindre ou diminuer l’originalité de leurs génies, elle les orientait différemment. Elle les guidait de telle sorte que leurs visions du monde, de la crucifixion ou des petits chiens, des vieillards ou des femmes nues devenaient si différentes qu’elles paraissaient venues de mondes indépendants. Pas de place pour Rubens dans l’univers de Rembrandt, ni pour Rembrandt dans celui de Rubens.
La Yougoslavie, au contraire, vivait depuis un demi-siècle dans une idéologie qui, bien qu’opposée à la religion par nature et par choix et rôle, partageait son ambition de conquête des esprits et consciences. Or, l’exposition du Grand Palais témoignait de son échec. La religion atteignait l’homme à des niveaux où le Parti n’avait pas accès et préservait entre Serbe orthodoxe et Croate catholique une même différence de vision qui les séparait avant que le Marxisme ne transforme ces frères en camarades.
Cette expérience, ses conclusions me revinrent à l’esprit à Naples et Pompéi, devant les images que je découvrais, drapées dans leur énigme. Si l’art plastique était orienté par la religion dans sa vision, ses œuvres devaient permettre de comprendre l’esprit et la foi qui les dictaient. Si la religion commandait l’œuvre, si celle-ci l’exprimait, on devait y retrouver et lire, dans la religion qui la guidait, non plus dans l’abstraction du dogme ou la fantasmagorie du mythe, mais dans la vérité concrète de l’art manifestant, en lui donnant forme, couleur et sens, la Psyché humaine. On pouvait retrouver le paganisme, son interprétation de la vie, ses leçons, dans son art.
Le paganisme pose des questions liminaires : comment expliquer la foi de ses fidèles en les charmantes absurdités de ses Dieux ? Comment, face à la mort, Socrate peut-il affirmer croire en les dieux de la Cité ? Que signifie le Dieu dans les dialogues de Platon et les autres œuvres philosophiques et littéraires, ce Dieu de l’Antiquité entre « Dieu » et « les dieux », entre majuscule et minuscule, singulier et pluriel ? Comment croire qu’un esprit aussi cultivé et aigu que celui de Cicéron puisse accepter les polissonneries des amours de Vénus et de Marss non comme une belle image des relations de la guerre et de l’Amour, comme une expression rustique de l’ambiguïté, entre haine et Amour, de la violence – mais bien comme article de foi ? Comment est composée une mentalité vivant cette contradiction ?
Le paganisme fut religion d’État, c’est-à-dire obligatoire pour tous les citoyens, religion d’un empire quasi universel, dont les pensées les plus hardies et les plus neuves devaient se présenter comme explication ou commentaire de sa puissance, mais jamais comme négation ou objection. Si, au cours du millénaire chrétien, l’Olympe gréco-romain ne représentait guère plus qu’une curiosité pour l’esprit, il devait être redécouvert par les deux derniers siècles comme le moyen de se libérer du mensonge millénaire de la théocratie, ennemie de la liberté et du progrès, de la raison, en rival malhonnête de l’on ne sait quel Instinct !
Ici, on se heurte au concept de Nature. Elle est les choses telles qu’elles sont avant l’intervention de l’homme, de ses sociétés, et de la Raison. Cette antériorité, ni hostile à l’entreprise humaine, ni son alliée – est neutre. L’idée que l’Instinct naturel est meilleur que la charité humaine, plus juste que la Justice, plus intelligent que la Raison, est sottise, digne, pour citer Voltaire, d’aller à quatre pattes et brouter l’herbe du chemin. Il lui fallait le génie de Rousseau pour être prise au sérieux. Elle gardait (venue d’où ? On ne sait) son bon cœur. Il fallut l’obscurantisme nazie pour découvrir la Nature : faite de griffes et de crocs et douée d’un instinct dont la reproduction et la survie sont, bien que d’une aveuglante sincérité, on en conviendra, l’unique et obsédante préoccupation.
Tout autre le trésor, conservé en Campanie. La Nature n’y est plus idéal, mais origine. Le chemin est le même, la direction opposée. Si l’on renonce ici à la Raison, c’est dans l’espoir d’une vérité qui viendra la compléter. Si l’on renonce au bonheur de l’harmonie, au savoir de la sagesse, c’est qu’ils n’ont pas su répondre et éteindre l’angoisse d’exister et qu’il faut revenir à ces lieux où la conscience s’éveille, se sépare de la Nature pour la connaître et la refléter, où l’on refuse les commandements de l’instinct pour retrouver l’espoir et étouffer la voix qui énonce avec une monotonie dissimulant mal le plaisir que l’on prend à l’amertume – les échecs.
Il est une folie qu’il faut écouter, qui, loin de conduire à l’hystérie, propose le retour au silence comme première vérité et pour réponse à cette angoisse de l’inachèvement qui fait l’humanité de l’homme. On perçoit comme le grondement d’un volcan : n’est-ce pas une pré-matière qui bout, entendue dans ce premier mouvement, la transformant en l’argile de toute matérialité ? Le Vésuve couvant l’horizon, endormi mais prêt à tout détruire comme il sut le montrer il y a vingt siècles, quand Rome régnait et que ses peintres s’interrogeaient, cherchant le vent de l’espoir qui refusait de se lever sur la Pax romana.
Le nom n’est pas un masque mais il peut le devenir. Il baptise en ce sens qu’il prête et bientôt impose une identité, son dessin et ses limites. Il ne reste plus au peintre qu’à l’illustrer mais, dans son travail, il retrouve ce que l’on peut nommer l’intimité de la chose, alors qu’elle n’existait encore que par elle-même, pour elle-même, avant que le baptême ne l’introduise parmi les hommes et dans leur vocabulaire, quittant pour cette promotion la ronde étourdissante de ce qui est… Encore faut-il baptiser ou identifier exactement.
Tel n’est pas le cas du paganisme, le Verbe lui ayant prêté une sensualité triomphante et réduisant la spiritualité au rôle ingrat de miroir déformant. L’intimité du paganisme s’est réfugiée dans l’art plastique et les masques qu’il lui proposait. Ils révélaient une révolte de la vitalité entre les prisons et les pièges du Surmoi ou de l’idéal, leurs exigences abusives qui finissaient par l’étrangler. Mais la révolte que le paganisme entend, écoute, n’est pas simple et il ne suffit pas d’un maillot de bain pour la conduire au triomphe, ni d’un bronzage excessif pour lui donner la parole et l’expression.
Il convient d’écouter le regard que la conscience païenne pose sur le monde et de le regarder, de chercher à le comprendre avant qu’il ne soit endoctriné. Alors on découvre que cet art est dominé par la solitude qui devient vertigineuse dans la sculpture : l’œuvre s’impose dans le vide pour devenir l’unique propriétaire de l’espace qui l’entoure.
Que regardent-ils ? Car, d’Éros en Dionysos, pêcheurs, maçons, capitaine, tous fixent le même regard sur l’Inconnu, derrière et un peu au-dessus de l’épaule du spectateur. Que voient-ils au-delà du visible et qui les fascine ? La fixité du regard, son identité dans tout l’univers des mosaïques, transcende les siècles autant pour la création des œuvres que pour leur signification. Car ils voient tous quelque chose et ce quelque chose les fascine, et c’est la même chose, située dans le même au-delà si immédiatement, si évidemment, si essentiellement visible et que l’on ne saurait apercevoir pourtant. Comment se retourner vers cela qu’ils voient tous si bien, si évidemment identique, si évidemment introuvable dans l’espace mais situé juste au-delà ? Comme si c’était le signe d’un Ailleurs de métamorphoses. Toute diversité lui est attribuable, combien même la distance serait aussi grande qu’entre chenille et papillon. C’est pourquoi l’intensité de ce regard du paganisme est à la limite de la terreur mais encore dans le calme, comme la chenille découvrant le papillon.
Le changement est d’évidence, mais il est de pure forme et, de ce fait, il interdit l’espérance d’une véritable altérité ou libération, qu’elle soit collective ou privée. En quel papillon, la chenille du monde sera-t-elle métamorphosée ? Le paganisme le découvre peut-être, mais il ne peut trouver le moyen d’apprivoiser cette non-espérance. S’il est un autre monde, il est comme l’auréole de celui-ci dont on entrevoit la forme mais qui, étant de même nature, ne promet rien, étant seulement répétition de métamorphoses.
On empruntera aux feuilles et aux plantes en un rappel désordonné de ce qui nous entoure mais ne compte que pour exprimer largeur et longueur et – par trompe-l’œil – profondeur. Au centre, ce poisson du musée du Bardo à Tunis, le plus étonnant poisson ! Serait-ce un dauphin ? Il a plongé jusqu’à mi-corps dans la mer opaque, mais la moitié postérieure de son corps, sa queue puissante et frémissante, argentée par la lumière, présente par l’énergie du corps cherchant la protection de l’abîme, de l’invisible, vibre avec une ardeur insensée. Il m’a semblé apercevoir, dans cette demi-apparition cherchant la disparition, quelque chose de la vision du paganisme. Plus admirable encore, à Naples, le plongeur de Paestum, découvert récemment. Il est à l’arrivée, attendant le plongeur, un arbre rabougri dont on devine la soif, des échaudages ambigus dont on admire l’abandon et qui sont, en diverses mosaïques, sans rôle ni sens, ébauche d’un projet ou d’un rêve abandonné, que l’on ne parvient pas à formuler mais autour duquel l’esprit ne cesse de tourner comme phalène autour d’une lumière…
Ce sont indications qui désignent le vide s’ouvrant autour du corps du plongeur, et l’appelant au bout du saut dans une sérénité plus qu’humaine, impénétrable à l’esprit comme aux sens. On croit entendre le rien et son chant de sirène ! C’est à eux que le plongeur s’est abandonné, s’est confié, en pleine vigueur, illuminé de santé pour ce saut dans l’en-deçà, ni enfer, ni ciel, ni mort, ni vie, un Ailleurs absolu qui impose un silence plus dur, plus étanche que le marbre et toute matière.
La nature s’est enfuie : l’arbre rabougri en évoque seulement le souvenir ou la possibilité qu’elle soit celle à majuscule, illustrant le Cosmos et ses lois, celle à minuscule des campagnes et pâturages de Virgile ou de la vie quotidienne dans son humilité. De mosaïque en mosaïque, on dirait que l’artiste cherche à représenter cet Ailleurs sur lequel les yeux grand ouverts des personnages sont fixés.
Il en est de même des figures de Pompéi, dans la Villa des Mystères où ils dévoilent leur secret. Elles sont issues d’une interprétation de la sexualité très différente de celle que le siècle dernier et Freud, en particulier, nous ont légué. Ce n’est pas le sexe du désir mais celui de l’origine que l’on cherche ici à comprendre et représenter. Il conduit à un immémorial, au-delà de la naissance mais dont on garde une réminiscence qui, en nous expliquant de quoi nous sommes faits, devrait répondre à la grande angoisse de la vie telle que Psyché l’a articulée. La femme en est l’héroïne. Ses reins, non le cerveau, en garde le secret. Il grimace dans la douleur et dans le sang. Et chacun, en regrettant le paradis qui l’abritait et le formait, se souvient de la déchirure, de la blessure du sang. Et c’est pourquoi la solitude irrémédiable qui, de mosaïque en mosaïque, sous le pied du visiteur qui l’écrase, l’interroge et cherche une issue.
Isolement, solitude : ce satyre danse – seul, une coupe à la main. Aucun décor ne l’accueille, aucun ne l’explique. La magie du corps humain, capable de se libérer pour imposer à l’amorphe la grâce du geste – reste inviolée. Cette femme assise, son enfant à ses pieds, et l’on croit entendre au loin le gloussement douloureux des colombes, prend la pose qui convient à l’en-deçà du temps, avant qu’il ne se jette dans la course folle qui porte son nom, avant que ne s’ouvrent la tragédie de la naissance et le vide qu’elle dévoile au regard fasciné de l’enfant. S’il est une colonne, c’est pour rappeler que sa géométrie reste seule au monde, dont tout sentiment, échevelé, a fui. Son créateur – j’entends l’artiste – hante encore cette femme, son esclave, esclave sans maître – appartient-elle au corps muet ou à l’esprit exilé de la matière ? Elle est là, son enfant à ses pieds, à attendre la fin qui se refuse, de siècle en siècle.
Seul sur terre, mais seul de son espèce et interrogeant en vain l’absence où il baigne, tel apparaît le héros païen. Il guette – l’œil écoute, disait Claudel – quelque signe divin qui lui servirait de guide ou de modèle. Rien surgit. Rien fait attendre la réponse – mais n’en fait pas douter. Jamais l’attendre ne fut plus absent. Jamais derrière le Rien, en-deçà du monde, sa présence ne fut plus sensible. Serait-ce le spectateur qui répondrait à ce regard des mosaïques ? La matrone dont les yeux croisent quelque chose voit un miroir et son reflet, et rend au regard son interrogation. On attend : le paganisme a exploré l’origine. Il attend le sens et se résigne, les yeux grand ouverts, à un refus.
On ne saurait le quitter cependant, sans évoquer ou chercher à surprendre et rejoindre cette jeune fille qui se détourne, s’en va – chargée de fleurs et, fleur parmi les fleurs, sans se hâter, sans tarder, mais avec une certitude gracieuse comme sa silhouette – vers le mystère promis. Elle se nomme Primavera, pour annoncer un printemps qui, mieux qu’une saison dans un cortège annuel, est l’espérance. Au-delà de la conscience, par l’impatience des feuilles, l’évidence des corolles, le ballet impatient des tiges du bouquet qu’elle tient, cherchant le sens attendu – elle saura faire vibrer le silence de cette grande attente qui est le moment du paganisme dans l’histoire. La saison n’est que le rappel, la manifestation d’un idéal qui, Primavera, s’incarne en elle sans dénoncer le secret d’une omniscience tranquille. Elle refuse l’au-delà et préfère à ses palais les chaumières endormies au soleil, les fleurs des champs, la fille qui se détourne et que le Cosmos, pour apprendre le sourire, attend. A-t’on remarqué que le paganisme romain ne sourit pas ? Sur les milliers de bustes de ses citoyens que la Ville nous a laissés, admirables par la finesse psychologique dans sa diversité, il est absent. Même à Athènes, il s’éteint vite. La Primavera le promet. Le paganisme attend. Cette attente est le rôle que lui a réservé l’histoire de la sensibilité.
Cependant :
C’est ici qu’est la rose,
C’est ici qu’il faut danser
rappelle le sage Horace. L’œuvre plastique du paganisme – sans compromettre l’attente, sans renier l’angoisse élémentaire – l’aura entendu.
Jean BLOT
3.07.2017
Chronique de Jean Blot en promenade avec Jacques Damade
ou
Plus perdu que les îles de Paris, le sang de Chicago
Nos aînés aimaient classer les sensibilités littéraires par le nom de leurs héros. Par exemple, Hemingway et sa tendance romanesque illustraient « l’homme auquel les choses arrivent ». Je veux chercher et espère trouver un porte-nom – « le promeneur » – pour une œuvre mystérieuse, celle de Jacques Damade, où se croisent Les îles disparues de Paris* que l’on aimerait retrouver et les Abattoirs de Chicago* dont on ne peut, malgré tous les efforts, se libérer. Je dirais que c’est le style de celui qui n’accepte la réalité que pour la mieux refuser. Trop grand seigneur pour s’épouvanter du modernisme, Jacques Damade, avec discrétion et courtoisie, vit d’abord, montre ensuite le scandale de la modernité.
L’imagination ne saurait nous protéger. N’accepter le réel que pour le mieux refuser. Par là, il écarte la corruption romantique et le bovarysme de l’âme. Les îles dont Jacques Damade s’entoure, qu’elles soient perdues dans les eaux du temps ou dans les vagues de l’imaginaire, sont comme des sentinelles qui veillent aux frontières de la sensibilité qu’il défend.
Le promeneur est un homme singulier qui impose le rythme de sa promenade aux choses, mais aussi à leur histoire, qu’elle soit contée par la Nature ou par les idées. En ces temps enthousiastes où tout va si vite, l’espace, du Pôle Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, le promeneur bousculé est devenu rare. Il n’en est que plus précieux. Du même pas égal, sur le même rythme discret mais autoritaire, Jacques Damade nous mène aux îles disparues de Paris et au remords des abattoirs de Chicago. Étant homme de curiosité, le promeneur s’attarde volontiers là où d’autres éprouveraient un vertige. Telles sont ces îles de Paris qui, au cours du temps, sont et ne sont pas, par la volonté des eaux ou celle de l’administration. L’histoire prend un tour singulier quand, telle la Seine, elle peut revenir ou redevenir terre ferme au lieu de se noyer. Ainsi se trouveraient légitimés maints moments de l’histoire qui paraissent n’obéir qu’aux caprices du temps ; d’autres seront libérés de leur fardeau de sens qui les déformait. Ils seront accompagnés par la lecture du promeneur qu’il chérit selon la nécessité de la promenade et remis à son temps de description, d’exactitude, de dessin plus semblable à une cartographie qu’à une encyclopédie.
Ne dirait-on pas une « Enquête », comme celle de notre père à tous, Hérodote, mais pourquoi conduit-elle alors des îles capricieuses jusqu’à l’enfer des flots de sang de Chicago. Il faut souligner qu’il s’agit de la même promenade. Avec le détachement qu’il manie en virtuose, avec ce calme qui est le génie du promeneur, Jacques Damade nous met devant l’Inacceptable : on ne peut être homme ou espérer le devenir, nourri par un tel carnage, tant de souffrances, au fondement de la réalité.
Que faire ? Le promeneur n’a pas à conclure. Le lecteur, en revanche, garde cependant le souvenir de milliards de cigarettes qui se sont éteintes sous nous yeux pour ne plus se rallumer. L’humanité ne peut assumer la cruauté des abattoirs et se vouloir humaine. Elle ne peut renoncer à soi. Dans quelques millénaires, elle parviendra peut-être à se libérer de ce péché originel. Le promeneur nous a déjà quittés pour une autre promenade dont on attendra la leçon là où morale et réalité deviennent inséparables, faits de même substance.
Dans sa rêverie attentive à une musique du temps, où il écoute les îles paraître, se transformer, réapparaître, disparaître, il est une harmonie. Elle accompagne ou guide vers une sensibilité originale qui est celle de l’auteur et s’empare du lecteur.
Cette temporalité naturelle, trans-historique que Jacques Damade recherche, cette trans-historicité à pas comptés, est féconde. Une belle et noble distraction morale guide le promeneur et lui enseigne la promenade. S’il s’arrête pour juger ou même soupirer un peu trop longtemps, le cours en sera interrompu, et les jours, au lieu de glisser de forme en forme, d’île en archipel, de Paris jusqu’aux mers ouvertes et rêveuses, dans leur quête d’identité, viendront briser en conflits violents une unité à peine douloureuse, qui les séparait du soir ou de la nuit des temps.
Promenade n’est pas errance. Jacques Damade sait d’où il vient et où il va. Il ne nomme pas par respect ce mouvement général de sensibilité qu’il inaugure. Cette morale historique qui préserve les îles de Paris ou d’ailleurs dans leur présence autant que dans leur fuite qui dit à chaque chose, tu es présente dans l’absence, absente dans le présent, nous conduit aux abattoirs de Chicago !
Jacques Damade impose la tyrannie sanglante des abattoirs de Chicago pour interdire l’onirisme et l’ironie qui s’offrent à lui. Le monstre de Chicago avec ses tonnes de sang et ses milliers de cadavres, tous expirant dans l’incompréhension de l’absurdité et de la cruauté du destin.
Il ne s’agit pas d’absurdité, mais bien de nature ; car l’homme n’est pas carnivore par hasard ou par goût, mais bien par la loi de l’espèce, c’est-à-dire le contraire même de l’absurde.
Il s’agit d’un combat contre une animalité de nature de l’homme, ses exigences et ses lois qui, dans la glace de son silence courtois, est plus véhémente que tout cri.
C’est aussi pourquoi la prose de Jacques Damade préserve une distance dans le domaine où elle s’aventure, et la sensibilité de l’homme qu’il nous invite à comprendre et à partager, a cette distinction stoïque qui fait son originalité et retient son lecteur. C’est parce que le monde est à la fois habité et inhabitable que la sensibilité doit se mobiliser pour surmonter quelque chose qui n’est pas absurde, mais bien contradictoire.
Jean BLOT
24.12.2016
Le bestiaire de François KASBI
Les vieillards sémillants et ceux qui ne le sont pas s’inquiètent également du sort de la littérature française dans cette époque numérique. S’ils sont écrivains, ils doivent bien s’apercevoir qu’on ne les lit plus, mais que lit-on ? Les livres ont disparu du métro et de l’autobus, des cafés comme des restaurants. Cette crise de la lecture aurait-elle emportée avec elle les vertus et les curiosités fondamentales que la littérature apportait à la vie de l’esprit ?
À peine découvert ce très jeune et sémillant François Kasbi, que ces inquiétudes s’apaisent. Il suffit de lire son livre* pour s’en assurer. À peine ouvert que le problème des générations disparaît. Nous voilà en pleine littérature dont le discours ne s’interrompt pas. Les goûts du critique veulent surprendre mais il y a, derrière lui, un écrivain en gestation. On comprend son émotion devant la passion de l’absolu géré par l’arlequin du Kremlin et de Montparnasse. Dans Aragon, il est un secret à peu près inviolable dans les relations de la morale et de l’écriture (la semaine sainte, le roman inachevé… ou le crève-cœur). Si Claudel reproche aux surréalistes d’être des imbéciles qui veulent se faire passer pour des fous, on pourrait insinuer avec toute la délicatesse protocolaire qu’il est des fous qui veulent se faire passer pour des imbéciles. C’est oublier l’essentiel : connaissance de l’Est, la pluie en Chine, l’empire du dragon et le tremblement de terre retrouvé dans le tremblement des lèvres de la Geisha. C’est une sorte d’absolu littéraire vers lequel chacune de nos plumes aimerait s’élever. François Kasbi, malgré cette colère de jeunesse, son goût de critique rageuse qui ramène Paul Valéry à l’agence Havas, le sait.
C’est bien pourquoi on garde à la lecture de son livre le double espoir d’une vitalité rageuse et celui de l’harmonie poétique. C’est leur combinaison qui a fait le mystère de la littérature française auquel il ne tardera pas à participer dès qu’on aura fini de lire les titres de son essai* :
supplément inactuel
avec codicille intempestif
au bréviaire capricieux
de littérature contemporaine
pour lecteurs
déconcertés,
désorientés,
désemparés
Jean BLOT
12.12.2016
La mort de Socrate
L’homme est mortel. Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Il n’est pas inutile de rappeler ce syllogisme exemplaire dont la logique a la rigueur du couperet. Sa vérité habite Psyché et, consciemment ou non, elle ne l’oublie jamais. On peut imaginer ce que serait l’homme, si, contre toute attente, le projet d’immortalité, qui a mobilisé l’humanité depuis son origine, devait se réaliser : libéré de la mortalité, il serait méconnaissable. Jusqu’à ce jour, improbable, qu’il soit citoyen de l’histoire, héros de la tragédie ou bouffon de la comédie, ses conduites, ses pensées, toutes ses manifestations seront marquées par la conscience diffuse, mais omniprésente, de sa mort.
L’Égypte, on s’en souvient, l’avait élue, telle une finalité vers laquelle actes et pensées devaient tendre ─ comme le montrent sculptures et monuments. Ils ne sont pas élevés ou dressés pour garder en éveil la mémoire des vivants, mais bien pour accompagner, assister et loger la mort dans le royaume auquel ils ont accédé ─ de l’autre côté du Nil, à l’occident, où le soleil se couche. Les morts seuls y résident et ne se souviennent de la vie que pour quémander auprès de son citoyen de quoi conforter leur séjour ─ telles ces stèles ─ il ne faut jamais oublier de rire un peu ─ qui réclament du passant des quantités impressionnantes de bière. Le Grec, au contraire, garde à la mort son mystère, mais refuse de lui accorder des pouvoirs ou un intérêt transcendants. On retrouve là l’étrange schizophrénie qui l’accompagne et l’Hellénisme à s’exprimer tantôt par la fable, tantôt par la philosophie. Du côté de la fable, on trouve les Champs-Élysées et Achille qui, dans l’Odyssée, se plaint amèrement à son visiteur, Ulysse : il préférerait être le dernier des vivants plutôt que le premier des morts. On salue volontiers cette santé morale, mais la philosophie tient un propos différent. On le trouvera exposé dans l’Apologie de Socrate et les dialogues de Platon dont on veut croire que, jeune penseur ─ il avait vingt-sept ans ─, il eût le privilège d’assister au procès et à la mort de Socrate.
Athènes, 399 avant notre ère ! La métropole a changé. Elle a connu les désastres, la défaite aux mains de Sparte, la dictature des trente que Sparte lui a imposée. L’angoisse l’habite. N’étant plus sûre d’elle-même, elle doute de tout et de chacun. Elle se méfie en particulier de ceux qui, en lui proposant réformes et progrès, la déstabilisent et peuvent la conduire à sa perte ─ tel Socrate qui fait profession d’apporter le trouble dans les esprits, de saper leurs convictions, ruiner la confiance et semer le doute. 399 avant notre ère : un matin sans doute, mais le soleil déjà menace la journée. On se presse dans l’Agora et les ruelles : tout Athènes est là, entre ombre et lumière, aussi violemment contrastées que les gestes et vociférations ─ ou les passions qui les motivent. On va juger Socrate ! Un jury de cinq cent un jurés a été désigné. Trois citoyens l’accusent : Mélétos, Lycon, Anytos. On dit des deux premiers qu’ils supportent mal les critiques adressées par Socrate à leur poésie ─ et du troisième qu’il en veut au maître d’avoir détourné son fils de ses études commerciales et l’avoir convaincu de se consacrer à la philosophie. Les accusations sont autrement graves : Socrate est accusé de corrompre la jeunesse et de la détourner des dieux et des traditions de la Cité, auxquels il ne croit plus.
-399 ! Á Athènes, tout le monde connaît Socrate, par ouï-dire : beaucoup l’ont croisé, vu, observé dans les ruelles sombres, les places ardentes ; nombreux ont été interpellé et questionné par lui. Ils gardent de l’expérience un souvenir trop vif, proche d’un vertige, où ils ne reconnaissent plus leurs propres sentiments, croyances, et même les réponses que le maître, par ses questions, leur arrachait. Ils en gardent une angoisse et le désir, presque un besoin, de retrouver le tumulte de la vie intérieure que provoquait le questionnement socratique. Ici, on vénère le maître. Plus loin, on s’en méfie. On s’en moque. On cite Aristophane et Les Nuées qui dénonçaient ses prétentions. Ailleurs, on déteste ce vieux bonhomme chauve, malpropre, sentant l’ail, la sueur et qui se prend pour un dieu. Est-il l’ennemi du peuple ou son meilleur ami ? Au-dessus de cette fièvre bruyante, aussi serein et dur que le ciel immaculé où il règne, le Parthénon publie en silence les noces de l’esprit et du marbre dont il est l’enfant.
Le procès de Socrate, son verdict de mort sont parmi les crimes les plus honteux du genre humain. Rien ne peut les justifier, les expliquer ou même atténuer la honte que l’on doit en ressentir. Les circonstances qu’entourent le crime n’en sont que plus intéressantes et exemplaires. On se souviendra qu’Alcibiade ─ héros ou traître à l’occasion, adoré, haï ─ avait été l’élève favori et le giton de Socrate. Parmi les Trente qui avaient tyrannisés Athènes, se trouvaient les élèves du maître. Plus profondément, il y avait, dans l’enseignement et la personnalité de Socrate, comme une menace pour la Cité ou pour ses conventions. On a rappelé la schizophrénie dont faisait preuve l’Hellénisme conciliant la Fable la plus libre à la Raison la plus mûre. Elle répondait autant à une tendance ou besoin naturel, qu’à une nécessité collective, issue des craintes relatives à l’unité idéologique et culturelle de la Cité. L’évolution historique ─ paix, richesses, sécurité relative ─ avait précipité un schisme grandissant entre le peuple et l’élite. Celle-ci, mobilisée par la pensée nouvelle, brûlait de l’approfondir et de la libérer de toutes les entraves, traditions et croyances qui entravaient sa liberté. Les problèmes de l’identité et de la cohésion de la Cité lui paraissaient résolus par la Raison. Il en allait autrement du peuple qui ressentait instinctivement la fragilité de la Cité et n’avait pas reconnu, ou n’accordait pas sa confiance aux constructions rationnelles qui conciliaient le Moi privé et le Moi collectif. De plus, on l’a dit, quelles que soient les prétentions démocratiques, c’est toujours une élite ─ « notre classe politique » ─ qui exerce le pouvoir. Athènes vivait ce moment de grand péril, où foi, croyance et représentations du peuple et celles de son élite divergeaient. On a vu pareil affrontement dans Athènes glorieuse lors du scandale des Hermès. On le retrouve, exacerbé, dans Athènes vaincue, secouée par les révolutions et dont l’identité même est menacée.
La défense de Socrate est un modèle de dignité. Elle ne manque pas pour autant d’adresse et de compréhension. Socrate sait et ne cache pas que les accusations portés contre lui ne sont pas sérieuses. Sa pauvreté démontre son désintéressement. Il lui est facile de prouver que, sa méthode maïeutique, où le disciple doit accoucher de lui-même, interdit toute influence corruptrice. Il sait qu’il est la victime d’une hostilité plus profonde qui l’a toujours accompagné et s’est déjà exprimée dans la comédie, Les Nuées d’Aristophane, qu’il cite et réfute. Face à cette hostilité, il est désarmé puisqu’elle a pour cause l’évidence d’une supériorité que toute société accepte difficilement ou, le plus souvent, refuse. On peut l’analyser, non y porter remède. La Cité accepte une fausse supériorité ou une supériorité partielle, parce que, publique, elle ne porte pas atteinte à l’intimité. Psyché peut s’accommoder d’une supériorité privée parce que, même authentique, n’étant pas publique, elle laisse une marge au doute et à la liberté. Une supériorité évidente, privée et publique, en revanche, signifie une infériorité douloureuse. On peut la surmonter dans l’admiration, le respect, l’amour, la gratitude, qui rétablissent l’égalité morale. Le plus souvent toutefois, l’inférieur privé ou collectif cherchera à ruiner ou détruire la supériorité.
Socrate le sait et commence par dénoncer lui-même cette supériorité. Interrogé, l’oracle de Delphes aurait déclaré Socrate, le plus sage des hommes. Admirons l’adresse de la défense : elle est double. Tout d’abord, il devient évident que l’homme ainsi élu par la divinité ne saurait « corrompre la jeunesse » et, d’autre part, s’il est honoré et choisi par l’oracle, c’est bien qu’il honore, comme il convient, les dieux et les traditions dont l’oracle est le porte-parole.
Voilà dénoncée, exposée cette supériorité, dont on n’osait avouer l’évidence et qui irritait chacun. Comble de l’habileté ! Socrate en souffre tout le premier ! Il ne sait que faire de cette élection et, modèle de l’humilité, interroge les philosophes, les artistes, les artisans pour comprendre enfin qu’il n’est supérieur que par son humilité ; alors que tous croient savoir, lui sait qu’il ne sait pas. Si Dieu reconnaît la sagesse de Socrate, c’est seulement que celui-ci sait que sa sagesse n’est rien. Sans grande difficulté, avec sa technique habituelle de questionnement, Socrate conduit son accusateur Mélétos à se contredire. Il conclut en annonçant qu’il ne changera rien à sa conduite qui est un devoir imposé par les dieux. Provocant, il explique qu’ayant fait face à la mort, sous les ordres de son commandant aux batailles de Potidée, d’Amphipolis, de Délium, il est prêt à l’affronter pour exécuter les ordres que Dieu lui a donnés d’éveiller ses concitoyens, de les conduire à la vérité : « Je vous aime et vous honore, hommes d’Athènes, mais j’obéirai à Dieu plutôt qu’à vous. » Mouche du coche, il les contraindra à se souvenir de leur âme. Il obéira et servira le Bien, au péril de sa vie. Il évoque son rôle au tribunal chargé de juger les commandants de la bataille navale des Arginuses (-406), qui avaient remporté la victoire mais avaient abandonné nombre de leurs hommes en train de se noyer. Seul, il avait voté pour le respect de la loi et pour juger les commandants, individuellement et selon leurs responsabilités propres et non en bloc. Il a défendu la justice contre un peuple, plus sensible à la perte de ses frères qu’à la victoire, révélant ainsi les clivages qui menaçaient la Cité. Les commandes furent exécutées par un jugement de « Classe », plus que de Justice. Socrate va souffrir de cette démocratie dévoyée. Mais, quand l’oligarchie, appuyée par Sparte, impose la dictature des Trente, Socrate s’oppose à ses décisions, refusant d’aller arrêter un innocent, Léon de Salamine. Il attendait la mort et ne fut sauvé que par la révolution qui renversa le régime.
« Mes amis, je suis un homme et, comme tous, créature de chair et de sang, avec une famille de trois fils dont l’un est presque adulte, les deux autres, encore enfants. » Mais craindre la mort ou chercher à faire pitié serait se déshonorer et déshonorer la Cité dont on est citoyen. Il faut informer et convaincre, et non solliciter faveur ou pitié. Socrate ne demande pas au juge d’interpréter la loi en sa faveur, mais seulement de l’appliquer.
Aucune concession ! On a paraphrasé et cité ce texte longuement. Quand on le retrouve à vingt siècles de distance, on ne peut qu’être confondu par sa grandeur. Un homme, il le rappelle lui-même, et père de famille et, bien, exceptionnellement, vivant, joue sa tête ─ mais n’accepte pas de la baisser. Il y a à peine plus d’un siècle que naissait la personne. On égalera celle de l’Apologie, on ne la dépassera jamais. Une étape essentielle de l’anthropophanie est achevée.
Le verdict de culpabilité, obtenu à une faible majorité (trente voix sur cinq cent un) démontre le contraire. L’homme a trouvé et garde en Socrate de l’Apologie un modèle pour le guider, un idéal pour l’éclairer. L’histoire du Moi privé n’est pas finie pour autant, pas plus que celle de la collectivité : Socrate n’est pas parvenu à surmonter l’angoisse de la Cité en raison de tensions qui la menacent d’explosion. Quel que soit le respect dû à l’oracle de Delphes, il est difficile de croire qu’un esprit aussi développé et, surtout, critique, que Socrate puisse accorder confiance aux traditions autrement que par commodité. Il ne saurait partager la foi populaire en les dieux de la Cité qui sont devenus le rempart d’une société qui se sent menacée. Un esprit tel que Socrate, qui vient d’exposer si clairement ses finalités et valeur pour lesquelles il n’accepte aucun compromis, ne peut accorder crédit ou respect aux fables qui fondent ou illustrent une foi populaire d’autant plus ardente qu’elle est menacée au cœur et dans l’esprit même de ses zélotes.
Cette angoisse, issue du clivage grandissant qui sépare, dans les modes de sentir et de penser plus même que dans les intérêts, les élites du peuple qu’elles représentent et gouvernent, a condamné Socrate. La majorité exprime cependant ses doutes et regrets, à la manière de circonstances atténuantes, en laissant au coupable le choix de son châtiment : amendes, exil… Socrate se fâche. Le ton se durcit et devient provocant. Il est, à ce changement, de bonnes raisons. Peut-être que Socrate vient de comprendre qu’il lui faut la mort pour couronner sa vie ; que s’il meurt alors, il vivra à jamais ; son destin sera accompli. Il refuse la modestie : il a été un citoyen modèle par son désintéressement et son activité infatigable. Il convient de l’honorer, de le recevoir au Prytaneum et de l’entretenir sa vie durant. On lui laisse le choix. L’exil… Mais il n’aime pas la vie si follement qu’il accepterait à soixante-dix ans d’aller de ville en ville chercher un refuge, chassé de partout, comme il l’est d’Athènes en raison de la vérité qu’il ne peut taire parce que Dieu la lui a confiée.
Nouveau vote : Socrate est condamné à mort. Il demande : « Que dira-t-on d’Athènes qui a voté la mort de Socrate ? » On aurait pu faire preuve d’un peu de patience : Socrate est vieux. Il n’aurait pas tardé à mourir de mort naturelle. Il s’adresse à ceux qui ont voté la mort : qu’ils ne pensent pas que Socrate est condamné en raison de sa maladresse, qu’il aurait dû demander pardon, implorer. « J’ai préféré parler comme je l’ai fait et mourir plutôt que vivre en parlant comme vous l’auriez souhaité. » Il leur prédit le châtiment qui viendra les frapper et que ─ je puis en témoigner ─ ils seront maudits de siècle en siècle.
Il se retourne vers ses amis qui ont voté son innocence. Le moment est bouleversant. Ils leur demandent de rester encore auprès de lui pour parler ensemble comme ils l’ont fait si souvent ne le feront plus. Il leur demande de ne pas être tristes ou seulement parce qu’il faut se quitter. La mort n’a rien d’effrayant, rien de terrible. Ou bien elle est seulement un sommeil sans rien, une de ses longues nuits que l’on a connue de son vivant et dont on se souvient avec gratitude. Ou bien l’âme est immortelle et quel bonheur de retrouver alors Homère et ses héros, Hésiode et ses travaux, et de pouvoir converser avec eux. Bien mieux, Socrate se promet ─ et on imagine son sourire et clin d’œil ─ de les soumettre à son questionnement pour interroger et juger leur sagesse. L’heure est venue. Il faut se quitter : eux vont vers la vie, lui vers la mort et ─ phrase trop célèbre ─ Dieu seul sait qui aura la meilleure part.
Ce texte, cette Apologie dans les circonstances qui l’entourent, la foule houleuse, le soleil ardent, la mort promise, est, sans doute, admirable dans sa vérité, ses circonstances et sa morale. On aimerait citer Shakespeare et l’éloge de Marc Antoine quand, au soir de la bataille de Philippes, il découvre le corps de Brutus, son ennemi qui s’est tué :
─ “Nature could stand up and say to all the world
“This was a man.”
On ne saurait mieux dire, ni exprimer mieux l’orgueil que l’on ressent à montrer ainsi, à tout l’univers muet, au néant stupide, ce que fut et peut devenir un homme. En ce sens, on l’a dit, l’anthropophanie est achevée. Ou bien, plutôt, elle a entrevu son idéal.
Je n’ignore pas tout ce que l’on doit à Platon et le même procès, la même apologie relatée par Xénophon, n’a pas la même grandeur. Mais n’est-ce pas simplement que Platon est meilleur peintre. Les relations, passionnantes au demeurant, de Socrate et Platon, telles qu’elles ressortent de l’œuvre de celui-ci, n’entrent pas dans notre propos. De toute façon, la qualité inégalée de l’homme est évidente. La Grèce a conçu et montré dans ses Kouroï, le Moi individuel, son charme et sa promesse. Par Socrate et l’Apologie de Platon, elle est parvenue à brosser l’idéal en même temps que la réalité de l’homme. Mais cet homme est mortel et, pour une part au moins, poussière, il retourne à la poussière. Ce qu’il pense de sa fin, comment il se propose et sait l’affronter sont des moments essentiels pour compléter et parachever son portrait. Ils tiennent en deux dialogues : Criton, Phédon.
Un mois s’est écoulé depuis la condamnation à mort de Socrate. Il est toujours en prison. Le vaisseau sacré, qui doit porter à Délos les offrandes d’Athènes en mémoire des jeunes Athéniens libérés par Thésée du Minotaure, n’est pas de retour et nulle exécution capitale ne peut avoir lieu tant qu’il n’est pas revenu au port. Mais on l’a aperçu au Cap Sounion. Il sera là dès le lendemain. Criton, déjà sans espoir, vient une dernière fois s’efforcer de persuader Socrate de s’évader dans la nuit. Ainsi s’engage un dialogue essentiel, car ce n’est pas seulement que l’homme est mortel, mais qu’il le sait et que, en conséquence, sa mort est partout présente dans sa vie et sa mortalité façonne la Psyché.
Encore une fois, rendons hommage au romancier Platon. C’est l’aube et, en se réveillant, Socrate découvre son ami Criton, assis à côté de son lit attendant son réveil. On le voit, grand et maigre vieillard, toute bonté, toute inquiétude sous son masque bougon, assis, les mains aux grosses veines de la vieillesse, fermées sur les genoux. Le silence l’entoure, le malheur l’habite, un malheur de vieillard calme, silencieux, au dos droit. Il n’a pas réveillé Socrate, impressionné par le sommeil si tranquille de son ami dont la mort est si proche. Le vaisseau sacré de Délos sera de retour dès le lendemain. Socrate n’a plus que quelques heures pour s’évader. Tout est prêt : l’argent réuni pour soudoyer les gardes et pour la fuite jusqu’en Thessalie où des amis attendent Socrate. Qu’il ne craigne rien pour ceux qu’il laisse derrière lui à Athènes et que l’on pourrait accuser de complicité : ils ont les moyens de se défendre. Socrate refuse. La mort est une fin naturelle qu’à son âge on doit attendre tranquillement. Comme Criton a pu le constater, elle ne trouble pas le sommeil de Socrate. L’important est de mourir sans reniement, dans la fidélité à soi. Socrate a vécu à Athènes ; il ne l’a quittée que pour des obligations militaires ou officielles. Or la loi fait la Cité, père et mère du citoyen. Elle peut commettre des erreurs. Elles ne donnent pas le droit de la trahir. Athènes l’a engendré, élevé, éduqué. Or, Athènes se confond avec sa loi. Il ne peut, pour éviter… non, pour retarder la mort, renier sa Cité d’un reniement qui risque de devenir exemplaire, faisant de chaque citoyen le juge de sa Cité.
On a su préférer la mort au déshonneur. Il y eut une première fois, cependant, ou, au moins, une première expression de ce choix. Il doit à Socrate sa singulière éloquence. En revanche, le rapport à la Cité et à sa loi garde son originalité d’époque. Les rapports du Moi collectif et du Moi privé sont encore intimes. Socrate parle, avec un naturel surprenant, d’Athènes comme de ses père et mère ; l’accent filial que l’on entend dans son propos sonne juste. Il n’est pas métaphore, mais au-delà du symbole, une relation quasi familiale.
Le Phédon est le récit de la mort de Socrate. Il demande à un ami de reconduire sa femme en pleur et son enfant à leur maison. Enfin libéré de ses chaînes, Socrate en éprouve un vif plaisir. Une dizaine d’amis l’entoure. Coquetterie d’auteur : « Platon était-il du nombre ? » demande-t-on à Phédon qui ne s’en souvient pas… Non, il était souffrant… Ainsi se trouve respectée la forme du dialogue qui demande que son auteur en soit absent. Le philosophe Evarus n’a pu venir : « N’oubliez pas de lui rappeler de me suivre » dit Socrate et, comme on s’étonne du message, il aborde la question de la mortalité. Aucun philosophe ne se donnera la mort, mais tous doivent être prêts à mourir. Le suicide est interdit parce que, jusqu’au dernier moment, chacun peut encore servir les dieux. Mais alors pourquoi le philosophe accepte-t-il si facilement la mort ?
Quelle est la nature de la mort ? Elle n’est que la séparation de l’âme et du corps. Or le philosophe doit se détacher des plaisirs sensuels pour libérer l’esprit. Comment l’âme peut-elle espérer atteindre la vérité, alors que le corps et ses sens ne cessent de la tromper ? Le philosophe cherche à s’en libérer.
Du fait du corps et de sa vie, la pensée est sans cesse troublée, menacée. Libérez l’âme ! est le but de la vie du philosophe que seule la mort peut parachever. Il doit en conséquence l’accueillir dans la joie. Mais l’âme est-elle immortelle ? Ne meurt-elle pas avec le corps ? Ici intervient le principe essentiel d’opposition : une chose n’est que par opposition à son contraire, comme le sommeil par opposition à la veille. De même la mort génère la vie ; la vie, la mort. Ce sont deux états opposés de l’âme. Elle existe ici et là comme le prouvent récollection et réminiscence qui sont le fondement évident du savoir. On ne sait qu’en se souvenant. Mais quand a-t-on appris ce dont on se souvient ? Toute perception est reconnaissance. Je reconnais la lyre en me souvenant de la musique, de la musique en me souvenant de l’artiste ad infinitum ! Toute information nouvelle n’est significative que par l’information acquise qui lui prête un sens. On ne peut donc apprendre que ce que l’on sait déjà.
Á nos yeux, cette thèse de Socrate se justifie au moins dans l’apprentissage du langage ou d’une langue étrangère. Chaque langue est un système que l’on ne peut apprendre mais seulement comprendre et on ne peut comprendre un système par l’observation des détails de son fonctionnement. Il faut connaître le tout avant d’en saisir, identifier, apprendre la moindre partie. L’apprentissage ne peut être que reconnaissance par l’âme de ce qu’elle sait et dont elle se souvient. Une expérience au moins confirme cette construction vertigineuse : celle du polyglotte qui, ayant appris à « chanter » une langue, ressent le mot qui lui manque comme un trou de mémoire alors qu’il est fait d’ignorance. Il n’en est pas moins difficile de croire que notre âme qui, de ce fait, prouve son immortalité, aurait tout appris dans une autre vie et nous rend ce savoir par le moyen de la réminiscence. Il est plus facile de conclure que, pour citer Hamlet, “There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy”, et que logique et réalité ne se raccordent, ni ne se recouvrent exactement. L’essentiel est ailleurs : dans la force et l’indépendance d’esprit d’un homme qui sait que la mort l’attend dans quelques heures. Dans son courage, ce défi à la mort est une forme d’immortalité car c’est lui qui, la vie durant, permet d’entreprendre et accomplir comme si la mort n’existait pas.
Que l’âme existât avant la naissance ne prouve pas qu’elle existera après la mort. Socrate répond que l’on ne peut dissoudre que le composé et non l’essence. Par définition, Beauté ou Justice absolue sont essences et non composés. Le temps est désarmé. Toute chose change, mais non l’esprit. L’âme, il est vrai, est prisonnière du corps. Elle perçoit par lui et peut être entraînée par l’ivresse du changement. Il lui faut savoir se libérer de cette tentation pour acquérir la sagesse dans la connaissance et contemplation d’un transcendant temporel dont le monde, construit par les sens, est seulement l’actualisation d’un instant.
L’âme doit se détacher, se libérer du corps et, en ce sens, on peut dire que toute philosophie est étude de la mort. Elle doit être guidée par la compréhension du phénomène de participation. Le beau n’est pas causé par la Beauté ; il n’en est pas fragment ; il en est participation. Il n’est pas par opposition au laid, mais par reflet de la Beauté. De même, le grand n’est pas par comparaison avec le petit, ni par référence aux relations avec l’inférieur, mais par participation à la grandeur. Sa présence, dans la chose, manifeste l’essence mais ne la résume pas. Le feu n’est pas la chaleur ; ni la neige, le froid. Neige et feu sont accidentels. Chaleur et froidure, essentielles ─ et, donc, intemporelles… Mais comme on lui objecte une théorie de l’âme, harmonie des éléments qui composent le corps, Socrate complète sa démonstration par l’analyse des oppositions de ce rapport où l’un efface l’autre. Pair ou impair : là ou celui-ci s’impose, celui-là n’est plus. De même là où est l’âme ─ qui est vie ─, la mort n’est plus…
Est-ce la fatigue, l’heure qui avance, la mort qui se précise, ou bien le romancier dans Platon qui exige que l’on déserte ces sommets de l’abstraction pour pressentir, le soir, l’imminence de la séparation, le frisson de la fin ? Déjà, une fois, Socrate avait interrompu ses raisonnements et on l’avait vu se pencher vers Phédon, caresser ses boucles qu’il faudrait bientôt couper comme on le doit, en signe de deuil. Maintenant, le retour à l’existentiel, moins abrupt, conduit vers la morale. L’âme, qui ne sait pas se détacher du corps et se trouve séduite par lui, aura trahi son essence. Elle sera châtiée. Socrate évoque le jugement dernier et le guide qui y conduit. Après le verdict, l’âme gagnera les Champs-Élysées pour s’entretenir avec Homère, Hésiode, ou se précipiter dans l’enfer du Tartare.
Le changement de ton, de références, de représentations et images est frappant. Tellement que, avec un sourire, Socrate s’en excuse. Ce voyage d’outre-tombe et ses péripéties ne sont pas prouvés, seulement des on-dit. Pourquoi les évoquer ? C’est que ─ et là se trouve l’explication du rôle du mythe dans l’œuvre de Platon qui doit esquisser ce que l’esprit ne peut formuler. Ne nous avait-il pas prévenus, dans le Timée, que si l’on n’avait pas commencé par voir des étoiles, on n’en aurait jamais rien su. Ainsi s’expliquent ces changements dans le propos, si abrupts et profonds que l’on dirait deux cultures appartenant à des siècles différents, un instant réunies. Le mythe, la fable sont là pour signaler une vérité que l’on n’a pas encore appris à dire et qui propose ses images à la pensée. Elles sont comme un avenir qu’elle pourra découvrir, cette étoile que je vois et dont un jour je saurai tout.
Le soleil baisse. Socrate, pour éviter aux femmes la peine de laver un cadavre, va prendre un dernier bain. Comment l’enterrer ? « Comme vous le voudrez, mais gare que je ne vous échappe ! » Un dernier sourire et, ensuite, la coupe du poison. Le geôlier se retire en larmes. Il faut boire, ensuite marcher jusqu’à ce que les membres s’engourdissent. Socrate boit, puis marche de long en large. Il ne parle plus et, s’il se parle, on ne sait ce qu’il se dit. Si, encore une phrase assurée, ambiguë : « Criton, n’oublie pas que nous devons un coq à Esculape » ─ sans doute pour le remercier d’avoir guéri de la vie. On entend des sanglots. Le pas de Socrate se fait lent. Sur son visage, comme un sourire oublié ou le voile d’une nostalgie pour ses amis qu’il doit quitter. Des sanglots…
Socrate se couche, comme soulagé. Il va mourir. Il se détend, s’installe de son mieux, trouve son aise. Socrate est mort.
Jean BLOT
28.09.2016
Des(t/s)in(s) de guerre
(éditions Paris-Musées – rbc Musée Zadkine)
par Véronique KOEHLER
Le mot dessin, dans son phonème, est singulier. Une seule lettre le sépare de dessein qui assure des pouvoirs de la volonté et de sa liberté. Une seule lettre le sépare du destin qui se rit de toute initiative, fait baisser les têtes, interdit tout libre-arbitre.
Véronique Koehler, l’auteur du livre dont le titre joue sur ces glissements phonétiques, et de la bouleversante exposition éponyme (jusqu’au 5 février 2017, Musée Zadkine, 100bis rue d’Assas, Paris 6e), n’aura retenu que le second : Dessins/Destin. Il est vrai qu’il a un pouvoir sans rival quand le premier se voit assigner la guerre et que son modèle et destin sont la représentation de son cauchemar. Depuis que, dans Pharsale, Lucain a, le premier, osé arracher à Bellone, la déesse de la Guerre, incarnation de ses horreurs, son masque de beaux gestes et de bons mots, plus de deux mille ans se sont écoulés sans parvenir à convaincre tant l’animalité est ancrée profond dans l’homme. Bellone retrouve toujours ses tambours et ses cuivres, ses uniformes qui font des hommes des oiseaux du paradis, ses exploits qui font frémir l’engeance carnassière. Les horreurs de la guerre sont vite oubliées. Dans notre époque où la violence est de retour, il convient de commencer par remercier le grand sculpteur Zadkine et son interprète et présentatrice Véronique Koehler, de nous rappeler le vrai visage de Bellone, en même temps que le dessein moral du dessin.
Les horreurs de la guerre se suivent mais ne se ressemblent pas. La nôtre, mondiale, la Seconde, fut marquée par le mouvement qui est la transcription physique sinon de l’espoir au moins de la vitalité. On s’y tuait en plein ciel, au fond des mers, dans des tanks, sur des motos. La Seconde guerre fut idéologique. Jamais dans l’histoire le Mal et l’animalité n’avaient trouvé incarnation plus exacte, champion plus convaincu que l’Allemagne nazie. Les pires crimes étaient raciaux, politiques ; les massacres des populations civiles faisaient pâlir les crimes de Bellone.
La Grande guerre, celle dans laquelle Zadkine fut engagé, allait à pied, de préférence dans la boue, à travers les paysages dont ses obus firent des squelettes agrémentés de barbelés. Elle enterrait ses hommes dans les tranchées pour les rapprocher de la mort et du cercueil. Elle tuait à la baïonnette. On y voyait le visage, on se souviendrait de l’expression du jeune homme qu’on allait embrocher. Infirmier, brancardier, Zadkine fut aux premières loges pour observer cette kermesse de l’horreur que, avec ses blessés, amputés, agonisants à grands cris et en silence, Bellone offrait. Avec beaucoup d’art et grand tact, Véronique Koehler suit l’artiste d’autant mieux qu’elle sait se garder de commentaires et laisser au lecteur, notamment à celui-ci, d’imaginer ce que l’artiste vit, vécut. C’est avec le même art, le même tact, qu’elle fait apparaître cette fratrie désolée des artistes et écrivains, Léger ou Cendrars, échoués dans la paix comme l’est Zadkine ; tout un nouveau Montparnasse, plus pauvre que jamais et porteur d’un tragique secret, épouvantable, qui les étouffe et qu’ils désespèrent de pouvoir exprimer.
Le mérite de pareils livres et de pareilles expositions est de réveiller les passions, fourbir les exigences, en un temps comme le nôtre, de marée montante de la violence. Les dessins, les gravures qui en découlèrent disent que Zadkine fut de ceux qui, quelles que soient les circonstances, « savent regarder en face les soldats qui souffrent et ceux qui meurent » pour citer l’auteur qui décrit et, on la voit, la camionnette avec laquelle Zadkine, brancardier, devait aller chercher les malheureux à l’entrée même des tranchées. « Éclats de réalité » : Véronique Koehler sait épouser les chemins de l’absurde et transmettre au lecteur le vertige de Bellone. On suit le parcours insensé et les efforts du critique pour redécouvrir les lieux des œuvres. Quant à l’état d’âme, Zadkine le confie à son ami, son professeur à Vitebsk : « La laideur est partout et mon âme est froide ».
De cette laideur, il faudra inventer la beauté, c’est-à-dire découvrir son sens. Il faudra faire le jardin où chaque ligne, courbe, jeu de forme ou de lumière redisent à l’homme sa grande misère et sa souveraineté puisque de l’horreur il peut faire le dessin, et de l’Absurde cosmique un destin. Zadkine sera gazé, mais même là, il aura des visions de formes admirables en lesquelles se transformeront l’initiative allemande des gaz asphyxiants et les trois mille morts et sept mille gazés d’Ypres.
Avec beaucoup d’art, Véronique Koehler profite de la pause de convalescence dans la vie de Zadkine pour représenter celle qui continue à Montparnasse dans les ateliers. À son retour, durant l’hiver 1917-1918, Zadkine devait graver ses eaux-fortes de guerre. Tout un travail de datation et de localisation des œuvres de guerre est entrepris et mené à bien par la science de Véronique Koehler. En retrouvant les dates et les lieux, on retrouve les étapes de la Grande guerre auxquelles Zadkine participa. L’analyse des documents révèle l’indifférence caractéristique de l’apatride à l’état-civil. Il change de prénom, il se trompe sur les dates, les lieux de son service. Il change de dates de naissance. Il se détache même de ses parents et ne les mentionne plus dans les formulaires qu’il doit remplir. De fait, Zadkine ne retrouvera pas les siens, morts de misère dans une Russie détruite par la révolution. Des lettres déchirantes du père montrent que le fils avait choisi une voie qu’il ne pouvait accepter.
En France, particulièrement à la Rotonde, Zadkine retrouvait des compatriotes, tels Volochine et Ehrenbourg, et se tenait au courant de l’évolution de la Russie. Zadkine, selon son biographe, est de ces artistes dont la sensibilité fut définitivement marquée par la guerre quelle que fût leur nationalité. Paris n’est plus le même et le regard que ces artistes posent sur leurs contemporains les défigure. Curieuse biographie que celle-ci, combien originale, combien exigeante et déroutante, la biographie d’un regard, celui de Zadkine, magistralement illustré, et au-delà du regard des artistes revenus des tranchées, porteurs de leur spectacle et qui voyaient dans leurs perspectives, l’ancienne réalité. Véronique Koehler gomme les lieux, les dates, les nationalités de ses personnages, pour reproduire la confusion où s’est formée cette sensibilité, et singulièrement celle de Zadkine, deux fois apatride, ayant perdu sa patrie civile mais aussi celle plus profonde où l’âme se réfugiait. Dans la hardiesse tacite de sa vision cherchant à se cadrer dans l’évidence du chaos, on peut lire l’idée bouleversante que l’art de l’après-guerre a pour source et origine cette guerre même. La laideur, à sa suite, fait une entrée triomphale dans l’arène de la représentation, bouscule et ridiculise la beauté et un art rongé par le narcissisme, tenté par l’autoportrait. Mais, pour les mêmes besoins et raisons de sympathie, de sublimation, d’idéalisation, les artistes ont soumis le laid aux mêmes règles formelles, à la même vérité du regard, proche mais indépendant de la morale. La beauté s’inspirait de l’admiration, de la sublimation ; la laideur s’inspire de la compassion qui, en enseignant à l’enfer les formes du salut, saura le rédimer.
Reste les œuvres. Mais elles sont là, présentes dans le livre de Véronique Koehler, comme dans son exposition, et les décrire ou les commenter ne saurait que les trahir. Il reste seulement, en les regardant, à tirer force et gloire de ce dessein de Zadkine qui est parvenu, gazé mais plein de forces créatrices, à réduire et dompter l’horreur absurde du destin pour la métamorphoser en l’intelligence et la sensibilité – la compassion – du dessin.
Jean BLOT
21.09.16
Georges-Emmanuel CLANCIER
entre prose et poésie
par Jean BLOT
Il est un discours indicatif qui désigne les choses et nomme leur combinaison. Il en est un autre, expressif, qui cherche à baptiser les choses et à leur trouver place dans le monde affectif et de la pensée. Si le premier entend dire ce qui est, le second veut exprimer les sentiments et les impressions que l’homme y trouve et garde pour se dire lui-même et le monde tel qu’il le voit et l’habite. Ce second discours peut prendre l’envol de la Poésie, dans son innocence et irresponsabilité ou, au contraire, s’acheminer vers l’humilité et la fidélité de la Prose. Ces deux chemins divergent ; deux types d’homme différents les empruntent et, par leur choix, renforcent leur différence et les messages opposés qu’ils véhiculent. Bien rares ceux qui parlent les deux langues avec le même naturel, passant de l’une à l’autre, et se jouent de leurs conflits. Plus rares encore ceux qui habitent prose et poésie, jouissent de leurs deux visions et sensibilités rivales. Clancier est de ceux-là. Le grand mérite de l’Autobiographie qu’il publie aujourd’hui sous le titre de Le temps d’apprendre à vivre (Albin Michel) est de passer de prose en poésie et de démontrer comment elles se complètent pour raconter la vérité de la vie. Apprendre à vivre ? N’est-ce pas savoir les concilier, donner chaque jour à ses événements et personnages le poids de la prose et les ailes de la poésie.
Dès la brillante ouverture, la clef, non celle de la porte mais celle de l’opéra, est donnée avec ses thèmes, récitatifs, vocalises, qui composent la biographie. Qu’on en juge…
Le rideau se lève sur la scène du bonheur où le rustique et l’innocence, les odeurs de l’été et celles de la fécondité, la beauté de la femme et sa tendresse nourricière reconduisent à l’enfance et, en lui prêtant le décor qui est par nature le sien, la confie à la biographie. N’est-ce pas la meilleure des ouvertures ? En effet, mais elle l’est d’autant plus que cet admirable portrait d’un moment, parmi les premiers, de la réalité de toute existence – de toutes ses valeurs au plan de la sensibilité – est la description d’un tableau que le jeune homme qui se raconte, vient d’acheter à la veuve du peintre espagnol Cadenas, fusillé par le fascisme triomphant de Franco. La magie de la reproduction livre la clef de l’opéra biographique : il n’est récitatif qui ne tarde à s’envoler en aria, aria qui ne se brise sur la cruauté de la prose – pour reproduire vingt ans d’existence du 20e siècle. Comme l’est chacune par tous les temps, elle est partagée entre réalité et rêve, songe et quotidien.
C’est par ce coup de théâtre et cette merveilleuse malice poétique qui habite l’auteur et l’homme que se découvre l’originalité si naturelle, si attachante du génie de Clancier : cette vision en miroir, qui donne au reflet une présence égale à celle de l’objet, à l’image une force pareille à celle de cela qu’elle représente et prête au portrait une réalité égale à celle de son modèle. Ce n’est pas que la vie soit un songe, comme le voulait Calderón, ni que le monde soit un théâtre, comme le clamait Shakespeare, mais que le théâtre et le monde, le songe et la vie composent à égalité l’existence, qu’être homme c’est habiter simultanément ici et là : dans un jeu de miroir où l’esprit s’affole mais où la réalité se retrouve. Clancier, son talent, sa vision me paraissent pareils à ce personnage de l’un de ses romans (Les Incertains) qui se présente à un bal costumé, peut-être celui-là même de la vie, déguisé en miroir et prince des reflets.
Le plus naturellement du monde, le père, héros de la Grande guerre, véhicule et impose le cauchemar des tranchées ; que Max-Pol Fouchet, grâce à sa revue Fontaine, devienne l’espérance au-delà de l’Occupation allemande, l’aube se levant outre-mer, ou que Joë Bousquet, sur son lit de douleur, occupe, dans un admirable portrait, une place entre la vie et la mort – et, depuis deux décennies –, un lieu où s’entrecroisent tous les reflets qui composent et dansent malgré le poids sans appel de la réalité.
Georges-Emmanuel et Yvonne forment un jeune couple pour une union destinée à dépasser les sept décennies – lui, étudiant encore cherchant sa voie, découvrant son talent ; elle, déjà thérapeute. Ensemble, ils abordent la vie dans un moment particulièrement tragique. La France s’est effondrée, entraînant toute une réalité humaine et naturelle que Clancier décrit avec un art consommé. Cette jeunesse souffre de la fragilité de ceux qu’on a mis à la porte d’eux-mêmes et qui cherchent en même temps, avec la même angoisse frileuse, leur place dans la société.
Le jeune homme se découvre dans la poésie et par la réalité de sa publication dans les revues de l’espoir : Cahiers du Sud, Fontaine, bientôt Confluences. Le rôle de la poésie, sa renaissance dans la France à genoux, « coupée en morceaux », ont été une expérience majeure, déterminante dans la vie de Clancier ; c’est bien pourquoi cette soudaine floraison et sa portée humaine et politique sont si bien décrites par lui. Clancier ne laissera jamais la poésie se perdre dans le ciel et lui rappellera sans cesse ses solides racines dans la terre du paysan. Il ne laissera jamais celui-ci oublier qu’il est l’héritier des paysages enchanteurs du Limousin, hantés par des fées malicieuses se moquant du nigaud qui a voulu les épouser.
La manière dont Clancier procède pour respecter ce songe de la réalité, ce théâtre du monde, est d’un art consommé. On voit l’écrivain Blanzat flamber de colère ; le lieutenant héroïque, père de l’auteur, rongé par la honte d’une légion d’Anciens Combattant à laquelle on lui demande de participer et qui est destinée à la mouchardise. On voit l’indignation ronger, la colère flamber autant ou mieux que leur victime, aussi réelle, présente qu’eux. Cette égalité dans la représentation, l’évocation, la suggestion du sensoriel et du spirituel, situés en miroirs se reflétant, est particulièrement réussie dans la présentation de l’écrivain notoire, grand ami, Robert Margerit, très jeune encore, dans un portrait où ce que l’auteur nous confie et ce qu’il laisse deviner, ce qu’il montre, ce qu’il dérobe, devient comme le jeu des fées invisibles animant les forêts de Nerval. Voilà une voiture de luxe, une Delage de rêve sur les routes modestes de la campagne avec le jeune écrivain au volant, le château de Thias échangé contre sa soupente, le pas qui fuit vers le rêve des verdures, la maîtresse de maison enfin, dont la présence concrète est comme une façade gardant, avec le plus civil sourire, un secret. Tous ces personnages sont là, bien là comme le veut le romancier, mais pour annoncer le rêve, l’absence, l’ailleurs et sa poésie de leur être en miroir qu’ils dérobent. Le silence qui englobe le couple est palpable et démontre la double nature du réel.
Dénoncé pour « l’esprit communiste et gaulliste » de sa poésie, dans le temps où les Allemands et leur Gestapo occupent la « zone libre » de Pétain où se trouve Limoges, pareille accusation ne peut être prise à la légère. Clancier ne cesse pas ses activités pour autant et mobilise ses amis et, en particulier, Raymond Queneau et Michel Leiris, pour rendre vie à Fontaine que Max-Pol parvient à sauver en Algérie. Dans cette atmosphère si tendue de l’année 1942, où le danger est partout, naît cependant un premier enfant, une petite fille Juliette. Le jeune père n’entreprend pas moins de cacher des jeunes gens destinés au Service Obligatoire en Allemagne.
L’année s’écoule ; à Stalingrad les Russes triomphent ; on se bat en Italie. À Limoges mais aussi dans Paris, où Clancier fait un bref séjour, il est dans l’air quelque chose qui ressemble à la brise de l’espoir : Paulhan, Blanzat, Mauriac, Ponge préparent déjà l’avenir, un Front national où les intellectuels divisés se retrouveront, cependant que Clancier cherche, parmi eux, des collaborateurs pour Fontaine. De nouveau, le génie particulier de l’auteur fait que l’espoir – Londres et de Gaulle, Alger et Max-Pol Fouchet –, comme les fées ou les esprits des forêts et des champs, des parcs, quoique toutes absences deviennent sensibles et présentes dans le quotidien et l’air que l’on y respire.
Grande fresque historique que cet apprentissage de la vie, mais d’une histoire tenue à sa juste distance, aussi présente mais lointaine qu’un ciel d’orage dont le grondement est toujours perceptible, mais dont la foudre reste soudaine et toujours surprenante. Clancier est convoqué à la censure postale : il reçoit des lettres de Tanger ; qui les lui envoie et pourquoi ? Déjà, la police craint la Libération et relâche Clancier, mais il juge prudent de quitter Limoges, de gagner la campagne, de se réfugier chez des amis, dans une ferme « en plein territoire des terroristes bolcheviques », comme le leur dit pour les prévenir le chef de la milice contrôlant l’autobus. De fait, voilà un maquisard qui patrouille – et c’est sous sa protection que le couple Clancier et leur fillette vivront les derniers mois de l’Occupation. Un printemps de toute beauté les y attend comme pour démontrer son indépendance de l’histoire. Elle revient : les Allemands pendent les insurgés de Tulle, massacrent toute la population d’Oradour. Ailleurs, la milice (française) participe aux assassinats. « En tous lieux, la violence semblait tapie, à chaque instant prête à frapper. » Bientôt, ce sont les libérateurs qui vont commettre des excès. La Justice va-t-elle changer de camp ? Cependant se révèlent hommes et opinions qui démontrent le cauchemar dans lequel on avait vécu. Par un retour à la réalité, Clancier prend la direction de Radio-Limoges dans la ville libérée. C’est pour rendre au cauchemar sa réalité par un « Billet » relatif à Oradour. Mais revoilà les champs, les forêts qui ont déjà oublié la guerre et ses atrocités. Que le rêve ne nous emporte pas:femme et enfant attendent au village. Il deviendra un très beau poème : « Route patiente où chaque pierre est signe ».
Tout est poésie… quand, de l’ombre, sort un homme qui exige ; « Haut les mains ! » entraîne le poète, il ne peut imaginer vers quelle réalité. Au croisement, une « traction-avant ». Un homme en sort : « Tes papiers ». Il regarde la carte, présente des excuses, disparaît dans la voiture qui file à toute vitesse. On le voit, la réalité imite si bien le cauchemar que l’on ne sait où l’un finit, où l’autre commence.
« Les grandes circonstances s’achèvent » pour citer Jean Bloch-Michel, trop oublié aujourd’hui. Les petites commencent. Ce sont les soucis et les bonheurs de tous les jours : un fils naît, Sylvestre, héritier du talent de son père (comme on a pu s’en assurer dans le dernier Phœnix) qui ravit le couple. Clancier trouve un emploi à Paris, à la Radio-Télévision, et grandit petit à petit dans la République des Lettres par son œuvre paysanne et céleste, pour paraphraser l’un de ses recueils, fondée sur la foi singulière et profonde de la double nature de la vie : non plus divine et humaine, mais onirique et réelle, toute entière songe, toute entière quotidienne, toute prose, toute poésie. La découverte et le respect de la double nature rendent au siècle écoulé une voix pure et vraie dans l’œuvre de Georges-Emmanuel Clancier – qui nous apprend à vivre.
Jean Blot
03.06.2016
Sur un vers d’Yves Bonnefoy
pour Yves Bonnefoy
Le plus beau poète de notre temps, celui qui paraît destiné à parler de nous aux siècles à venir n’a jamais cessé, alors qu’il lui devait ses pouvoirs, de prévenir contre les pièges du langage. On comprendra que ce n’est pas sans crainte que je viens le contredire. Il le faut : à chacun sa vérité. Et la Vérité n’est peut-être que leur somme.
À chacun, sa vie. L’exilé que je suis ─ Juif en chrétienté, Russe en France, Français en Angleterre, Anglais en Amérique ─ ne doit son salut qu’au langage. Par les langues qui le composent, je fus partout chez moi, chacune, par un accent, une nuance, une exigence, me livrant la clef de la porte où je frappais. En les écoutant, je ne les ai apprises que comme l’on fait d’une musique ; il me semblait chercher, bientôt découvrir en moi, l’étranger, bien moins qu’un caractère, plutôt comme une humeur ou un point de vue. On l’adoptait sans effort. On le quittait de même. Loin de porter atteinte à la personnalité, il permettait de le découvrir et lui donnait le moyen de s’exprimer. On jure mieux en anglais ─ « Shit » ; on refuse mieux en français ─ « Ah, non ! » ; on accepte plus facilement en russe ─ « Tak i byt ». Ce ne sont que moyens et l’essentiel de soi demeure inchangé, aussi fuyant et omniprésent que l’air que l’on respire, mais il est un chemin vers autrui.
C’est d’une autre langue assurément que parle le poète ! Pas tout à fait pourtant. Pour me prendre de nouveau en exemple, bien à regret, s’il m’est aussi difficile de m’identifier à un pays que de le considérer étranger, le français est ma patrie. C’est par lui que je suis au monde, c’est en lui que je me cherche. Je n’ai rien senti, rien compris tant que je ne l’ai pas formulé en cette langue. En elle, je cherche aussi bien ma pensée que l’être du soleil sur un étang qui dort, ou la tourmente d’un linge dans le vent. Seul le français me donne accès à ce pays que le poète a nommé l’Autre patrie ; lui seul me conduit vers ce qui est. Par lui, j’ai traversé l’enfer fascinant de la psychanalyse ; il m’attendait tel le ciel étoilé attendait Dante à l’issue du périple. Quand je me suis mis en mots, que j’ai pu baptiser mes angoisses et les réduire en les ramenant au grand jour du langage, apprivoisant mes monstres en les nommant par des mots de tous les jours et en les reconduisant ainsi, apprivoisés, désarmés, parmi les hommes, dans leur société. Le tigre des cauchemars, par le simple mais douloureux baptême, était devenu un chat, capable de griffer cruellement encore, mais domestiqué. À la sortie de l’enfer complaisant de l’analyse qui m’avait ramené parmi les hommes, attendait, pour seule étoile, la banalité. Le séjour dans mes bas-fonds m’avait reconduit parmi les hommes, mais dans un monde désenchanté. Banalisé ? Peut-être pas.
La puissance du baptême dans l’exorcisme des monstres m’avait conduit à chercher partout le Yin et le Yang et à reconnaître dans le langage une double nature où le pouvoir paternel et l’amour maternel se trouvaient confondus. Il y avait deux langages : celui indicatif de la conquête ; celui poétique de l’amour. Celui-ci cherchait la plus grande proximité aux choses et aux êtres ; celui-là s’élevait vers l’abstraction, quitte à réduire le monde en signes pour le comprendre et le mieux dominer. Le langage paternel promettait le pouvoir ; le langage maternel, le bonheur. On ne peut dominer sans connaître, ni connaître sans baptiser. On ne saurait aimer sans identifier, ni identifier sans baptême. Plus complète l’identification et plus grand l’amour. Plus parfaite l’abstraction et plus aisée, complète, la domination. Quand je dis « Passe-moi le sel », il est certain que je ne reconnais ni le miracle de l’existence d’un autre qui me comprend et peut m’aider ni celui de cristaux venus des mers pour donner goût à l’aliment. Peu m’importe l’origine du sel et, pour ce moment au moins, l’identité de celui auquel je le demande. Seule compte ici l’action. Le langage du père peut avoir sa beauté. Elle réside dans l’adéquation ─ « Veni, vidi, vici » de César en est le meilleur exemple. On ne sait ni d’où il est venu, ni où il est ; on ignore ce qu’il a vu et ceux qu’il a vaincus. L’important était de vaincre et de le faire avec la plus grande économie dans l’action et l’expression. Cependant la pauvreté de ce pouvoir est suffocante. Du voyage, de l’Orient, du carnage, il ne reste que trois mots.
Contre ce drame et pour défendre le langage vrai, celui de l’expression, il est deux types d’hommes : les innocents et les coupables. Les premiers sont poètes ; prosateurs les seconds. Ceux-ci craignent le courroux paternel et maquille leur trahison en miroirs d’actions. N’est-ce pas les servir que de leur donner leur image ? Ceux-là reprennent le langage pour le rendre au monde, à l’amour, à la mère ─ à ce qui est. Parmi les innocents, il y a les rebelles, tel Rimbaud et les indifférents tel Verlaine. Le premier, parce que la mère n’a pas pu, su ou voulu jouer son rôle, ni trouver le murmure de l’amour qui nous lie à ce qui est, enrage et veut dresser son œuvre comme un défi ou une revanche ; le second, indifférent aux « cent sales mouches », invente la musique où le père peut seulement battre la mesure. Les uns partent d’un refus désespéré ; les autres, d’une adhésion désolée.
(Trouver derrière le mot, capter le passé, le surprendre – citation d’Yves Bonnefoy).
Le langage est aussi le moyen de retrouver le monde perdu. Chaque beau vers est pareil au pavé des Guermantes où trébuche le narrateur de Proust et nous rend le temps perdu. Il sait pénétrer les plus secrets abîmes pour les rendre à la lumière du monde et à la joie d’être au monde. Voici un exemple récent. Je suis très vieux, je suis très seul, je suis très triste. Je tombe par hasard sur ce vers de Bonnefoy :
Un vent bouge sans bruit dans les bruits du monde…
et me voilà comme au plus beau jour, prêt à pleurer de joie. Le téléphone sonne ; je réponds ; écoute certaines phrases ; en prononce ; raccroche. Je soupire :
« Ah que c’est bien ‘un vent passe sans bruit dans les bruits du monde’ ».
C’est beau encore, mais on dirait que le charme s’est évaporé. Tout passe, rien ne dure, et j’étais sur le point de me résigner, en me citant pour me consoler la plainte du duc mélomane de Shakespeare : « Tis not so sweet now as it was before » quand je me suis repris : « Mais non imbécile (c’est de moi que je parle et à moi) : Un vent bouge sans bruit… » et de nouveau me revoilà heureux. Qu’y avait-il de si différent entre « bouge » et « passe » d’autant plus que (entre nous) un vent passe plus qu’il ne bouge.
Alors je commis le péché contre lequel je n’ai cesse de mettre en garde : le péché d’analyse. L’ennui est que qui cherche trouve. J’ai trouvé. Je me suis identifié au vent qui bouge. J’ai compris le bonheur de bouger seul sans bruit. J’ai écouté les bruits du monde, encore lointains, qui m’attendaient, heureux dans ce paradis originaire au-delà de la mémoire et de l’oubli comme en deçà de la naissance que je rechercherai. Oublions « l’explication », toutes sont grossières et toutes mensongères parce qu’un beau vers est et que ce qui est ne s’explique pas.
Un vent bouge sans bruit dans les bruits du monde. Nous voilà, comme par chaque beau vers, reconduit au jour le plus radieux de l’histoire du monde : le troisième, me semble-t-il, jour mythique mais nécessaire quand, selon la Bible, Adam nommait les créatures qui partageaient avec lui le présent, ce jour où le monde et l’Esprit firent alliance, où, devenue création non pas de Dieu sans doute mais d’une divinité plus proche, intime et combien plus mystérieuse, la vie, ardente, générale, jusqu’aux cristaux et aux pierres, accepta le baptême de l’Esprit pour une alliance qui durera aussi longtemps que l’un et que l’autre.
Alliance toujours menacée par un monde parallèle fait de mots paresseux, vaniteux, qui s’aiment si bien eux-mêmes qu’ils en oublient l’alliance, préfèrent jusque dans l’amour un peu sot d’Orlando ou suicidaire de Roméo, que Bonnefoy a dénoncés, l’exaltation de la passion au dur labeur d’aimer ─ non « for ever and a day » mais jusqu’à « the last syllable of articulate time ». Rien de plus simple que la poésie. Dites-moi Bonjour de telle sorte que tout soudain, je sens qu’il est jour et que c’est bon. Dans l’inépuisable et glorieuse réserve des mots des hommes ─ saint langage ─ trouver le mot qui fait épanouir la fleur et chanter son parfum : rien de plus difficile. Il faut un poète : Yves Bonnefoy !
Jean BLOT
11.05.2016
Sur un alexandrin d’Yves Bonnefoy
pour Yves Bonnefoy
Le plus beau poète de notre temps, celui qui paraît destiné à parler de nous aux siècles à venir n’a jamais cessé, alors qu’il lui devait ses pouvoirs, de prévenir contre les pièges du langage. On comprendra que ce n’est pas sans crainte que je viens le contredire. Il le faut : à chacun sa vérité. Et la Vérité n’est peut-être que leur somme.
À chacun, sa vie. L’exilé que je suis ─ Juif en chrétienté, Russe en France, Français en Angleterre, Anglais en Amérique ─ ne doit son salut qu’au langage. Par les langues qui le composent, je fus partout chez moi, chacune, par un accent, une nuance, une exigence, me livrant la clef de la porte où je frappais. En les écoutant, je ne les ai apprises que comme l’on fait d’une musique ; il me semblait chercher, bientôt découvrir en moi, l’étranger, bien moins qu’un caractère, plutôt comme une humeur ou un point de vue. On l’adoptait sans effort. On le quittait de même. Loin de porter atteinte à la personnalité, il permettait de le découvrir et lui donnait le moyen de s’exprimer. On jure mieux en anglais ─ « Shit » ; on refuse mieux en français ─ « Ah, non ! » ; on accepte plus facilement en russe ─ « Tak i byt ». Ce ne sont que moyens et l’essentiel de soi demeure inchangé, aussi fuyant et omniprésent que l’air que l’on respire. C’est un chemin vers l’autre, mais tout chemin vers l’autre est un chemin vers soi.
C’est d’une autre langue assurément que parle le poète ! Pas tout à fait pourtant. Pour me prendre de nouveau en exemple, bien à regret, s’il m’est aussi difficile de m’identifier à un pays que de le considérer étranger, le français est ma patrie. C’est par lui que je suis au monde, c’est en lui que je me cherche. Je n’ai rien senti, rien compris tant que je ne l’ai pas formulé en cette langue. En elle, je cherche aussi bien ma pensée que l’être du soleil sur un étang qui dort, ou la tourmente d’un linge dans le vent. Seul le français me donne accès à ce pays que le poète a nommé l’Autre patrie ; lui seul me conduit vers ce qui est. Par lui, j’ai traversé l’enfer fascinant de la psychanalyse ; il m’attendait tel le ciel étoilé attendait Dante à l’issue du périple. Quandje me suis mis en mots, que j’ai pu baptiser mes angoisses et les réduire en les ramenant au grand jour du langage, apprivoisant mes monstres en les nommant par des mots de tous les jours et en les reconduisant ainsi, apprivoisés, désarmés, parmi les hommes, dans leur société. Le tigre des cauchemars, par le simple mais douloureux baptême, était devenu un chat, capable de griffer cruellement encore, mais domestiqué. À la sortie de l’enfer complaisant de l’analyse qui m’avait ramené parmi les hommes, attendait, pour seule étoile, la banalité. Le séjour dans mes bas-fonds m’avait reconduit parmi les hommes, mais dans un monde désenchanté. Banalisé ? Peut-être pas.
La puissance du baptême dans l’exorcisme des monstres m’avait conduit à chercher partout le Yin et le Yang et à reconnaître dans le langage une double nature où le pouvoir paternel et l’amour maternel se trouvaient confondus. Il y avait deux langages : celui indicatif de la conquête ; celui poétique de l’amour. Celui-ci cherchait la plus grande proximité aux choses et aux êtres ; celui-là s’élevait vers l’abstraction, quitte à réduire le monde en signes pour le comprendre et le mieux dominer. Le langage paternel promettait le pouvoir ; le langage maternel, le bonheur. On ne peut dominer sans connaître, ni connaître sans baptiser. On ne saurait aimer sans identifier, ni identifier sans baptême. Plus complète l’identification et plus grand l’amour. Plus parfaite l’abstraction et plus aisée, complète, la domination. Quand je dis « Passe-moi le sel », il est certain que je ne reconnais ni le miracle de l’existence d’un autre qui me comprend et peut m’aider ni celui de cristaux venus des mers pour donner goût à l’aliment. Peu m’importe l’origine du sel et, pour ce moment au moins, l’identité de celui auquel je le demande. Seule compte ici l’action. Le langage du père peut avoir sa beauté. Elle réside dans l’adéquation ─ « Veni, vidi, vici » de César en est le meilleur exemple. On ne sait ni d’où il est venu, ni où il est ; on ignore ce qu’il a vu et ceux qu’il a vaincus. L’important était de vaincre et de le faire avec la plus grande économie dans l’action et l’expression. Cependant la pauvreté de ce pouvoir est suffocante. Du voyage, de l’Orient, du carnage, il ne reste que trois mots.
Contre ce drame et pour défendre le langage vrai, celui de l’expression, il est deux types d’hommes : les innocents et les coupables. Les premiers sont poètes ; prosateurs les seconds. Ceux-ci craignent le courroux paternel et maquille leur trahison en miroirs d’actions. N’est-ce pas les servir que de leur donner leur image ? Ceux-là reprennent le langage pour le rendre au monde, à l’amour, à la mère ─ à ce qui est. Parmi les innocents, il y a les rebelles, tel Rimbaud et les indifférents tel Verlaine. Le premier, parce que la mère n’a pas pu, su ou voulu jouer son rôle, ni trouver le murmure de l’amour qui nous lie à ce qui est, enrage et veut dresser son œuvre comme un défi ou une revanche ; le second, indifférent aux « cent sales mouches », se réfugie dans la musique où le père peut seulement battre la mesure. Les uns partent d’un refus désespéré ; les autres, d’une adhésion désolée.
(Trouver derrière le mot, capter le passé, le surprendre – citation d’Yves Bonnefoy).
Le langage est aussi le moyen de retrouver le monde perdu. Chaque beau vers est pareil au pavé des Guermantes où trébuche le narrateur de Proust et nous rend le temps perdu. Il sait pénétrer les plus secrets abîmes pour les rendre à la lumière du monde et à la joie d’être au monde. Voici un exemple récent. Je suis très vieux, je suis très seul, je suis très triste. Je tombe par hasard sur cet alexandrin de Bonnefoy :
Un vent bouge sans bruit dans les bruits du monde…
et me voilà comme au plus beau jour, prêt à pleurer de joie. Le téléphone sonne ; je réponds ; écoute certaines phrases ; en prononce ; raccroche. Je soupire :
« Ah que c’est bien ‘un vent bouge sans bruit dans les bruits du monde’ ».
C’est beau encore, mais on dirait que le charme s’est évaporé. Tout passe, rien ne dure, et j’étais sur le point de me résigner, en me citant pour me consoler la plainte du duc mélomane de Shakespeare : « Tis not so sweet now as it was before » quand je me suis repris : « Mais non imbécile (c’est de moi que je parle et à moi) : Un vent bouge sans bruit… » et de nouveau me revoilà heureux. Qu’y avait-il de si différent entre « bouge » et « passe » d’autant plus que (entre nous) un vent passe plus qu’il ne bouge.
Alors je commis le péché contre lequel je n’ai cesse de mettre en garde : le péché d’analyse. L’ennui est que qui cherche trouve. J’ai trouvé. Je me suis identifié au vent qui bouge. J’ai compris le bonheur de, seul, bouger sans bruit. J’ai écouté les bruits du monde, encore lointains, qui m’attendaient, heureux dans ce paradis originaire au-delà de la mémoire et de l’oubli comme en deçà de la naissance que je rechercherai. Oublions « l’explication », toutes sont grossières et toutes mensongères parce qu’un beau vers est et que ce qui est ne s’explique pas.
Un vent bouge sans bruit dans les bruits du monde. Nous voilà, comme par chaque beau vers, reconduit au jour le plus radieux de l’histoire du monde : le troisième, me semble-t-il, jour mythique mais nécessaire quand, selon la Bible, Adam nommait les créatures qui partageaient avec lui le présent, ce jour où le monde et l’Esprit firent alliance, où, devenue création non pas de Dieu sans doute mais d’une divinité plus proche, intime et combien plus mystérieuse, la vie, ardente, générale, jusqu’aux cristaux et aux pierres, accepta le baptême de l’Esprit pour une alliance qui durera aussi longtemps que l’un et que l’autre.
Alliance toujours menacée par un monde parallèle fait de mots paresseux, vaniteux, qi s’aiment si bien eux-mêmes qu’ils en oublient l’alliance, préfèrent jusque dans l’amour un peu sot d’Orlando ou suicidaire de Roméo l’exaltation de la passion au dur labeur d’aimer ─ non « for ever and a day » mais jusqu’à « the last syllable of articulate time ». Rien de plus simple que la poésie. Dites-moi Bonjour de telle sorte que tout soudain, je sens qu’il est jour et que c’est bon. Dans l’inépuisable et glorieuse réserve des mots des hommes ─ saint langage ─ trouver le mot qui fait épanouir la fleur et chanter son parfum : rien de plus difficile. Il faut un poète : Yves Bonnefoy !
Jean BLOT
06.05.2016
Vie et mort des Nations
par Alain PONS
Giambattista Vico est l’un des maîtres penseurs du siècle des Lumières et de l’Occident. Il est ou était mal connu en France. C’est le grand mérite du philosophe Alain Pons d’avoir consacré son œuvre à Vico, de l’avoir traduite dans une excellente traduction qui fut couronnée par le Grand Prix de la Traduction de la Société des Gens de Lettres, de l’avoir commentée, expliquée, de l’avoir mise, et gardée, au centre de son travail philosophique, comme le démontre le livre qu’il publie aujourd’hui : Vie et mort des Nations.
Le titre même indique la justesse des prémonitions qui conduisirent Alain Pons à placer Vico au cœur de sa réflexion. Il n’est, en ce début de siècle, aucun concept, aucune réalité politique plus brûlante au sens figuré, mais aussi le plus concret du terme que celui de Nation. En Europe, elle paraît refuser de mourir et ne cesse d’opposer des obstacles à la réalisation de l’unité souhaitée. En Afrique et au Moyen-Orient en revanche, elle paraît incapable de s’imposer et de réunir ceux que la religion, ses sectes, le passé tribal ou les origines séparent. Les temps modernes, à la suite de l’Amérique, ont découvert les difficultés et la nécessité du Nation building et se sont vu contraints de forger ce terme bientôt utilisé en toutes langues pour nommer et organiser leur politique internationale. C’est dire l’actualité et l’intérêt que présente le livre d’Alain Pons pour nous, une opinion en désarroi à laquelle on n’offre, pour occuper ses loisirs et détendre ses nerfs, que l’indignation ou des excuses.
Les Principes d’une science nouvelle relative à la nature des Nations, publiée en 1744, est une œuvre difficile, apparemment contradictoire, et il y faut tout le talent et la culture de Pons pour l’apprivoiser. C’est aussi, et c’est là son intérêt, que, pour citer son analyste, elle peut paraître l’œuvre « d’un humaniste attardé, effrayé par l’esprit moderne » du siècle des Lumières. Cette situation le rapproche de notre temps qui, comme Vico au milieu du XVIIIe siècle, met en cause la rationalité scientifique triomphante et cherche avec inquiétude pour la compléter ce qui la précède et ce qui l’excède. C’est sans doute pourquoi la partie négative de la thèse de Vico paraît la plus convaincante. On peut s’étonner qu’il se donne pour exemple un couple bien singulier formé par Platon et Tacite. Vico explique que le premier pèche par l’oubli des réalités vivantes, le second par la négation de l’idéal qui les anime. C’est par leur fusion que l’on peut découvrir ce qui est commun à tous les hommes dans les formes politiques divers qu’ils ont choisies et comment chacune a été engendrée par une même humanité. Platon veut la vérité intemporelle alors que ¬ et c’est là une intuition fondamentale de Vico souvent reprise après lui ¬ c’est dans le temps qu’elle est engendrée. Le mérite de Grotius est de l’y avoir cherchée pour instaurer un droit naturel comme antérieur à la vie politique et destiné à l’orienter. Vico développera cette vision du Droit considéré comme l’incarnation de l’Idéal et le moyen de son insertion dans l’histoire. Il la corrigera en démontrant que ce Droit ne pouvant être spontané relève non de la Raison, mais de la divine Providence.
L’intervention de celle-ci évoque celle qui, selon Saint Augustin, est nécessaire au salut de l’âme. La voilà nécessaire au salut des Nations, mieux, à leur formation, que Vico présente comme la synthèse historique de la réalité des peuples et de la volonté de Dieu.
Contre les Stoïciens, la science nouvelle que Vico va fonder, aura pour objet la vie collective dans sa réalité mouvante ; contre les Épicuriens, elle refusera de s’abandonner au hasard ou de confondre l’utile et le juste. Contre Hobbes, elle affirmera la sociabilité naturelle de l’homme ; contre Spinoza, elle refusera de la limiter aux échanges constitutifs d’une « société de marchands » fondée sur la seule utilité Contre Descartes, la science nouvelle cherchera et observera l’homme dans l’histoire et non dans « toutes les bibliothèques du monde ».
En revanche, la science nouvelle de Vico restera à l’écoute du Droit, engendré par la Justice issue de la divine Providence, sans cesse réinterprété par les jurisconsultes qui veilleront à ce qu’elle soit préservée par son adaptation et protégée par celle-ci. Contre Grotius, Vico, anticipant sur une préoccupation majeure de nos penseurs modernes, refuse la Raison pour origine de ce Droit naturel, au profit de la coutume. C’est elle qui est l’expression de la justice inscrite dans l’homme naturel par la divine Providence. La diversité des formes qu’elle revêt ne doit pas tromper sur son unité profonde. Elles sont élaborées par un sens commun identique dans ses Variantes issues ou imposées par le circonstanciel. Ici encore, cette adaptation, loin de porter atteinte à son unité profonde, la garantit. Le sens commun, et son enfant, la coutume ne changent que pour ne pas changer dans le cours de l’histoire. L’erreur de Grotius est d’avoir confondu la nature et son étape rationnelle et d’avoir ignoré l’universalité du sens commun qui s’exprime par la coutume. Il faut, au contraire, pour l’étudier, remonter à son origine.
D’origine providentielle, il est formé par la nécessité de la survie des individus et des peuples et par l’utilité qui va permettre le développement et ouvrir l’avenir. Le droit qui doit assurer l’une et l’autre emprunte à la raison, mais aussi à l’autorité instituée par le sens commun, pour s’imposer : c’est le droit volontaire. Par lui, un guide nouveau va apparaître dans la conscience pour la guider dans la Société, pour assurer son ancrage temporel : le certain. C’est lui qui génère et maintient la société. Il n’en est pas sans lui. La certitude des lois n’est pas la vérité. Tout au plus, elle l’annonce et donne en même temps la nostalgie inapaisable du vrai. La certitude rend l’action sociale possible et garantit la valeur des engagements. L’art d’accorder le fait au droit, le droit au fait, ne rejoindra la vérité qu’au bout du processus historique, dans une étape qui préfigure le Dimanche de la vie de Hegel.
Cette évolution sera guidée par la Providence. Vico, tout en respectant la Bible, la Genèse, n’hésite pas à l’adapter à sa propre mythologie qui ne manque ni de vigueur, ni de saveur. Le péché originel conduit à la corruption qui ne peut être levée que par le déluge. Après ce désastre, il ne reste plus que des géants sauvages, réfugiés dans la montagne et ses forêts, qui découvrent Dieu dans la colère du ciel, les éclairs de ses orages. Pons cite le Stace qui, dès le premier siècle de notre ère, annonçait : « Primus in orbe deos fecit timor ». La peur avant toute chose, mais c’est l’une des originalités de Vico que d’affirmer le rapport dialectique du Bien et du Mal, utilisé par la Providence. Celui-ci se retrouve au service de celui-là. L’erreur de l’orage allait guider l’homme vers la recherche de la certitude avant tout dans la sexualité ¬ dont le contrôle est au fondement des sociétés et mène le sauvage au besoin de certitude, à commencer par une femme certaine, enfantant des enfants certains, pour la fondation d’une famille, d’une gens, d’une République. Ce chemin est dicté au sauvage par l’instinct naturel qui le guide vers l’humanité, la Providence ne l’ayant pas abandonné malgré le péché originel. Ainsi, pour citer Pons : « les sauvages font irruption sur la scène philosophique et ils ne la quitteront plus. »
La marche des Nations vers l’accomplissement de leur humanité a commencé. Elle va appeler Dieu tout ce qui dépasse son entendement, mais dont elle reconnaît la réalité ou éprouve le besoin. Elle s’exprimera dans trois institutions toujours et partout observées : la religion, le mariage, l’inhumation. Cette continuité sera interrompue par l’Événement où le certain rejoint une première fois le vrai dans la naissance du Christ. L’homme retrouve alors sa nature poétique et créatrice qui va se manifester dans ses métaphores animant et sanctifiant les choses en leur prêtant visages et sentiments. Ainsi s’affirment les dons de la nature humaine : sa mémoire et son imagination : « le monde civil a été fondé par l’homme », grâce à ses facultés poétiques et dans l’ignorance des causes rationnelles. Vico cite Tacite : « fingunt simul creduntque ». « Ils imaginent et, en même temps, ils croient ce qu’ils ont imaginé. » Ensuite, ils créent ce qu’ils croient. Sur ce chemin guette la décadence que Vico nomme « la barbarie de la réflexion » où l’homme croit se suffire. Ce fut la chute de Rome. Toute l’œuvre de Vico indique qu’il redoute le retour de cette Barbarie dans le siècle des Lumières.
L’histoire des Nations est celle du genre humain. Comme l’homme, elles naissent, se développent, parviennent à l’acmé, entrent en décadence et meurent. En bon Latin, Vico cite l’exemple de l’empire romain, oubliant tout à fait qu’il déménage à Byzance où il survit dix siècles avant de revenir avec la Renaissance en Italie. Ce serait admettre que la civilisation ne meurt pas et qu’elle n’a pas besoin d’un déluge pour renaître. Ce serait surtout porter atteinte à la belle construction de Vico et aux étapes d’une histoire idéale universelle qui, au-delà des diversités dues au climat, aux langues, aux circonstances, conduit la nature humaine à se réaliser dans la Vérité ¬ quand tout et tous, dans une société, sont au service du nécessaire et de l’utile. On traversera, après le déluge, les géants dont les plus faibles se réfugient chez les plus forts pour former une République qui devra se défendre contre ceux qu’elle tient en servitude. On doit à cette interprétation une vision très originale des Prétendants de l’Odyssée à la main de Pénélope qui ne sont, selon Vico, que Plébéiens révolté, mais aussi un relativisme moral ¬ une éthique pour chaque étape de l’histoire ¬ plein d’intérêt par les liens qu’il promet entre langage et régime politique, les mots, leur usage et la formulation des lois.
La décadence paraît inévitable mais un Ricorso est ouvert à l’humanité. De nouvelles Nations vont naître qui repasseront par les mêmes étapes, de la Barbarie à l’acmé de la monarchie. Pourtant, comme dans une belle formule, l’écrit Alain Pons, « Il peut y avoir du nouveau dans l’éternité ». Le processus éternel de Vico qui conduit par les mêmes étapes à la réalisation de la Nature humaine dans et par les Nations, s’ouvre pourtant à un espoir de dépassement. Sur le modèle des ligues suisse ou néerlandaise, une ligue européenne est évoquée.
On ne saurait rendre compte dans un article de toute la richesse de l’œuvre de Vico, née de tous les mérites de sa lecture et interprétation par Alain Pons. On doit saluer en Vico, sinon le père, au moins l’un des pères de la philosophie de l’histoire. Elle se complète par la situation particulière, intermédiaire qu’elle occupe et que Pons définit « comme un humanisme effrayé par l’esprit moderne qu’il a engendré ». Il y voit, outre l’annonce des thèmes qui fonderont la sociologie, une tentative héroïque pour surmonter les fractures entre la pensée humaniste héritée de l’Antiquité et la chrétienté en montrant l’accueil qu’elle avait réservé à l’héritage, inspirée par la crainte de Vico ¬ qu’il est le premier ou l’un des premiers à exprimer et dont il est inutile de souligner l’actualité ¬, de la déshumanisation de la société sous l’influence des sciences naturelles. Vico a montré comment l’homme a réalisé dans le temps sa nature et comment les hommes ont construit par les institutions de la Nation leur humanité. Et Pons s’interroge : faut-il renforcer le lien national ou le dépasser ?
Pour nous, si l’on ose prendre la parole, la réponse est évidente. Comme Caillois l’affirmait contre Paul Valéry : si les civilisations étaient mortelles, nous ne le saurions pas. Le mouvement civilisateur dépasse le cadre national et demeure indépendant des formes sociales qu’il traverse. N’est-ce pas déjà un abus que de considérer l’empire romain comme une Nation, alors qu’il se veut, se dit ¬ urbi et orbi ¬ le monde ? Surtout, cette œuvre de Vico, aussi admirable qu’elle soit, paraît construite sur un contre-sens. Nous savons, depuis Aristote, et sans doute avant lui, que l’homme est un animal politique, c’est-à-dire qu’il appartient à une espèce grégaire. Le troupeau, la meute sont à l’origine et non si bien organisés, soient-ils par Marx ou Hitler, à son acmé. La marche n’est pas vers la termitière, mais vers la personne. Le droit est entièrement voué, naturel ou volontaire, à son émancipation. Il est droit de l’homme et non des hommes et n’est celui-ci que comme obligation de respecter celui-là. De plus, il est bien singulier dans la tradition judéo-chrétienne de faire découvrir Dieu dans la foudre de la Nature et non dans le murmure de la conscience. « Au commencement était le verbe », écrit Saint Jean et, six siècles auparavant, le Deutéronome avertissait : « Une parole, rien qu’une parole. » La religion réunit des solitudes mais, pour les mieux respecter et dans la prière, l’homme est seul, entouré d’autres hommes seuls, pour s’adresser ensemble à Dieu. La personne, et non la Nation, est la réalisation de l’humanité de l’homme. Ceci ne diminue en rien l’originalité et l’importance de l’œuvre de Vico, son mérite comme tentative de philosophie de l’histoire, son actualité comme reflet ou prémonition du doute postmoderne de notre modernité. Pour découvrir ses mérites, la beauté poétique, l’ambition admirable de l’œuvre de Vico, pour s’en convaincre, il suffit de lire Vie et mort des Nations d’Alain Pons. Mais il le faut.
Jean BLOT
16.01.2016
La Grèce : toujours et aujourd’hui
par Yannis KIOURTSAKIS
(Éditions La Bibliothèque)
Jouer l’Europe sans la Grèce serait jouer Hamlet sans le prince du Danemark. L’intrigue en serait simplifiée, je l’accorde. Elle perdrait de son intérêt, on en conviendra.
La centralité d’un petit pays, ruiné par les guerres étrangères et civiles (la Grèce, aujourd’hui), situé à la périphérie d’un continent dont il est le cœur (la Grèce éternelle), est un paradoxe aussi douloureux pour la nation que pour son citoyen Yannis Kiourtsakis, qui a vocation de parler de cette douleur et de cette grandeur comme l’a montré sa trilogie dont les deux premiers volumes, Le Dicôlon : une histoire grecque et Double exil, ont paru en français chez Verdier, où une interrogation scrupuleuse de l’intimité fait découvrir, au-delà du Moi profond, une identité plus profonde encore dans le Nous national. Sa connaissance parfaite de notre langue et culture, comme le démontrent ses essais écrits directement en français, recueillis ici sous le titre de La Grèce : toujours et aujourd’hui, fait de lui, pour nous, le meilleur héraut de cette Grèce actuelle et éternelle.
Éternelle ? « Écoute Israël, l’Éternel est ton Dieu ». À cet appel de l’Esprit, à cette mise en demeure de libérer l’homme, par l’exode, de la matérialité, de la Nature, l’oracle de Delphes, quelques siècles plus tard, oppose son conseil de « connais-toi, toi-même ». Là est la mesure de toute chose puisque, de toute chose, l’homme est la mesure. Contre le spiritualisme exacerbé du Judaïsme, contre son dualisme sans compromis, la Grèce cherche à opposer l’unité du Cosmos et à découvrir une harmonie de matière et d’esprit. Platon, dans le Timée, rappelle que, si l’on n’avait pas vu les étoiles, on n’aurait rien pu en penser. Le Talmud promet, au contraire, l’anathème à celui qui s’arrête pour regarder un bel arbre ─ tant la beauté de la nature est dangereuse pour l’esprit. « Aime ton prochain comme toi-même » enseigne le Lévitique (19:18) parce que, fait à l’image de Dieu, il est la seule présence (toute image étant interdite) divine ici-bas. Plotin, en revanche, s’étonne et s’indigne que l’on puisse éprouver un sentiment de fraternité pour les plus misérables des contemporains, et le refuser à la splendeur de la nuit étoilée. Le Christianisme, on le sait, a cherché à faire une synthèse explosive, toujours menacée et d’autant plus ardente, de ces deux visions fondamentales antagonistes et complémentaires.
D’où la première difficulté d’être Grec aujourd’hui, puisqu’il lui faut savoir concilier les héritages opposés, Athènes et Byzance. Un seul exemple de l’abîme à franchir : l’Antiquité a chargé le corps humain d’esprit par la beauté de l’incarnation. Byzance est parvenue au contraire ─ avec l’aide du Fayoum et de son message de l’au-delà ─ à représenter l’incorporel, le spirituel et à rendre physiquement présente le métaphysique. Le climat et son décor jouent à rappeler le dilemme par ses saisons : un été brûlant de vérité antique ; un printemps frémissant, par ses fleurs et son coloris, de l’espoir byzantin. Avant de quitter la Grèce éternelle, nous faire place, printemps comme été, à la beauté grecque, Kiourtsakis la connaît, elle et son danger. Devant elle qui commande, l’on ne peut, à la fois comblé et désarmé, que se laisser emporter en renonçant à soi-même.
Suivent quatre siècles du silence de l’empire ottoman, l’un des plus intelligents et corrupteurs ─ le plus cruel aussi ─ de tous les impérialismes (à son côté et en comparaison, l’anglais et le français font figure de soldats de l’armée du salut). Il décapite l’élite en nommant ses représentants aux plus hauts postes dans d’autres parties de l’empire. Il intègre la jeunesse dans son armée. Assurant ainsi son pouvoir, il perçoit le tribut et laisse volontiers une marge cultuelle et culturelle de liberté sans en mesurer les dangers. Si la Grèce a pu ressusciter, c’est par sa langue, même devenue méconnaissable ; c’est grâce à sa religion, même si, exilée de ses basiliques de marbre triomphales de Constantinople et Salonique, elle avait trouvé cachette et refuge dans des chapelles chaulées, perchées sur des éperons rocheux pour mieux protéger la semence du renouveau. Cependant, à l’abri de la modestie populaire, dans ses fêtes et son théâtre se développait une culture populaire, de celles auxquelles Bakhtine a rendu ses lettres de noblesse et Kiourtsakis y consacra une partie de son œuvre et de sa vie. Ici, une première fois, son originalité s’affirme. Car il épouse cette culture, ni curieux, ni patriote, ni savant, mais comme si elle détenait le secret de sa personnalité et du sens de sa vie. On s’en persuadera en lisant son bel essai sur le théâtre d’ombres, si ardent et engagé que l’on dirait que, tel Œdipe, Karaghiozis détient le secret de l’énigme que pose au Grec la Grèce ─ et lui-même, par Kiourtsakis, confondus. L’oracle de Delphes, porte-parole et espoir de l’unité hellénique, recommandait à chaque Grec de se connaître lui-même. Karaghiozis, dans son indomptable vitalité, dans sa liberté carnavalesque, en est un visage que Kiourtsakis interroge dans l’espoir de trouver en lui une image de la permanence de son pays et l’originalité de son propre destin. De fait, il trouvera dans Le Dicôlon, portant toujours son frère mort sur son dos, une admirable métaphore du deuil qui devait longtemps dominer sa sensibilité.
Donc, il n’est pas facile d’être Grec ! Ni toujours, ni aujourd’hui. Si cette difficulté est spécifique, elle s’inscrit pourtant dans la généralité. Être Français ? Mais quoi de plus Français spécifiquement que de Gaulle si ce n’est Édith Piaf ? Que Pascal si ce n’est Marivaux ? Que Jaurès si ce n’est Pétain ? Quoi de plus Français que Bossuet si ce n’est Le Canard enchaîné ? Où chercher ce français pourtant idéal que l’on porte en soi et qu’on aimerait rejoindre. Cette difficulté commune, la Grèce et son citoyen y participent comme tous ou chacun. S’y ajoute le chaos d’une histoire, qui porte le pays des sommets impériaux aux bas-fonds de l’esclavage, bouleverse sa géographie ─ elle est tantôt en Europe et, comble de paradoxe, tantôt en Asie ─ sa démographie ─ dépeuplée, les Byzantins chercheront à y installer les Slaves, les Ottomans à y établir les Turcs. La résurrection même fut inspirée par le romantisme européen qui découvrit combien la Grèce lui était nécessaire, plus que par une réalité intérieure, celle-là même que Kiourtsakis redécouvre encore dans la poignée de main d’un berger ou le chant d’une paysanne. Le choc fut douloureux. Lord Byron y perdit sa fortune et sa vie, désespéré par les querelles des chefs de guerre et de libération autochtones. On impose au pays des rois et une élite allemande, puis danoise. Cependant, les guerres se déchaînant dans la péninsule, la Grèce de toujours se retrouvait prisonnière d’un destin balkanique.
Elle demeurait elle-même pourtant. Dans l’un de ses plus beaux essais, Kiourtsakis montre le mérite de cette langue enfouie mais toujours présente sous les parler du jour, et comment elle fit le salut de son pays tout en ranimant l’Occident. « Honneur de l’homme, Saint Langage » disait Valéry : jamais cet honneur et cette sainteté ne furent plus évidents. Cette langue n’est plus celle de Platon et Aristophane, de Sophocle et Aristote, mais elle en a si bien gardé le souvenir, son rapport au monde, sa conception de la vie, que son présent est tissé dans la toile du passé. À travers elle, on l’entendait assez pour nourrir et orienter aussi bien l’âme collective que l’âme privée, l’avenir personnel que le destin national. Notre auteur va « d’émerveillement en émerveillement devant tous ces mots transparents qui s’obstinent à montrer, derrière leurs significations multiples et changeantes, leur racine permanente, leur sens premier, l’idée force qui les a engendrés et qu’ils continuent d’incarner. »
Elle dit au Grec son âme, à l’homme son humanité. Sans doute, pour la connaître dans sa force et sa générosité, Kiourtsakis aura dû faire le détour de New York ─ et y découvrir le paradoxe d’une non-Europe peuplée d’Européens. Là, il comprend la Grèce « en tant qu’Europe » par vision du monde et manière de l’habiter. C’est par ces détours et paradoxes, seulement apparents, que Kiourtsakis verra ses deux aspirations les plus profondes ─ vers soi, vers son peuple ─ se rejoindre. C’est le chemin du roman, et non celui des sciences sociales, qui le conduira vers son identité personnelle et nationale. L’unité de ce projet de vie fait aussi l’unité de ce recueil ─ comme de toute l’œuvre.
L’apparition de Bakhtine comme guide et mentor peut surprendre. La critique de Bakhtine vise, il me semble, une période historique, la fin du Moyen-Âge, dont la Grèce est absente. Le phénomène carnaval et son esprit sont issus du peuple, de sa vitalité, de sa révolte sans doute, mais du peuple en tant que peuple et non comme gardien des origines nationales. Surtout rien n’est moins carnavalesque que les deux volumes de la trilogie et, j’en fais le pari, le troisième habité par une méditation scrupuleuse, voire acharnée, des moments qui composent une vie et brossent un visage. Plutôt que Bakhtine, j’aimerais proposer l’oracle delphique. N’a-t-il pas enseigné que se connaître est le premier devoir et si tu es Grec, tu connaîtras ─ ou peut-être recréeras la Grèce ?
Les essais sont riches en idées et analyses qui permettent de mieux comprendre l’œuvre romanesque dans son cheminement et les buts qu’elle s’est assignée. On y trouve un portrait non pas seulement de l’auteur, mais du Grec contemporain. De la Grèce d’aujourd’hui, Kiourtsakis rend compte par une interview très significative accordée au journal Le Monde.
C’est ici que nos chemins divergent. Le tableau de Kiourtsakis est sombre, proche du désespoir. Il a ses raisons et nous avons repris ici l’interview qu’il avait accordée au journal Le Monde. On pèsera ses arguments. Je ne chercherai pas à lui répondre. L’échec de la politique de la « Troïka » européenne est évident ─ comme l’était la crise qui l’avait provoquée. Distribuer les responsabilités me paraît vain et certainement au-dessus de mes moyens. Mais plus âgé que Kiourtsakis, j’ai découvert la Grèce en 1946-47, envoyé à vingt-deux, vingt-trois ans dans les groupes d’observation du Conseil de Sécurité faire rapport sur la guerre civile qui déchirait le pays. Je ne parlerai pas des crimes et violences, de toute l’horreur particulière à une guerre civile. Mais je ne peux oublier un pays grelottant, affamé, terrorisé, où le transport était assuré non par la voiture, mais par l’âne, l’éclairage non par l’électricité mais par la lampe à pétrole, et où l’eau était plus souvent dans le puits qu’au robinet ─ pour autoroute : la boue.
Je sais les chiffres du chômage, les statistiques de la misère. Je sais aussi qu’en un peu plus de cinquante ans, la Grèce a presque doublé sa population, presque quadruplé son revenu, que des millions de maisons se sont construites, que… Je ne suis pas expert, mais je puis assuré que celui qui serait venu ─ alors que nous tanguions dans nos jeeps d’ornière en crevasse, espérant contre tout espoir trouver un village où boire et manger ─ nous décrire la Grèce d’aujourd’hui aurait été considéré comme un sinistre plaisantin d’un mauvais goût extrême. Je sais que le malheur se cache, que le désespoir se tait, qu’il ne faut rien dire qui puisse les faire oublier. Mais, enfin, il y a aussi ce que je vois : une superbe jeunesse d’une incomparable vitalité, avec ce mélange d’insolence et de courtoisie gentille si grecque ; aussi chaleureux que leurs aînés mais avec dix centimètres de plus en hauteur ─ et de moins en largeur ─ l’intelligence et la gaieté dans l’œil, encombrant tous les cafés, les tavernes, les trottoirs pour bavarder jusqu’à point d’heure et roulant en voiture sur des autoroutes parfaites.
Tout n’est pas simple, je le sais. Je rappelle pourtant ─ ou j’invente ─ que lorsqu’éclata la colère d’Achille, Ulysse ─ décidément plus Grec que nature ─ courut trouver Agamemnon pour le prévenir que, cette fois, la Grèce était perdue !
Il avait tort. Alors. Aujourd’hui… Toujours.
Jean BLOT
15.11.2015
Thierry Laget
entre
le rêve et la bonne humeur
Dans les premières décennies du vingtième siècle, la boxe ameutait les foules et mobilisait les millions, comme le fait le football aujourd’hui. La corruption était plus libre puisqu’elle ne concernait que deux et non vingt-deux champions. La discrétion assurait son pouvoir. Il devint tel qu’il se perdit. Pour payer une défaite à son juste prix, il faut connaître la valeur du champion que l’on achète. S’il est faible, pourquoi perdre son argent et s’il est formidable, on ne peut trop cher payer. Seulement la corruption avait atteint une telle généralité que plus personne ne pouvait estimer ni donner son prix aux coups de poing qui s’échangeaient avec une vertigineuse rentabilité. Contre ce fléau s’organisèrent en grand secret les rencontres de Hambourg et s’affirma son jugement. Là, plus personne à vendre, ni à acheter. L’uppercut comptait seul. Ce n’étaient que trois rounds, mais, pour les professionnels, c’était assez pour établir les prix et émettre, dans le plus grand secret professionnel, avec une autorité souveraine, un verdict sans appel. Le jugement de Hambourg universel, réservé aux seuls professionnels, dictait les prix…
Loin de moi, toute idée de comparer notre pauvre République des lettres à celle de la boxe – ou même de soupçonner son intégrité. Pourtant, j’ai rêvé d’un jugement de Hambourg pour notre République. Je l’ai proposé au PEN Club à l’UNESCO. En vain. Alors, je me suis porté « juge incorruptible » ! – mon jugement de Hambourg a choisi pour champion Thierry Laget.
Comment résister à un livre qui commence par « Tel un alexandrin parfait, né sans rature, la départementale traverse le village d’un trait. » Je pourrais gloser sans fin sur cet alexandrin, sa savante spontanéité, prenant vie et densité par une métaphore subsidiaire, « né sans rature », qui le fait voir et aimer, avant de faire voir et aimer son objet : non une route mais la départementale. L’alexandrin prend une personnalité pour mieux servir celle qu’il prête à celle-ci. On pourrait citer sans fin : le style est enchanté, son intelligence séduit, sa culture éblouit. Le jugement de Hambourg va plus loin, plus profond et ne se laisse pas captiver par le charme, fût-il étincelant. Notre écrivain, peut-être notre homme, est, comme tout grand talent, fondé sur une contradiction dont les pôles opposés produisent une lumière éblouissante sur fond de nuit, où le désespoir garde le sourire et le sourire l’envie de pleurer. Cette famille rare compte un génie : Mozart. On retrouve chez Laget non pas seulement le sujet mais le rythme dans un rapport bien étrange entre le rêve et la bonne humeur.
Le monde onirique demande à être pris au sérieux. La psychanalyse le châtre et ne cesse de réduire les richesses du rêve manifeste en le prêt-à-porter du rêve latent. La réalité lui en veut elle aussi de fuir au lieu de combattre. Pindare déjà l’invitait à exploiter le champ du possible et Horace lui rappelait que c’est ici qu’est la rose devant laquelle il faut danser. On pourrait leur répondre, et l’œuvre de Laget le fait avec éloquence et grâce. Car la Rose qui est, n’est rose que par tout ce que le rêve lui prête ; le champ du possible n’est enclos que par le rêve. Il en faut pourtant convenir : réel et onirique sont en conflit ; on ne quitte l’un que pour trouver l’autre ; l’on ne chercherait pas ailleurs si l’on était bien ici. L’onirisme est l’expression d’une âme chagrine pour laquelle le réel est une grimace douloureuse qui ne fait que singer la vie vraie.
Toute autre, la bonne humeur. Bonne fille, elle dissimule, derrière ses goûts un peu vulgaires, une passion et, derrière le masque du sens commun, trop commun, une singulière ivresse. « On ignore à quels excès on peut être porté par un trop plein de bonne humeur » écrivait G.K. Chesterton. La vie craque sous le poids du rire et le chagrin s’enfuit pour cacher sa nudité. Cette humeur est dévastatrice, obligeant chacun à capituler devant ce qui est. Elle détruit l’onirisme par la sensualité. Elle interdit à l’esprit de s’absenter sous prétexte de rechercher le sens, comme si ce qui est, étant, pouvait manquer de sens. Ce n’est pas le monde qui est absurde, mais bien cette tentative de lui donner un sens autre que celui d’être ce qu’il est. Humeur magnifique, humeur vorace, rien ne lui résiste. À peine aperçue la lumière de ses yeux que le rêve s’enfuit, honteux, rêver ailleurs de ce qu’il ne trouve pas ici par manque de cœur.
On le voit, ces deux états d’âme sont inconciliables. Là où est l’un, l’autre n’est pas. Rares ceux qui savent concilier les contraires : rêver du réel de telle sorte qu’il trouve des ailes sans se renier. Le voilà devenu léger, fantasque, imprévisible avec un fou rire rentré. Plus rares encore ceux qui savent prêter au rêve la bonne humeur – ou la cruauté – de la réalité. Cette singulière alliance, si poétique et si drôle, a trouvé un champion, a révélé, par mon jugement de Hambourg, Thierry Laget.
Sa démarche est singulière : il est un zélote de ce monde-ci, mais son amour le pousse à en trouver les échos, prolongements, vérités de ce qui est dans ce qui n’est pas, mais pourrait être. On se faufile un bref instant dans le réel comme l’étincelle jaillit de deux pierres entrechoquées. Mais pas de vilains cailloux pour masquer leur laideur. Non ! De beaux cristaux… et pour les couronner.
De la vie, par exemple, de Stendhal, que Laget entreprend de conter, ne subsiste que l’intimité. Laget ne voit pas Beyle de l’extérieur, mais bien de l’intérieur, non sa réalité mais son rêve traité avec un réalisme virtuose, plein de cloches qui carillonnent, d’aventures courues, sans être trouvées, comme dans Moscou en flammes. Notre héros – tel Fabrice à Waterloo – tourne autour de l’événement dont l’accès lui est interdit par l’égotisme onirique qui le garde prisonnier et dont Laget fait une aria mozartienne. Ou bien cet éternuement qui vient interrompre un concert et son pianiste, une virtuose, pour entraîner, lui, le plus concret des phénomènes, vers un no man’s land de tendresse que l’on ne sait nommer. Ce sont deux bacheliers, une fille, un garçon, qui errent entre Amour et Distraction, comme submergés par l’avenir qui s’offre mais qui trouveront dans la Basilique où ils prennent refuge : « les cierges auxquels avant d’aller dormir les fidèles avaient confié le soin de leur oraison, mais la cire avait coulé, les mèches fumaient, les flammes vacillaient et il flottait sous ces voûtes une prière sans fin. »
Voilà une pension anglaise qui se décompose dans sa propre absurdité, mais reluit de santé dans la folie et reste joyeuse dans le chaos, ou une Italie qui n’en finit plus de résumer son âme, avec un calme étonnement : « In somma »… Ou encore la mort de la Brahmine qui prête sa blancheur livide au corps amoureux de sa suivante et à l’amour que lui fait l’étranger. « Aimes-tu mieux avoir eu trois femmes ou avoir fait ce roman ? » La vérité de l’homme n’est pas dans la réponse mais dans le fait que Beyle se pose la question. Si vous parvenez à habiter pareille pensée de Monsieur le Consul de Civitavecchia, au-delà de toute connaissance, vous le deviendrez pour un instant.
Le jugement de Hambourg est sans appel. S’il paraît pasticher le candidat dans son énoncé, c’est qu’on ne peut lire celui-ci sans être emporté par sa verve, sa bonne humeur onirique – comme le lecteur du récit qui précède, Le Chevalier à la rose, a pu le constater. Le tout sur fond de radieuse bonté.
Le jugement ? Les arias de Thierry Laget sont enchanteresses. Ses récitatifs sont éblouissants. Écoutons l’opéra.
Jean BLOT
07.11.2015
Au Portugal,
en Avril
Le bleu du ciel hésite entre Océan et Méditerranée, empruntant à celle-ci la lumière de vérité, à celui-là le rêve et l’invitation au voyage. Dans cette ambiguïté, Lisbonne paraît éperdue. Ici, la ville s’étrangle, paralysée par les voitures, affolée par les tramways qui, pareils aux suffragettes du siècle avant-dernier, ont toutes les audaces et, malgré leurs tournures obsolètes et leur ancienneté, empruntent pour monter ou descendre les angles les plus hardis. Là, à deux pas et l’instant suivant, les avenues dont les arbres préparent déjà les ombres lourdes de l’été, tapissées de mosaïques qu’inspire la nostalgie des fronts marins ─ règnent l’attente, le silence, la promesse du printemps.
Trois pas, un instant, et, de nouveau, tout monte, redescend, remonte et vient s’échouer au pied d’églises sur les places qui mendient et recueillent un peu de soleil. Cette agitation de ruelles affairées, ce silence paresseux des allées répond à l’immobilité fragile, pareille à celle qui retient les toits orangés dans leur envol vers le large. On dirait que la ville se lève anxieuse devant le Tage, dont le calme souverain, le bleu sans ride paraissent la juger, tandis que, par son estuaire démesuré, le fleuve se prépare, sans un signe d’adieu, à se noyer dans l’Océan.
Semblable aux rides d’un visage, l’histoire vient s’inscrire dans le paysage et le redessiner. L’expérience et les épreuves de l’histoire ont renouvelé le spectacle et lui ont donné son sens. C’était un matin comme celui-ci avec sa part d’ombre et de paix, de soleil et d’angoisse, il y a plus de deux siècles ─ quand la mer a hurlé, la terre a tremblé. Voltaire, dans Candide, la décrit :
« La mer s’élève en bouillonnant… et brise les vaisseaux qui sont à l’ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s’écroulent, les toits sont renversés sur les fondements… ; trente mille habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. »
Candide s’écrie : « C’est le dernier jour du monde. », cependant que Pangloss s’interroge : « Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène ? »
La raison, on s’en doute, fut difficile à trouver. Je ne sais si Voltaire rapporte, ou, je l’espère, l’invente, mais, selon lui, l’Université de Coimbra décida que « le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. »
À l’époque des Lumières, pareille réponse au cataclysme était inacceptable. La crise de conscience fut profonde, internationale et, par les questions qu’elle posait, annonçait la modernité. Avec un noble courroux, Voltaire, dans son Poème sur le désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome « Tout est bien » :
(…)
Au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes,
Direz-vous : « C’est l’effet des éternelles lois
Qui d’un Dieu libre et bon nécessitent le choix ? »
Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :
« Dieu s’est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes ? »
« Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants
Sur le sein maternel écrasés et sanglants ?… »
Stupéfait, Voltaire se heurte à l’Absurde avec la violence de l’oiseau sur la baie vitrée du réel ─ interdit à la compréhension, bute sur le défi lancé à la raison, à la justice à tout ce qui fait, protège et justifie l’humanité de l’homme. Cette interrogation ardente qui n’a ni fin, ni cesse, a trouvé en Lisbonne son lieu, son paysage. On retrouve son angoisse et son courage partout où le regard se pose, pourvu qu’il veuille s’oublier devant ce qu’il voit. L’histoire devient sensible et s’ouvre à la sensibilité.
Lisbonne est l’une des capitales de l’anthropophanie. Ici, pour la première fois, l’homme a refusé une image de Dieu qui régnait depuis trois millénaires sur sensibilité et imagination. Elle n’était pas sans mérite. Inventée par les Juifs dans le silence du désert ou l’Éternel parle sans craindre l’interruption, elle expliquait le mal et le malheur par les fautes et le péché de l’homme. De ce fait, Dieu est non seulement innocenté, mais omnipotent dans l’innocence. Il reste Dieu, expression et garantie de son peuple. Car si on peut Lui attribuer erreur, mensonge, défaite, sa divinité se défait dans l’impuissance et son peuple perdant son identité en le perdant, disparaît. Cette auto-accusation salvatrice, le siècle des Lumières ne pouvait plus l’accepter.
La révolte de Voltaire est noble. Camus aurait pu reconnaître en lui un ancêtre de ses héros. En revanche, la réponse de Rousseau, Lettre sur la Providence, n’est belle que par le style. Sans accuser directement les victimes, il fait remarquer que, si elles n’avaient pas construit des maisons de sept étages, elles n’auraient pas été si nombreuses. Les cabanes du bon sauvage les auraient protégées. La preuve de la foi de Rousseau en la Providence n’était-elle pas dans le fait que Voltaire, au sommet de la gloire et des richesses, est désespéré, alors que Rousseau, dans la misère et la solitude, est plein d’espérance. À quoi Voltaire réplique avec une impatience que l’on partage, qu’il discutera philosophie le jour venu, mais que pour l’heure, comme le disait le Marquis de Pombal, chargé de l’opération de sauvetage : « Il fallait enterrer les morts et nourrir les vivants. »
Rousseau insiste : « Vous auriez voulu », écrit-il à Voltaire, « que le tremblement se fût fait au fond d’un désert plutôt qu’à Lisbonne. Peut-on douter qu’il ne s’en forme aussi dans les déserts ? Mais nous n’en parlons point parce qu’ils ne font aucun mal aux Messieurs des villes, les seuls hommes dont nous tenions compte. » On peut reconnaître en ce texte le fondateur du gauchisme moderne dénoncé par Lénine comme « une maladie infantile ». Son terrorisme doux, culpabilisateur, est en effet issu de la pulsion névrotique infantile que la vulgate de la psychanalyse a reconnue et identifiée sous le nom de « faire chier père ».
Kant refuse « la grâce et disgrâce de la Providence ». Il cherche à expliquer les causes des séismes. Il faut éviter les chimères, les prédictions des astrologues et interroger la loi de l’attraction : « Au tribunal de la Raison, les astres ont été déchargés de l’accusation… de responsabilité dans les tremblements de terre. » Y a-t-il des remèdes ? « La hardiesse de l’homme », admirable en soi, « dépasse de très loin la capacité d’agir qui lui est assignée… En dépit de tous ses efforts, il n’est jamais qu’un homme. »
Le nom de Dieu n’est pas prononcé. Le mal et le bien, la souffrance, la justice n’ont plus de rôle dans les phénomènes naturels. La culpabilité ou l’innocence des hommes ou de la Providence ne sont pas évoquées. Aussi grande que soit la provocation morale, l’esprit scientifique ne doit rien lui céder.
On peut, on doit admirer pareille neutralité, sans oublier que c’est la colère de Voltaire, plus que l’équanimité de Kant, qui conduit l’homme à vaincre les lois qui l’emprisonnent. Une évolution décisive, malgré les nostalgies dialectiques d’un Rousseau, s’est produite dans les esprits. Le tremblement de terre de Lisbonne n’en fut pas la cause, mais la manifestation. En écartant du débat crime et châtiment, péché, justice, la conscience de l’époque avait franchi une étape décisive. Elle allait créer, pour leur accorder sa confiance, des hommes nouveaux. Le privilège de la religion et de la cléricature est ruiné. La conscience de l’humanité s’en détourne pour favoriser la formation d’une nouvelle classe digne de l’éclairer, de la guider : l’Intelligentsia.*
Lisbonne est à l’image de cet esprit nouveau. Si la tragédie dont elle fut la victime demeure inscrite dans ses murs et leur dessin, le courage tranquille qui sut la vaincre est manifeste dans son plan. L’homme nouveau, lavé du péché originel, dompte la nature par l’intelligence de ses projets. Il est réaliste, c’est-à-dire qu’il a appris à écouter la réalité et, renonçant à l’orgueil de l’échec, accepte de s’y soumettre pour la vaincre. Les maisons reconstruites se soumettent avec humilité à la limite des trois étages en prévision des secousses sismiques. En revanche, le tracé des rues, la rigueur des façades, toutes les normes établies et suivies sont dictées par la géométrie que la Raison oppose à l’anarchie de l’espace. Les églises reconstruites dans leur site ont retrouvé leur forme mais, écartées du centre dans le nouveau plan de la ville et élevées sur des hauteurs devenues périphériques, elles ont perdu leur rôle et, comme écartées de la voie royale de l’esprit, sont reléguées dans ses marges.
La ville a été reconstruite, non selon les normes et croyance de leur foi ancienne, mais selon un idéal tout humain. C’est pourquoi, par ses places magnifiques, ses arcs de triomphe, toute sa marche triomphale vers l’Océan vaincu, malgré les différences de climat, du relief, des fleuves et des gens, elle évoque Pétersbourg. Comme sa parente du Nord, elle est ville idéale en ce sens qu’elle est fille de l’idée, mais cet idéal est bien différent, presque antagoniste. Sur ses places, ne s’envolent pas des anges ; des Tsars n’y retiennent pas des chevaux cabrés. La place centrale, l’une des plus belles, des plus impériales du monde, ne porte ni le nom d’un empereur, d’un héros, d’un saint, mais bien, avec la plus orgueilleuse modestie, celui du « commerce ». Elle ne dit pas, comme le font Pierre ou la Grande Catherine, en écho à Versailles, « l’État, c’est moi ! », mieux « Toute réalité, c’est moi », mais bien, à la suite de son inspirateur, le marquis de Pombal : « L’État » et toute réalité « c’est la Raison ! ».
—————-
* Elle devait régner sur la conscience jusqu’en 1917. La Révolution communiste fut son apogée et fit sa ruine. L’absence de toute classe, véhicule et porteur de la conscience collective, caractérise notre temps.
Le marquis de petite extraction ─ a self made-man ─ ne devait titre, renom, autorité qu’à son mérite. J’aime croire que c’est lui qui, par fidélité à cette Raison, baptisa la place et la consacra à l’activité qui a fait la grandeur des hommes et leur égalité : le commerce. N’est-ce pas les revenus portuaires et douaniers de Lisbonne qui ont permis sa construction ? Le triomphe, rappelé par l’arc de la place, est le sien. Par l’échange entre les hommes, il leur promet l’humanité et les guide vers elle. Plus hardi que tous les conquérants, il s’élance ─ comme le fait la place, à lui consacré ─ vers l’horizon et l’océan, sans céder à leur grandeur, honnête, intéressé. Il signifie et propose l’échange des biens, mais tout aussitôt et, de ce fait, l’échange entre hommes. Il exige que l’on renonce à la peur que l’étranger, l’Autre, inspire, qu’on lui fasse confiance et qu’on le reconnaisse de telle sorte qu’il devienne le prochain et annonce le dimanche de la vie. La place, par sa grandeur formelle comme par la modestie de son nom, publie un idéal. Elle confie en sourdine le caractère du peuple dont elle est l’œuvre.
L’Europe se précipite vers l’océan et son grondement, si sourd qu’on le dirait un monologue intérieur. L’abbaye de Saint Joseph paraît la dernière étape, le lieu de l’ultime prière devant l’infini que le ciel ─ si discrètement bleu entre deux nuages ─ promet. Dans le cloître, la pierre chante. Les voûtes sont des voiles gonflées d’ombre, ouvragées, sculptées de telle sorte qu’elles parlent de mer, de vent léger, d’un rêve si puissant que, à Lisbonne, chacun n’est présent que pour moitié.
Les Portugais sont mystérieux. Bruns, courts de taille, ils se tiennent droit. Ils sont dignes comme les Anglais, gentils comme les… Portugais. Il est dans cette gentillesse et la courtoisie des rapports quelque chose qui en fait, non un devoir, ni une morale, mais un trait national. D’où venu ? On ne peut espérer le savoir. Il suffit de jouir de ce secret. Peuple contradictoire : la gaieté même, le sourire aux lèvres, le rire dans la gorge, ils expriment dans le Fado comme dans Pessoa ou Oliveira, une tristesse sans fond ; solaires dans le rapport et par le coloris, ils ont dans le geste une retenue toute nordique. Serait-ce que, pétris d’argile méditerranéenne, ils ont l’âme océanique ? Aussi fermement d’ici que l’est le fils d’Athènes, ailleurs les habite. Le Grec est comme paralysé, crucifié, par la beauté de midi, sa Vérité. Le Portugais a su trouver en lui-même cette ombre qui le protège et le navre à la fois. Il m’a semblé qu’elle avait trouvé son expression dans le Fado.
Curieux spectacle, il commence par l’extinction des lumières. Dans la nuit qui se fait, la guitare libérée impose le silence. Ni lui, ni le noir, ne seront plus troublés ; ils composent l’attente, assurent le milieu dont la guitare est la gardienne, pour accueillir la voix du Fado. On imagine mal qu’elle puisse chanter à midi. Je l’ai entendue pourtant une fois, dans une pousada de village. Elle paraissait égarée. C’est qu’elle exprime un monologue intime qui s’interrompt aussitôt si l’auditeur bouge ou fait du bruit. La guitare prépare une psalmodie intérieure qui ne parlera que quand tout se sera tu et que les yeux seront fermés.
Quand la voix paraît, on devine qu’elle vient de loin. Elle tâtonne pour s’assurer qu’elle a bien son espace et que, source jaillissante, elle y est seule. Libérée du joug du jour, titubant entre les guitares comme sur des béquilles, elle cherche une douleur pure. À sa suite, on prend les chemins du regret. Le vécu de midi était mensonge. Il restait à la surface du cœur.
On a aimé à midi, mais sans se comprendre et prisonnier d’une réalité objective. La lumière, la chaleur, autrui, tout spectacle, toute chose, et même l’objet de l’amour et ses mots sont autant d’obstacles auxquels l’âme se meurtrit. Il faudrait écrire comme le Fadiste chante, savoir le suivre vers la plus simple, la plus pure douleur dans sa première apparition. Le vécu du jour n’était que son ombre. Portugais, le Fado est la complainte de l’homme du midi, à l’âme océanique ; de l’homme d’Ici que l’Atlantique emporte là-bas où se trouve la houle à l’image des cieux. L’intimité ne cesse de pleurer. Là-bas, d’où « je viens… où je suis », la vie est si légère, mais toi ─ inaccessible : un nuage que le vent défait ou le souvenir qui torture et se refuse.
La nostalgie est mémoire en pleurs. On dirait que la souffrance se mire dans son reflet. Elle s’y complaît. La guitare qui entoure, soutient, emporte la voix, monte quand elle faiblit, s’efface quand elle se retrouve, se défait quand elle règne. Le Fado enseigne que la poésie est vagabonde mais prisonnière du poème qui l’a créée. Le Portugais est habité par un déchirement que le Fado raconte en un récit que, derrière le masque du projecteur, mime le visage livide du Fadiste. Blême, il se sait unique. Sa voix ─ est-elle encore à lui ? ─ ne connaît que les sommets et les bas-fonds ; elle passe du sanglot au murmure, de l’intense à l’inaudible, cherchant l’Ici de l’Ailleurs, le Présent de l’Absent, l’Impossible.
Est-ce là l’image acoustique de l’homme et de son angoisse ? Je ne comprends pas les paroles. Sur le trapèze des aigus, la voix se balance un instant, puis bondit, retombe dans les cavernes sous-marines des graves, comme si elle cherchait la libération, résolue à briser les limites du sanglot ; elle se révolte, se heurtant à un silence déchirant ou à un cri de bête blessée, ─ toute attente, toute déception. Les mains du Fadiste, cherchant à donner forme à ce qui n’est que sentiments, qu’elles trahissent dans une prière désespérée.
Fa… do…, une invite, non au voyage mais au regret de tout ce que l’on n’a pas su retenir ou comprendre et qui vous quitte. Son origine ? On le dit de haute mer venu et qu’il fut sirène de l’Océan. C’est bien au grand large que l’on regrette si bien la terre ferme, que l’homme connaît un tel besoin de la femme ─ la femme, une telle nostalgie de l’homme. J’ai deviné qu’il s’agissait toujours d’amours contrariés, de saisons où se meurent les feuilles, d’une tristesse sans espoir. Saudade, solitude et nostalgie alliées… Quand des lumières se rallument, le public se réveille comme surpris dans le rêve. On applaudit… Mais le Fadiste ne paraît pas supporter son succès et, comme pris en faute, il se hâte de disparaître et d’emporter avec lui ses confidences d’une voix intérieure qu’il a su, dans l’ombre, un instant, imposer à la nuit. On dit que Fado viendrait du latin Fatum. Sans doute à tort, mais il est vrai qu’il cherche la voix du destin qui ne parle que dans l’ombre, ne se dit que par les variations soudaines d’intensité, bondissant du silence vers le cri ─ et fuit dès que revient le jour.
L’espace. On a le sentiment de celui qui vous entoure dès l’arrivée en un lieu étranger. En Russie, en Amérique, on le sent sans fond, sans limite. En Europe, au contraire, on le devine conquis et limité, enfermé dans des mesures toutes humaines de l’histoire et de la géométrie. Ici encore, le Portugal fait exception. On se souvient de Pierre le Grand qui voulait briser une vitre, ouvrir une fenêtre vers l’Occident. Le Portugal a brisé la vitre, ouvert la fenêtre de l’Europe sur l’Océan, c’est-à-dire sur l’infini et le sublime. Il en connaît la séduction et le danger ─ oui, et même le mauvais goût. On le devine dans l’intraduisible Saudade dont l’écho va plus loin que les mots ; on l’entend dans l’incompréhensible Fado qui lance son cri, fait son silence à la limite ou au-delà de la compréhension. Au Portugal, aussi loin que l’on soit de l’Atlantique, et ce n’est jamais très loin, on ressent sa promesse et sa menace. Chaque site auquel conduit une route courtoise, admirablement tracée, signalisée, est encadré par cet infini, assiégé par lui comme par une puissance élémentaire qui, tel le raz de marée, menace et engloutit les maisons frustes au toit d’orange, aux murs virginaux.
Ainsi de Cintra. Assiégée, elle monte pour se libérer. L’espace lui est compté comme sur un navire en haute mer et, pour l’affronter, elle se veut toute terrienne, toute végétation, arbres et rochers. Aucun à-plat ne se présente. Le relief donne le vertige à celui qui découvre la ville. Voiture, plante, maison, ou passant s’accrochent aux pentes qui montent vers le nuage printanier ou descendent, comme riant, vers la plaine. Les routes sur leur flanc sont si étroites que les voitures y vont sur les pointes et que leurs conducteurs entreprennent de longues et étonnamment courtoises négociations avec ceux des voitures qu’elles croisent.
L’arbre paraît chercher dans le précipice à son côté l’orgueil et le frisson. Notre pension, presque un château, a trouvé une terrasse pour s’implanter, mais son jardin dégringole derrière elle et disparaît dans le profond des feuillages. Le salon est immense ; presque vide, l’espace et sa parcimonie. Aux vitres, des perroquets en robes vertes doublées de rouge frappent à grands coups de bec, comme pour rappeler un passé qui ne veut pas s’éteindre ─ quand eux et les paysages qu’ils évoquent faisaient partis du Portugal, non pas seulement par l’armée et la police coloniale, mais par les valeurs qui composent ─ si étroit et cependant immense ─ l’énigmatique pays.
Saudade est peut-être née là-bas d’où viennent ces perroquets. Aujourd’hui, Saudade y retourne comme pour rappeler, à l’heure de la retraite, l’ardeur et les éclats d’une vie qui avait si bien capturé l’esprit portugais qu’il hésitait au bord de ses colonies comme au seuil d’un songe. Au-delà, Cintra se lève, découpe le ciel par les créneaux de ses palais, déploie ses bois et ses prairies qui descendent vers la plaine dans un vert dont on dirait volontiers ─ si subtiles ses nuances, si diverses ses teintes ─ que résume la palette des couleurs, il compose la robe de bal de la ville dessinée pour mettre en valeur la minceur de sa taille et sa hauteur.
Les autobus stagnent au milieu des voitures. Pourtant nul cri, ni signe d’énervement. C’est Pâques, dont il est bon de fêter la nouvelle là où la nature ressuscite sous vos yeux ; là où Cintra se dresse, un bouquet d’arbres pour les noces du ciel, là où se cachent des palais blancs aux tours décorées d’azuléjos comme d’ailes pour partir vers l’azur. Au sommet, au loin, un château sombre, inaccessible, comme venu d’un conte nordique, pour surveiller, protégé par les arbres colossaux qui grimpent sur les collines qui l’entoure, Cintra, et lui rappeler ou inspirer un rêve romantique et les ombres de l’Au-delà.
Le Portugais connaît l’aventure de la vérité. Il sait qu’elle se déroule dans l’échange. Cette harmonie acquise gagne celui qui la côtoie. Bientôt naît une tristesse, comme s’il n’y avait espoir que dans la déchirure du conflit. Il en va de même du goût. Il est parfait, si naturel au Portugal que l’on ne comprend plus comment on en peut manquer. Chose, maison, plante en font preuve comme une évidence. Entre le rouge, le rose et l’orangé flottant, le toit à double pente protège la maison comme si elle était sa fille, vêtue d’un blanc qui, loin de l’orgueil silencieux de la chaux grecque, garde les chuchotements des jeunes filles dont il annonce la pureté. Quand les farandoles de maisons s’écartent, l’aquarelle pâle du paysage cherche, entre le jaune et le vert, entre la paille, le nuage et l’eau, son expression.
Sage, le Portugal est l’ennemi du sublime, de la tempête qui menace les maris, les amants, les frères, des séismes qui font trembler la terre et détruisent les villes. L’au-delà qui habite son âme, l’ailleurs qu’il respire, loin de l’orgueil et de l’éloquence du sublime, sont domptés et apprivoisés pour devenir mélancolie. Au lieu du sublime, la saudade ; au lieu de la révolte, le regret. Ce pays et son homme refusent les démesures et le cri. Mais, dans le cœur de son poète, il fera nuit. Ce refus de l’excès, de céder à son mensonge, cette volonté de rester Ici dans le quotidien et sa mesure, font courir du château sur la crête aux maisons dans le val. Le risque de devenir, tant l’excès est nécessaire à l’homme, santons, jouets, poupées.
Le lac sans rives, dont on assure qu’il est artificiel et le plus grand d’Europe, paraît un mirage déposé entre les légions de roseaux qui s’avancent… sur lui flottent les nuages dont les reflets colorent ses eaux. Il dort, étendu entre les herbes et les joncs de l’océan, plaine parmi les plaines. Son eau est un songe. Dans l’Alentejo, l’espace se développe si librement qu’on le dirait rival de l’océan…
L’eau du lac est la paix même, la sieste de la Création. Sa capitale est Evora.
Evora ! Le nom évoque la sonnerie du clairon à l’aube, un salut à Dieu, ou encore, un hymne à son hommage. En son cœur caché, à son sommet exposé, Rome règne mais à la portugaise, avec grâce et distinction. Ses quatorze colonnes rangées en un quadrilatère dont un côté a disparu ─ pour faire place à la tour de la Cathédrale et aux demeures dont les toits orangés se montrent pour dire les secrets qu’ils protègent dans un blanc muet. Rome, mais sans gravité, lourdeur ni éloquence, sans l’angoisse de l’orgueil génératrice de l’excès. Élevé en l’honneur d’Hadrien, ibérique de naissance, dédié à Diane, vierge chasseresse, le temple a la tranquillité, l’assurance, l’élégance de la déesse et de l’Empereur. L’esprit portugais, qui fréquente l’Océan et sait lui imposer la mesure et le commerce, juge et représente Rome avec une justesse de sentiment qui l’apprivoise. À ses pieds, le monastère se referme sur le mystère que la colonnade païenne désigne naïvement. Cependant qu’il médite dans le cloître soustrait à l’espace comme au temps, dans la sobriété du romand, sauf aux toits d’angle où le gothique s’annonce, la colonne de Diane s’élance, monte librement, respire avec une grâce impérieuse pour affirmer que la clef ou le sens de la vie sont au ciel. Entre leurs fûts, haut placés, sur un piédestal plus haut que le regard, des morceaux d’azur sont retenus prisonniers. Un ciel, changeant d’heure en heure, habite le temple jusqu’au soir quand une nuit, tempérée ou révélée par les illuminations, impose la lumière des projecteurs ─ et ses étoiles.
Aux fenêtres géminées, aux arcs outrepassés, les maisons en bure blanche, portant les blasons des évêques, forment une procession en route vers le vaisseau de granit de la Cathédrale. Sa nef surprend. Elle prend la hauteur du gothique mais garde la gravité du romand et l’humilité de sa prière silencieuse. Tenté, gagné par le gothique, par l’intrépidité qui l’enlève dans un vertige mystique, il a conservé l’humilité du plein cintre et la certitude rustique de sa foi. Dans l’ombre, des cierges prient, ici et là, leur flamme en mains jointes pour l’oraison, dans la solitude de l’imploration. Le bourdon, quand il sonne, est une bénédiction sous le poids de laquelle on tombe à genoux.
Des ruelles accourent échevelées, montent, dégringolent en pentes si rapides que les façades peinent à les suivre. Les voilà qui titubent, chancellent, se couchent au pied de l’église Saint Jean et de son silence. Quelques marches vous invitent à oublier la ville. On entre : le ciel est sur les murs. L’Azulejo les a envahis et leur a imposé un azur pâle et inquiet dont il a capté et gardé la fraîcheur, physique mais bientôt morale. Quand le lourd été de l’Alentejo se refermera sur la ville, la prière trouvera ici la promesse d’un printemps éternel.
Avril et ses parfums viennent soudain, on ne sait d’où, pour un instant, pour trois pas, enivrer. Evora se referme en coffret sur ses trésors. Le rempart blanc qui l’entoure interdit l’évocation, menace le souvenir. On garde une pensée pour le roi Sébastien, ni mort, ni vivant, et le récit qui situe à Evora le départ de l’expédition dont ni lui, ni son armée ne devaient revenir. On retrouvera sa légende à Monsaraz. Sur son piton rocheux, cette place forte paraît l’un de ces lieux ─ où la légende et l’histoire s’épousent et le mystique est au service de la vérité. Ville fortifiée : le blanc trompeur des maisons ─ l’une se serre contre l’autre ─ s’est réfugié à l’intérieur de remparts de granit. On évoque Nerval et ce lieu : « … où du dragon vaincu dort l’antique semence ». Chaque bâtisse ressemble à la dent dont à tout instant peut renaître un guerrier. Derrière les façades, ondoyant au rythme du terrain escarpé, les maisons, aux couleurs du nuage, nées de la gueule édentée du dragon, gardent au cœur les antiques violences.
Ici furent les Maures. Les Templiers les chassèrent. La guerre est là, sous la paix du jour, et quand le vent passe, on peut craindre qu’elle ne se réveille. Au pied de l’église, le pilori de marbre blanc, richement sculpté, paraît l’innocence même. C’est pourtant un monument à la cruauté et à la douleur des hommes, inscrites dans son marbre virginal.
On a mangé une soupe dont les poissons venaient des fonds d’une mer chaude. On a bu un vin venu des vignes dont les squelettes ─ on est en Avril ─ s’en vont vers l’horizon. Les serveuses paraissaient sortir des fabliaux, lestes à l’occasion. Monsaraz est ailleurs. Il guette des dangers anciens. Il écoute un passé porté par des légendes. Il attend une présence voilée par les années, une pensée d’autrefois. Un rêve ancien, son silence. Passe ce qui n’est plus.
Il faut écouter une voix, celle que cherche le Fado. Il faut imaginer un visage, celui du roi Sébastien (Sebastiao). Tout jeune, il partit en guerre. Le 4 août 1578, à la tête de son armée, il livra bataille à Alcácer-Quibir. Il disparut cependant que son armée et la fleur de la noblesse étaient massacrées. On ne retrouva jamais sa dépouille. On dit, on espère, que, par un matin de brouillard, il reviendra, nouveau messie, le Desejado (le Désiré), pour délivrer le Portugal ─ et chacun ─ et fonder un empire universel : le cinquième. Le brouillard se lèvera, Sebastiao apparaîtra, un sourire aux lèvres. On a prétendu que le Sébastianisme avait eu une influence ou même avait provoqué le Sabbataïsme juif né peu après la mort du roi et l’expulsion d’Espagne. Il y aurait un lien étroit entre messianisme et désastre national. Cette influence de la mystique chrétienne sur la mystique juive était le fait de nouveaux convertis (converros) dans leur solitude, ayant refusé le Juif mais sans être acceptés par le Chrétien, ou plus simplement une tentative de subversion par le fantastique dans une même conspiration du malheur.
C’était Avril, et un matin sombre. Nous venions de quitter le monastère de Jeronismos et allions pensivement vers le Tage et l’océan. On avançait dans un nuage. C’était gris et solennel. Soudain le voile se déchira en un instant et apparurent les régates réunissant cent voiliers, toutes leurs voiles gonflées par le vent de joie qui venait de chasser le brouillard. Ils volaient sur le Tage dans le soleil retrouvé. Ni Sébastien, ni le Messie, ni le cinquième empire, mais le spectacle, étant de toute beauté, annonçait cependant, comme toute beauté, le roi, le saint et leur royaume.
Jean BLOT
11.10.2015
Valéry Larbaud à Vichy
Depuis bientôt un demi-siècle, les autorités municipales de Vichy et l’Association internationale des Amis de Valéry Larbaud s’efforcent de reprendre cette ville, si belle, au mauvais souvenir d’un régime qui fait honte et d’un maréchal félon ─ pour la rendre à un beau poète, un esprit généreux capable d’accueillir aussi bien l’étranger que l’étrange de la modernité. Chaque année, l’Association publie aux Éditions Garnier les Cahiers Valéry Larbaud. Cette année 2015, le Cahier est consacré au paysage, un thème d’autant mieux choisi que Vichy, aux lourdes frondaisons, à la lumineuse rivière, au ciel chargé d’orages grondants, errant sur le Bourbonnais, est une parfaite illustration de la « force cachée », faite « d’un ensemble rapports secrets » que Larbaud évoquait pour présenter le livre de son ami Paul Deveaux, Paysages bourbonnais. Larbaud évoquait l’attente du paysage. Il devait y répondre dans son œuvre.
Ce sera d’abord le Bourbonnais, « la plus douce région de France ». Yvon Houssais, en relisant Enfantines, souligne justement l’importance de la fenêtre qui donne sur le jardin où « le premier beau soir a dressé son camp ». Au-delà, s’élève la rêverie inspiré par l’espace : l’Auvergne « aux cent montagnes ». Ces paysages toutefois, par leur éloquence, débordent cadre et décor pour entrer dans le vif du récit et lui apporter tantôt le calme, tantôt une ouverture sur « l’extraordinaire », « dans le silence des champs et la simplicité du ciel ». Comme le note avec finesse Houssais, la rêverie et le quotidien trouvent un accord qui fait le grand charme d’Enfantines.
Amélie Auzoux, dans sa belle étude, montre comment l’amour du Centre de la France et de son mystère rapproche Valéry Larbaud de Jean Giraudoux. L’un et l’autre sont associés par Thibaudet au « paysage de la valise » qu’il cherche. Ni l’un, ni l’autre ne sont des « déracinés », n’ayant jamais renié leur province, le Centre de la France dont le fût de colonne de La Celle-Bruyère marque le lien et auquel ils se sentent liés par un lien mystique. L’un et l’autre sont sensibles à l’harmonie et à l’unité de ses paysages dans leur « pittoresque sans apprêt », et veulent consacrer leur autonomie et originalité ─ de « la république des arbres », la forêt de Tronçay, chantée par Larbaud aux « ruisseaux limousins qui baignent encore » le cerveau de Giraudoux. On peut conclure, avec Amélie Auzoux, que si ces auteurs « ont souhaité avoir la Terre pour patrie », ils ont su avant tout habiter leur terre, la France du Centre. L’Albanie fera partie de cette Terre-patrie, comme le démontre Delphine Viellard. On parcourt le pays en « automobile », véhicule qui doit à Larbaud son plus flatteur portrait, pour saluer « le Tomor, monstrueusement géométrique », le paysan « à la tournure si intègre », ou renier des villes qui n’ont pas trouvé leur style. Elles ne sont pas parvenues à intégrer ce monde de « vie réelle » que le poète voulait prendre dans ses bras, asseoir sur ses genoux, dont parle si bien Frédéric Roussille dans son Image et accès au monde. « Les machines sont encore enchantées », écrit-il, et ruinent la réalité. Le besoin d’une présence taraude le poète, tandis que ses hantises voilent sa perception et que « l’on se trouve comme enfermé dans le jardin de vagues impressions subjectives ».
À ce lien au réel, à cette gravité de la poésie, Christine Kossaifi oppose « l’immense fable du monde » servie par un sfumato proche du Léonard, qui estompe les formes. Ce sont « fulgurantes évanescences » qui aiguisent d’autant mieux l’appétit du voyageur que c’est leur forme même, en évanescence, qu’il promet au regard « gardant la conscience en éveil par le sanglot d’une interrogation ». La touche impressionniste accueille rythmes et musicalité pour conduire au « parc, vaste et brumeux et tout rempli de lilas blancs ». Par un rapprochement très intéressant, Christine Kossaifi compare cet impressionnisme sensuel de Larbaud à sa conception de la littérature, pour conclure à la fascination qu’exercent, au seuil d’un monde onirique, les paysages de Barnabooth.
Le propos de Gil Charbonnier est voisin, établissant entre le paysage intérieur de Larbaud et son lyrisme des correspondances révélatrices. Charbonnier rappelle la modification des représentations de l’intériorité dont Marcel Arland fut le prophète et le maître. Le paysage assume un rôle nouveau. Ainsi, Larbaud découvre à Genève et dans la campagne du Valais une aide à la composition d’un livre, cependant qu’à Milan, « Les rues et les places connues s’ajoutent à notre sensibilité ». Une dialectique de l’intériorité et du paysage se développe chez Valéry Larbaud par laquelle il devient un chantre et rejoint le « Palace de littérature cosmopolite » que Thibaudet avait imaginé. Il fait « fermer bien le cœur à tous les bruits du monde » pour entendre sa vérité, écrit Larbaud. Mais comment accueillir alors « la place et les rues de Milan » ? Le mérite de Gil Charbonnier est d’avoir su mettre à jour cette contradiction tout en montrant que c’est en elle que se nourrit la création larbaldienne ─ transformant le paysage en patries intérieures. Pour conclure, Gil Charbonnier attire justement l’attention sur le « facteur d’évolution de la syntaxe du discours intérieur » que représente cette dialectique du sujet et de l’objet. On peut conclure avec lui que se trouve là « le vrai lyrisme du paysage grâce auquel on garde toujours un peu de musique en soi pour faire chanter la vie ».
Résumer toutes les voix qui font chanter Valéry Larbaud dans ce recueil et lui prêter un visage est une tâche difficile pour laquelle je demande l’indulgence du lecteur. Qu’il me soit permis cependant, en rendant hommage à tous ceux qui ont contribué à ce remarquable Cahier Valéry Larbaud de saluer une œuvre collective qui doit rendre à Vichy sa voix et placer la ville sous le signe d’un grand magicien du verbe et du paysage, exaltant un monde enchanté ─ aux eaux fraîches, aux frondaisons lourdes, au ciel grondant.
Jean BLOT
26.07.2015
Exposition Plis
Olga Luna
Depuis bientôt trois siècles, Paris accueille l’artiste étranger. Il lui donne non pas seulement des possibilités de vivre mais aussi celles de découvrir, asseoir et publier son talent. Pourtant, pour les Russes comme pour les enfants de l’Amérique latine, il arrive souvent que le talent s’assagisse et, en perdant sa naïveté, compromet son message. La première originalité qu’il faut saluer en Olga Luna est que, si elle a su emprunter au savoir français, à la comédie italienne, à l’insolence espagnole, elle n’a rien perdu du génie du Pérou où elle est née.
Je ne savais rien d’elle avant son exposition Plis à la mairie du Vie arrondissement. Je n’en sais guère plus aujourd’hui. Je n’oublierai jamais cependant ses masques, leur sophistication et leur violence, ni la terreur qu’ils réveillent. Que celle-ci puisse être belle, que, mieux, elle ait pu lier avec la beauté une alliance qui fait trembler, m’a rappelé, quand je l’ai retrouvée chez Olga Luna, la vérité que m’avaient imposée le Mexique, l’Équateur, le Pérou par leur art. Aucun masochisme, aucune complaisance. C’est le réel qui est beau et terrible à la fois, habité qu’il est par des mystères aussi naïfs qu’insondables et unis par une géométrie qui, bien qu’elle soit d’évidence de l’homme, paraît nier toute humanité. L’un des mystères de ces unions singulières ─ ou même, qui nous paraissent contre-nature, Olga Luna a su le capter et l’exprimer. Si le masque, malgré sa beauté civilisée, presque de grand couturier, est véhicule de peur, c’est qu’il tremble. Composer un visage par le détour et avec la grâce terrifiante de la géométrie, n’est-ce pas lui rappeler qu’il n’est que trait, couleur, mieux ─ un pli, ou une composition, un pliage en quoi se réduit toute chose ? Plis : derrière leur perfection formelle, l’éclat de leur couleur, l’âme, ne trouvant plus refuge ni dimension ou profondeur, sanglote. Il m’a semblé entendre ce sanglot dans la belle exposition d’Olga Luna.
Jean BLOT
22.06.2015
Tunisie, saison nouvelle
par Christian Giudicelli (Gallimard)
Un beau livre, comme irisé de bonté. Nul éclat et la passion s’y fait si discrète qu’on peine à la découvrir. Il est des esprits et talents, pareils à des oiseaux un peu fous, qui se jettent et se brisent sur la baie vitrée du réel. D’autres acceptent l’impénétrabilité ou le non-sens. Les premiers se nomment Don Quichotte, Ivan Karamazov ou Madame Bovary. Aux seconds qui ne se lassent pas d’observer, ni de refuser de juger, on pourrait proposer Tchékhov comme figure de proue. Giudicelli est de ceux-là. Notons que, comme Tchékhov, il est autant dramaturge que récitant et romancier. Sur le chemin de la transparence, on trouve aussi Mérimée et Maupassant, mais c’est du côté du Russe ─ et de notre auteur ─ que le réalisme se propose de se tenir au plus près du prochain pour l’écouter, le comprendre ou même ─ et toute compréhension est à ce prix ─ pour l’aimer.
Christian Giudicelli connaît, comprend, c’est-à-dire aime, la Tunisie, c’est-à-dire les Tunisiens. Il nous avait confié et décrit cet amour pour nous inviter à y participer dans Fragments tunisiens (Folio, 1998). Dans Tunisie, saison nouvelle, il entend observer et décrire, en s’abstenant des jugements qu’il abomine, les traces et conséquences laissés par la Révolution qui a bouleversé le pays. Fort heureusement, il y eut peu de victimes. Mais, au cours de la période, ont fleuri et se sont épanouis les beaux discours, les grands mots dont le mensonge blesse l’oreille fine de l’auteur. Il espère cependant, en empruntant les routes poussiéreuses qu’il connaît si bien avec pour arme une voiture de location et l’auto-stop en guise de confessionnal ─ où le stoppeur se raconte volontiers ─ en la « saison nouvelle ».
Ben Ali, le tyran gominé, a disparu. Les jeunes gens, que Giudicelli interroge, avaient vu en lui le Mal. Il n’est plus, mais le Bien se fait attendre. Le malheur qui paraissait peser sur cette jeunesse ne s’est pas dissipé. Les jeunes continuent à voir, dans l’écrivain français qui conduit trop lentement à leur goût, un idéal qui leur est interdit : une vie digne du nom ; un salaire qui permet l’accès à l’âge adulte ; un emploi qui, loin d’abrutir, développe talent et personnalité. Malgré son âge tendre, sa santé, sa gaieté et son bagout méditerranéens, cette jeunesse se sait condamnée. « L’ennui que les jeunes ne cesseront plus de me murmurer à l’oreille, mais qui résonne comme un cri impuissant » ─ les paralyse. Plus de librairie. Plus de cinéma. Plus de magie, ni d’espoir au moins sur le plan politique et social. La violence seule, en particulier celle qui suit les matchs désolants de football ─ « pire qu’une drogue » ─, vient l’interrompre un instant.
Giudicelli sait faire briller la lumière, peser la chaleur, déployer des paysages qui, imposant la beauté, retirent au malheur toute légitimité. « On ne peut être malheureux à Bizerte » écrit-il, et c’est bien pourquoi on y est désespéré. N’est-ce pas le sort de Mehdi que l’auteur rend inoubliable dans la fruste courtoisie de son optimisme tragique : « C’est bien » dit-il fermement, laissant deviner le mal, du fait que ce ne peut être autrement. « Il restera gravé dans le souvenir, entouré de copains, mi-allongés, mi-assis, chacun sur son coin de pierre, leur silhouette découpée sur la mer ou le ciel d’un bleu égal. »
Le calme qu’il avait en lui, « le fatalisme » qui habitait Mehdi, ont trompé l’auteur malgré son amitié. À son retour, il apprend que le jeune homme a « disparu dans l’eau ». Sous son masque digne et serein, il était assez désespéré pour se jeter dans une barque avec le fol espoir de gagner l’Italie, c’est-à-dire de retrouver la promesse de la vie. Il ne reste de lui que « le poids du regret ». Il reste aussi une image inoubliable du désespoir fruste et aphone que Giudicelli a recueilli et qu’il nous transmet.
D’autres rencontres, aussi vraies par leur modestie et leur silence, font comprendre au lecteur ─ j’aimerais dire, toucher du doigt pour souligner la force du réalisme ─ la fatalité du destin qui guette la Tunisie et sa jeunesse. La Révolution a balayé le Mal. On respire, on parle plus librement dans la « saison nouvelle ». Mais on y voit mieux le vide qui attend. Le quotidien n’a guère changé et, privé de l’espoir révolutionnaire, il est devenu plus lourd à porter. Ce désespoir nu, sans grandeur, c’est-à-dire sans mensonge, est d’autant plus présent qu’il s’exprime en français et l’enrichit plus qu’il ne le malmène. L’injustice devient intime sous la plume de Giudicelli. Ses personnages disent « Que vais-je devenir ? » dans un silence qui réveille en le lecteur la même torturante question.
En commençant le livre, j’avais reconnu la bonté. Il s’agit ici d’un sentiment plus subtil, plus exigeant en ce sens qu’il refuse, interdit toute inégalité dans les rapports, que Tchékhov a illustré mieux que quiconque : la compassion. C’est elle qui illumine le portrait que brosse Giudicelli d’une Tunisie superbe et désolée.
Jean BLOT
22.06.2015
– L’Histoire du passé [1]–
par Jean-Philippe DOMECQ
Il y a deux énigmes humaines : Dieu, et l’Histoire. Énigme n’est pas mystère, elle suppose un code chiffré, momentanément ou perpétuellement ignoré, mais chiffré. Les deux énigmes en question appellent donc précision ; c’est à ce travail de précision constamment renouvelée, « approchante » comme on le dit d’une vérité en mathématique, que contribue le présent ouvrage de Jean Blot, qui les conjugue.
« Que faites-vous de Dieu dans tout cela ? », demanda Bonaparte à Monge qui venait de lui faire un bilan des dernières découvertes tandis que la flotte française appareillait pour la campagne d’Égypte : « Nous n’avons pas besoin de cette hypothèse », répondit le scientifique. Cette anecdote renvoie déjà aux deux avant-derniers chapitres de L’Histoire du Passé : « Le Romantisme et l’Égyptomanie romantique » et « Du haut des ces pyramides ». Dieu, une hypothèse ? Et l’Histoire humaine donc, à quel sens hypothétique s’il en est, pluriel ou pas, obéit-elle ? L’anthropophanie, répond Jean Blot avec cette Histoire du passé dans ses rapports avec l’inconscient, et on va voir pourquoi. Mais attention : c’est l’inquiétude du « roseau pensant » qui contraint l’homme et Jean Blot à se demander Pourquoi et Comment, « n’ayant d’autre ambition sinon celle de comprendre », précise-t-il en soumettant au partage la longue réflexion qui prendra trois volumes annoncés ainsi : « Ce premier tome est consacré à l’Égypte. Il cherche à montrer que ce pays, son histoire et son art, sont au fondement de la sensibilité occidentale et habite son inconscient. Ce premier tome sera suivi d’un second consacré à la Grèce et d’un troisième consacré à Rome. Ils n’aspirent pas à l’érudition mais seulement à l’interrogation ». Constatons que l’érudition y est, et comment, tout autant que l’interrogation…
Jean Blot avait déjà amplement médité l’Histoire, et je ne rappellerai à ce sujet que deux livres dans l’œuvre d’ensemble : Bloomsbury, Histoire d’une sensibilité artistique et politique [2], meilleure synthèse à ce jour sur ce qu’a produit ce lieu-moment historiquement névralgique de Bloomsbury, véritable épicentre culturel des névroses fastes et néfastes qui a pu émettre dans le monde à la fois sur le plan de la littérature, via Virginia Woolf évidemment, sur le plan de la liberté expérimentale des mœurs, du dandysme aussi puisque John Maynard Keynes en fut un de nouvelle facture, tout en étant probablement le plus grand économiste du vingtième siècle, et l’économie, on le sait, est une autre littérature pas moins que l’autre puisqu’elle réfléchit les passions humaines. Cela, Jean Blot l’a interrogé. Et il a interrogé l’histoire de son pays d’origine, la Russie, dans Le soleil se couche à l’Est [3], où il a eu le courage intellectuel de montrer, sur la longue durée, des siècles, que la Russie n’avait pas de meilleur ennemi qu’elle-même, qu’elle adorait cela quoi qu’il lui en coûte, et en effet les Russes ont payé et paient un lourd tribut à leur volupté du Cap au Pire. Il y a une métaphysique sous cette hystérie du seul peuple qui aime à se caricaturer, une façon universelle de reposer tous les jours la question de l’À quoi bon, que nous sommes libres de nous poser car nés pour nous poser chaque matin.
Jean Blot se, et nous, la repose dans ce qu’il nomme l’Histoire du passé, notion-titre qui implique le distingo entre les deux là où la réflexion commune verrait a priori un pléonasme. C’est que l’histoire ne suffit pas à éclairer le passé. Le passé c’est, par et au-delà de l’Histoire, « ce temps magique qui fuit à l’horizon et demeure cependant si présent qu’il se confond avec la vie intérieure. Il garde tout projet, conserve tout espoir. » Voilà déblayé le terrain des croyances scientistes, si scientifiquement matérialiste que certaine se soit voulue même, d’un sens unique de l’Histoire. Sens unique qui chaque fois prit le relais du précédent avant de le passer au suivant, sens pluriel au total donc ; mais même dire cela reste restrictif au vu du déroulé de l’aventure humaine et de toutes les philosophies historiques, dont Jean Blot reprend plusieurs à partir des premiers grands Historiens, depuis Hérodote « sacré le père de l’Histoire, à juste titre ». Aussi vaut-il mieux écarter le sens du sens au sens de contenus, pour lui préférer le sens au sens de direction. Mais direction/s vers quoi, si plurielle qu’on les conçoive ? La rigueur des démarches d’historiens en ce sens reste capitale, résumée de la sorte : « L’Histoire ne devient elle-même qu’en découvrant ou inventant un sens et une direction à la marche, non plus errance ou répétition, mais Anabase de l’humanité. Puisqu’il y a mouvement, il doit y avoir une direction que le hasard ne peut dicter. »[4] Réponse misée, l’anthropophanie : l’homme se cherche et se révèle à lui-même par l’Histoire.
C’est donc en pleine conscience de ce problème perpétuellement reporté d’acceptions en acceptions de l’Histoire, que Jean Blot entreprend d’interroger le Passé qui fuit entre les mains des historiens lors même que ceux-ci nous en livrent les flux et événements au fil des orientations qu’ils discernent. « Je mène une entreprise qui n’eut jamais d’exemple », eut le culot de proclamer Rousseau au seuil des Confessions, lors même qu’elle en eut via Saint Augustin et Montaigne, avec ce narcissisme universel et cette géniale vanité qui nous embarrassent et nous éblouissent ; Jean Blot a, lui, la modestie sympathique (en sympathie littéralement ici) qui lui donne la force d’amplitude et le coffre de faire revivre le Passé, ici de l’Egypte, avec un souffle qui emporte avec précision, toujours la précision annoncée. Son « entreprise » implique d’être écrivain, implique la littérature, que déploient par ailleurs ses ouvrages ; la méthode qui l’implique, et non la littérature comme rhétorique. Dès les premières fondations théoriques de sa recherche, l’auteur évoque le Temps retrouvé de Marcel Proust, la madeleine et l’écho du pavé revenus des strates de la mémoire, intacts, au présent, à l’échelle individuelle comme ils demeurent tout autant à échelle collective en nous, que nous les percevions ou non, que nous le voulions ou le sachions ou non. Consciemment et inconsciemment : du même coup et par nécessité, la prospection psychanalytique est intégrée à la réflexion sur l’Histoire et le Passé. Nous avons tout dans l’inconscient, tout ce qu’ont accompli et rêvé et craint et commis nos semblables antécédents. La prospection doit donc être collective autant qu’individuelle. On voit la cohérence de la méthode, et l’ambition de cette humilité solitaire. Solitaire à la manière de Novalis qui entreprit son Encyclopédie personnelle juste après l’Encyclopédie collégiale des Philosophes des Lumières, estimant qu’une fois le changement de paradigme effectué par Diderot et ses centaines de collaborateurs, il fallait voir ce que cela déposait au niveau de la psyché individuelle.
Maintenant, l’Égypte, littéralement : l’Égypte maintenant, son passé passé et maintenant, tout comme une saveur lovée dans notre roman familial passé peut nous envahir soudain la psyché à la faveur de telle sensation présente.
Ayant rappelé que le travail historique consiste à chercher cette « direction que le hasard ne peut dicter », Jean Blot passe au moment de la grande mise en branle d’Orient et d’Occident : « Il s’agit bien d’un exode, d’une sortie hors de l’Immobile dont l’Égypte, par son intégration de la mort à sa vie, par l’adéquation de son paysage et des mouvements de sa nature au rythme existentiel, était devenue le lieu et le champion. » Intégration de la mort à la vie ? Adéquation de son paysage (…) au rythme existentiel : telles sont les données auxquelles nous confrontent « ces siècles qui nous contemplent » étrangement mais immanquablement puisque chaque fois que nous les revoyons nous ne pouvons nous empêcher de les contempler : « C’est surtout par les pyramides, dressées par la IVe dynastie, que l’Égypte dit, en termes de pierre et de ciel, la vérité qu’il incombait de révéler. Par la pyramide, le cosmique et l’humain, la matière et l’âme, la géométrie et l’affect, s’immobilisent face au soleil dans leur unité. Trois pyramides, comme trois pas vers ce Un qui hante la pensée, dont elle désire et redoute le règne, avec pour cadre le désert de la même évidence que la lumière du ciel, affirment une vérité que l’on interroge en vain. Rien n’est plus difficile à percevoir que, sans l’ombre du doute et de la concession, l’évident dans sa clarté parfaite… » (je souligne, d’une part pour la beauté algébrique de la formule, ensuite pour livrer ne serait-ce qu’un échantillon des « aphorismes descriptifs », si pareille notion n’existe pas, dont est ponctué ce livre, narration d’une interrogation au très long cours où la description et le compte-rendu dégagent régulièrement, et comme naturellement, des leçons d’observation réfléchie.) Pharaon « a trouvé une forme perceptible aux sens. »[5] Soit dit en passant, l’écrivain-poète ici a une formulation qu’on souhaite aux artistes contemporains du minimalisme et du conceptuel bien compris ainsi qu’à leurs commentateurs. Et ceci rappelle que l’art conceptuel et le minimalisme ne nous ont évidemment pas attendus ; la forme des pyramides et leurs ombres portées le signifient depuis toujours. (Cette réflexion est, après tout, un de ces innombrables pointillés de la pensée que cette lecture amène à prolonger, confirmant ainsi l’hypothèse de ce livre, que le Passé est le présent qui reste de l’Histoire.)
Le livre reviendra sur ce qu’a représenté la construction de pareils monuments, en termes de capital-travail, de grèves impossibles, de sang et de larmes prolétaires, autrement dit d’esclaves broyés sous les « blocs ici-bas chus d’un désastre obscur », n’a pas dit Mallarmé pour ces pierres sacrées par leur seule forme pointée vers l’infini mais sa formule d’Igitur est ici adéquate. « On dirait que les monuments de Giseh ont été élevés à l’exploitation de l’homme par l’homme et doivent la représenter. »[6] Problème — où l’on voit que le « manque d’érudition » que Jean Blot se suppose vient de ce qu’il ne prétend pas à l’historien en raison même de son mode d’interrogation histoirique — , problème, c’est que l’art de ces architectures révèle tout autre chose : « On doit noter que la qualité même du travail, « les joints si bien ajustés qu’une mince pellicule de papier n’y passerait pas »(d’après l’explorateur Georges Guyon) démontre que c’est l’œuvre, non d’un troupeau d’esclaves menés au fouet, mais d’ouvriers d’une grande qualité professionnelle. »
Autre chose à ce propos, et je tire ce seul fil pour donner la mesure du tissage d’ensemble qui rend cette lecture plus filante dans la nuit que Salammbô revu par Hegel : comment se fait-il, se demande Jean Blot, que ces tombeaux pharaoniques si impressionnants de conjuguer le désert et le ciel, le sable du désert et le sable que nous sommes, la vie pas moins vaste que la mort, la vie en tombeau et la mort sous l’astre solaire d’Amon –, comment se fait-il, donc, que ces monuments d’épure sacrée aient constamment subi le pillage ? Constamment, et pas seulement aux temps de leurs redécouvertes puis des pirateries modernes. Bonne question, de ces questions solidement pragmatiques qui portent l’esprit plus loin que des questions dites idéales. Et là, il faut relire et suivre et l’écrivain qui nous guide au fanal de ses connaissances historiques, chapitre VI, « L’Égypte et la mort » : les pages 161 à 167.
Puis, plus en surplomb via le thème de la célébration de la mort, le travail historique tire le fil rouge de l’interrogation religieuse perceptible au cœur de l’Histoire humaine. Au sens où c’est l’inquiète conscience de sa finitude qui fait de l’homme cet animal entreprenant, dynamique. C’est l’angoisse qui fait notre singulier ressort, perçoit Jean Blot ; convenons qu’il a et nous avons de solides raisons de le penser. Ainsi, faute de pouvoir détailler ici les conceptions religieuses de l’Égypte, je donnerai ici ce qui est dit de leur articulation avec la religion qui prendra le relais jusqu’à nous, avec les conséquences que l’on constate en termes d’universalisme. Ainsi de l’Exode et des Plaies d’Égypte : « «Chaque peuple, enseigne Hegel, est un individu dans la marche de l’histoire.» (…) Il en est ainsi de l’Exode. Le peuple élu pour le parcours qui s’annonce découvre son identité dans le rôle qui lui est imparti — et l’impose à autrui. (…) Israël se cherchera, n’ayant d’autre visage où se reconnaître, ni autre lieu où se trouver, que l’Eternel. »[7] Quant aux mythes nécessaires à cette mécanique de l’Histoire : « Au plan historique, les Plaies d’Égypte sont des contes fantastiques, faisant partie d’un ensemble destiné à expliquer à un peuple son origine. (…) Le récit se veut convaincant et, pour y parvenir, épouse le lieu, le climat, les circonstances, et s’accompagne de détails hallucinants qui flattent la mémoire. Pour ne citer qu’un exemple, que l’eau se change en sang, est un miracle qui, renvoyant à la couleur que prend le Nil au début de sa crue quand les fellahs creusent des puits pour que la terre filtre l’eau, reconduit à l’expérience quotidienne. L’essentiel est ailleurs : (…) Dieu étant reconnu comme la cause des plaies, l’impuissance des dieux anciens devient évidente. (…) Leur forme et leur perfection, leur immobilité en interdisant le mouvement de l’histoire, qui promettait naguère, dans la pierre plus que par les textes, une sécurité capable d’apaiser l’angoisse des peuples et de l’individu, sont brisées. (…) Israël devient peuple théophore, soit le porteur du sens que l’humanité se donne et qui a déserté Pharaon. »[8]
Avant que le Nouveau testament prenne le relais, il y aura eu Rome. En attendant, Jean Blot médite, en racontant toujours, le passage de l’Égypte à Rome et de la mort à une autre vie par l’intercession d’une femme de légende autant que de chair et d’os, Cléopâtre, amante des deux maîtres romains du monde, qu’elle enjôlera au point de faire basculer l’Empire au contact, au baiser de deux mondes. On passe alors d’Hérodote et Flaubert à Plutarque et Shakespeare ; le plus hallucinant pour nous, et qui fait que ce Passé demeure une énigme présente, est que cette histoire ait pu être vraie. Il vaut le plaisir, et sûrement pas la peine, de relire cela, pour l’orgie et la peur, pour le Sénat et l’aspic, pour le stupre et la plus grande défaite navale de tous les temps, Actium, qui changea le monde plus que le nez de celle qui en fut responsable [9]
[1] Jean Blot, L’Histoire du passé, éditions L’âge d’Homme, mars 2016. Présentation de ce livre prononcée le 15 avril 2016.
[2] Éditions Balland, 1992.
[3] Éditions du Rocher, 2005.
[4] L’Histoire du passé, p.35.
[5] Ibid, p.87-88.
[6] Ibid., p.185.
[7] Ibid., p.153.
[8] Ibid., p.157 à 160.
[9] Ibid., p.223 à 252.
James Cook et le bon sauvage
par Anne PONS (Éditions Perrin)
Longtemps Anne Pons fut l’une des critiques littéraires les plus averties et les mieux écoutées. Depuis quelques années, elle a gagné le large, partie pour un voyage toujours sur mer, toujours à voile et dont l’idéal, demeurant vague, devait illustrer les vertus les plus concrètes de courage et d’endurance. Une belle nostalgie l’inspirait et gonflait la voile de l’aventurier armé de canons ─ comme Nelson, du seul courage ; comme Jules Franklin, l’homme qui mangea ses bottes, ou émerveillé par la perspective de la réalité inconnue tel Lapérouse. Comme ses livres précédents, celui-ci nourrit le regret qu’Herman Melville a su exprimer le jour où le Téméraire, héros de Trafalgar, fut réduit en bûcher et en planches :
O that Navy, old and oaken,
O that Temeraire ─ No more.
Ô cette Flotte ancienne, taillée dans le chêne,
Ô le Téméraire ─ Adieu à jamais.
Cette fois, la belle Nostalgie d’Anne Pons cingle vers de nouveaux horizons. Sans doute, elle communique toujours à son lecteur le rêve du continent austral, ou du passage au Nord de l’Amérique entre les deux océans. C’est bien cet imaginaire, presque un mirage qui emporte James Cook et anime ses trois voyages ─ de trois ans chacun. Il le rend comme distrait aux dangers, aux maux et maladies sans nombre, aux difficultés de l’expédition comme aux humeurs de ses hommes. Il l’enrichit de trésors de courage et d’endurance que l’auteur nous fait découvrir avec une belle admiration. Terra incognita ! Elle faisait battre le cœur du temps où elle se cachait encore. Par l’auteur, on retrouve cette enfance, sa hardiesse, son émotion. La découverte a mûri. Désormais, la science l’accompagne ─ le lieutenant de vaisseau James Cook est un admirable cartographe prêt à risquer sa vie et celle de ses hommes pour corriger le tracé d’une côte ou repérer des caps ignorés. Il est accompagné de savants tels Joseph Banks ou Daniel Solander, le dessinateur paysagiste, tel Sydney Parkinson dont les curiosités, sans perdre leur ardeur, sont devenues scientifiques et ne cessent de découvrir, décrire, classer choses, plantes, animaux de ce monde. Seulement, cette quête et l’esprit scientifique se heurtent à des écueils inattendus. Parmi plantes, animaux, paysages, on ne peut que se heurter à son semblable, sujet et non objet d’observation. La rencontre provoque des difficultés et incidents qui relèvent de la comédie. Voilà nos héros puritains ─ autant par la rigueur morale que par la foi ─ qui se trouvent exposés ─ après quelle abstinence ! ─ à des femmes dont la lubricité n’a pour égale ─ hélas ! ─ que leur laideur et leur saleté. Anne Pons dit le comique de pareilles retrouvailles et son sourire est contagieux. Elle ne nous laisse pas oublier pour autant la gravité du problème que posent ces jeux et rencontres. Ni sa gravité. Ni sa modernité ─ mieux : son actualité.
En effet, c’est vers un autre horizon que cinglent nos héros ─ ni austral, ni océanique, ni même impérial ─ bien que Cook paraisse incapable de laisser passer un ilot sans le baptiser du nom de l’un des saints ou princes de la vieille Angleterre, dans l’illusion, assez primitive, que désormais il relèvera, au physique mais aussi au moral de la couronne britannique. Anne Pons nous cache longtemps la tragédie qui attend l’aventure, mais, avec art, elle nous la fait pressentir. C’est ainsi, sur un écueil qui n’a rien de marin, que vont se briser Cook et ses Discovery et Resolution. Il se nomme le « Bon sauvage » ou en anglais, et la nuance est importante : « Noble savage ». On connaît mal son origine. On l’aperçoit chez Montaigne. Il chemine dans l’ombre de la sensibilité avant d’apparaître, porteur de son apparition, d’une explosive contradiction. En effet, notre gentil sauvage est évidemment le fils des lumières et des sentiments de tolérance et compréhension qu’elles font naître, du désir impérieux de reconnaître en tout homme le prochain, l’égal, qu’elles provoquent … Mais les lumières ne s’allument que pour dissiper la sauvagerie. Si le sauvage peut être bon ou noble, les lumières ne sont plus qu’alibi de conquérant ou même de brigand, comme l’inquiétant Rousseau le susurre déjà et comme l’histoire, hélas, le confirmera trop souvent. Quant à la dernière scène, de toute beauté, où, sur les côtes paradisiaques de Hawaï, on aperçoit une dernière fois le héros des temps modernes, James Cook, faire signe de loin pour interdire à ses batteries d’ouvrir un feu capable de le libérer des cannibales qui le retiennent prisonnier et qui vont sans tarder, et sans la moindre animosité, pour lui faire honneur au contraire, le manger ─ mais en massacrant les Polynésiens ─ peut servir d’illustration à la situation de l’Occident en notre siècle. Elle dit, avec une admirable éloquence, l’impasse dont la conscience moderne est prisonnière. Rendons hommage à l’auteur qui a su esquisser, avec autant de discrétion que d’autorité, le portrait combien actuel du « Bon Civilisé ».
Jean BLOT
22.06.2015
On se souviendra que l’année dernière, nous avions publié le texte d’Alain Pons que celui-ci avait présenté au Colloque international sur les valeurs européennes organisé par l’Institut français de Milan sur l’initiative de son directeur, Madame Olga Poivre d’Arvor. Cette année, le thème retenu étant l’amour en Europe, Jean Blot apporta la contribution ci-dessous :
*
L’EUROPE ET L’AMOUR
par Jean BLOT
Par une formule qui se voulait provocante mais révélatrice, l’éminent historien Charles Seignobos proclamait naguère : « L’amour est un sentiment qui est né en France au douzième siècle. » Rien de plus faux. Rien de plus vrai. Rien de plus faux : d’évidence l’amour est une caractéristique du genre humain ou même de la vie, et on aime aussi bien et aussi mal du Nord au Sud que d’Est en Ouest et, probablement des origines du monde à la fin des temps. Rien de plus vrai, cependant, car si d’évidence l’humanité est autant en tous qu’en chacun, si elle, et tous les sentiments qui l’accompagnent, se trouvent en toute personne et répandue cependant sur toute la terre, la même, exactement, il n’en demeure pas moins que certains sentiments universellement partagés découvrent en un temps et un lieu leur vocabulaire, leur syntaxe, leur morale, mieux leur identité. Ce fut le cas de l’amour, au douzième siècle, en Europe.
Je dis bien Europe et non plus France, ne serait-ce que pour la raison que le mythe majeur sur lequel j’entends m’appuyer dans mon propos, Tristan et Yseult, nous est parvenu, l’original de Chrétien de Troyes étant perdu, en langue d’oc par Béroul, germanique par Gottfried de Strasbourg et par Thomas d’Angleterre. Ce mythe ne tardera pas à inspirer les amants de Laure et Béatrice, être à l’origine du nouveau sentiment qui naissait en Europe et révéler la gravité et la complexité de l’Éros européen.
Le mythe est une forme ou un langage emprunté par la vérité ; sa fable, un masque pour cacher et révéler cependant des réalités complexes ou douloureuses qui refusent la rigidité du concept et le règne de la rationalité. On se souvient de la distinction très utile que faisait Freud dans sa clef des songes et par laquelle le rêve manifeste était opposé au rêve latent. Le manifeste c’est l’histoire que le rêve raconte, le rêve latent, sa signification. Le mythe est comparable à un rêve manifeste collectif, fait par une communauté et inspiré par une identité dont il démontre l’unité. Sa signification est latente. Il faut l’interpréter.
Notre fable, on s’en souvient, se passe entre Bretagne, Cornouaille et Irlande. Le roi Marc a un neveu Tristan qu’il adopte à la mort prématurée de ses parents et qui se révèle porteur de toutes les vertus morales et physiques. Le roi le choisit pour aller chercher et convaincre la princesse d’Irlande, Yseult, qu’il veut épouser. En route, notre chevalier rencontre le géant Morholt qui désole la Cornouaille et, sans se douter qu’il est le père d’Yseult, le tue en combat singulier. Lui-même, grièvement blessé, sera soigné et guéri par Yseult. Les deux jeunes gens s’entendent bien et Yseult accepte la demande en mariage du roi. Mais, lors du voyage de retour, sur le bateau, par une chaleur caniculaire, ils étanchent leur soif au philtre d’amour que, par erreur, la suivante d’Yseult, Brangien, leur fait boire. La passion naît, immédiate, irrésistible ─ pour toujours selon les uns, pour trois ans selon les autres. Il s’ensuit un nombre d’incidents, où le roi Marc est berné, où, détrompé par les Barons félons, il entend agir pour retomber victime de la ruse des amants que la passion qui les consume finira par tuer.
Dans l’interprétation du mythe, il faut noter qu’il conte un adultère. Le péché vient illustrer l’amour de telle sorte qu’on peut le croire nécessaire à son épanouissement. Si Tristan et Yseult sont coupables, l’amour l’est aussi. Il semble que l’amour dans la conscience européenne est lié au péché. Il ne saurait être heureux. C’est parce qu’il est élu par le péché et par le malheur que Tristan devient un héros légendaire et, notamment par le génie de Wagner, se transforme en une figure tragique de l’Occident.
Cette culpabilité est aggravée par le troubadour puisque Tristan est, dans son récit, mieux que le neveu, le fils adoptif, presque le fils, du roi qu’il va tromper et auquel il prendra sa femme. Œdipe n’est pas loin et Freud aurait pu, semble-t-il, adopter pour son dramatis personae de la Psyché, plutôt que les héros antiques qu’il a choisis, les personnages des Troubadours. Péché aggravé, intime, la fable lui prête cependant des circonstances atténuantes. Le philtre est magique. L’amour est plus fort que l’homme. On ne peut lui résister ; « Amûr par force vous demeisne ». Si bien que, contrairement à la morale judéo-chrétienne, ou à toute morale, les amants ne sont jamais jugés, ni condamnés. Ils sont innocents, victimes d’Amûr. C’est le roi Marc qui est jugé sévèrement. Béroul, en particulier, lui reproche son attitude et sa conduite contraires à la loi d’amour, au Code d’Amûr, qu’il aurait dû reconnaître et accepter. L’amour se situe au-delà du Bien et du Mal.
D’où vient cet étrange Amûr qui va dominer, sous son masque de coupable-innocent, la sensibilité de l’Europe ? Rien ne l’annonce et il paraît bien différent de celui que chantaient Catulle et Ovide. À l’opposé de l’amour chrétien qui promet bonheur et fécondité, il annonce le drame, prédit la mort. Puisqu’on ne peut vivre par lui, il ne reste qu’à en mourir. Son paysage est composé de houles et de brumes et dissimule sa violence dans les ombres celtiques et le soleil bas du Nord. Par ce paysage, il se distingue de celui qu’il va inspirer en Avignon et à Florence, une maladie d’aimer qui s’entoure de silence et de solitude, cherchant par l’incantation de la répétition à préserver et grandir l’obsession érotique.
La passion s’affirme comme le contraire de l’amour chrétien et foule au pied ses vérités. Le tissu de trahisons, parjures, du mythe cacherait peut-être un mensonge essentiel par lequel l’idéalisation de l’autre le transformerait en image du moi pour un Narcissisme fatal. La question se reposera quand, pour un nouvel Amûr, fils du premier, les amants italiens s’isoleront dans la galerie des glaces du monologue.
Le mythe a ses ruses. Quand Tristan croit pouvoir échapper à la passion et épouse une autre femme, il faut qu’elle porte le même nom : Yseult, brune ‘aux blanches mains », que celle de l’Amûr. Voilà qui va gêner le récit. Mais il ne s’agit pas de maladresse. Bien au contraire, l’identité des prénoms va refléter le trouble du Chevalier déchiré entre deux forces opposées et cependant complices. L’identité des noms va faire trébucher le lecteur pour le faire participer au trouble qui habite le héros. « Qui ne scay pas mourir d’Amûr, n’est pas digne d’en vivre ». Ces paradoxes vont révéler une incohérence fondamentale qui déchire le cœur humain. On peut y relever la trace des contradictions de la société médiévale et de la courtoisie qui va s’imposer. On doit y lire une révolte contre un Occident qui, fils de l’Incarnation, a été conduit à épouser le parti de la Réalité pour un mariage douloureux qui le condamne à choisir ce qui est, ou peut devenir, chair ─ soit l’Être et la fécondité.
Le trouvère, le troubadour, chante la nostalgie qui l’habite. La poésie orale, la musique la favorisaient, lui donnaient des ailes pour échapper au vrai et voler dans le mensonge ; l’ouïe, plus fidèle au moment et au lieu du chant, gardait le souvenir de la lumière trompeuse du soir où l’impossible se glisse entre chien et loup. Où trouver ce jour celte où le ciel s’en va en fumée ? D’où vient cette morale si gracieuse qu’on ne sait lui faire avouer son sens ? Le mensonge danse et, acrobate, se révèle le coryphée du récit qui le mène à la mort.
Denis de Rougemont croit découvrir dans la poésie courtoise la foi cathare qui, en ce douzième siècle, gagne en France d’Oc les esprits et les cœurs. Elle est subtile mais sa croyance fondamentale rejoint nombre d’hérésies anciennes pour lesquelles la Création, loin d’être l’œuvre de Dieu et celle du diable et ce monde, le royaume du mal. Il s’ensuit d’évidence que toute participation à sa fécondité, à son maintien et développement, comme le propose l’amour chrétien, est un péché. Il faut détourner l’amour de toute positivité pour qu’il se consume dans la passion qui doit détruire la Création. Rougemont va jusqu’à suggérer que le chant du trouvère est un langage codé, qui doit chanter l’hérésie et lui gagner le nouveau monde courtois. Sans pouvoir le suivre jusque-là, on soulignera que L’Amour et l’Occident, et c’est son grand mérite, a su découvrir et établir entre Cathare et Amûr un lien de parenté. Ils sont enfants d’une même sensibilité.
Elle est d’une époque, celle où la brutalité des Croisés cherche et trouve dans la courtoisie, le repos du guerrier. Elle est permanente en ce sens qu’elle fait partie, tantôt dominante, tantôt récessive, de la Psyché européenne. Elle a emprunté ou, peut-être, s’est épanouie dans la langue des Trouvères en partie clandestine, gardant les pouvoirs de prédication et conversion, merveilleuse quand elle découvre, dans sa dualité, la richesse de l’émotion, irritante lorsqu’elle maltraite le bon sens.
La langue de Freud, faite pour entendre ce qui se dit dans ce qui se tait, apprend à lire les figures inventés par Trouvère cathare (militant) ou courtois (sympathisant). Il faut s’interroger sur pareille rencontre entre les deux grands systèmes d’accueil d’Éros dans la société européenne. Sept siècles après Marie de Bourgogne ou Chrétien de Troyes, le rationalisme scrupuleux de Vienne découvrait une langue codée d’Amûr et forgeait les images et concepts pour interpréter.
D’où vient cette langue ? Qui parle à travers elle ? La Psyché n’a pas d’âge. La langue des trouvères est l’une des traductions de la Nostalgie essentielle de celui que l’on a chassé du paradis intra-utérin, c’est-à-dire ─ chacun. Par elle, se fait entendre une révolte inapaisée contre l’Exil premier : le Trouvère se libérant du monde médiéval, le Cathare protestant contre une réalité qui interdit l’unité première ; Freud enfin, révolté contre une culture qui exclut le corps et, de ce fait, le retour. Ce sont trois voix constitutives de l’Amour en Europe et qui fondent son originalité.
Jean BLOT
Les Inoubliables
de Jean-Pierre PARISIS
(Flammarion
Il est de beaux livres qui sont de bonnes actions. Leur mérite moral s’y mêle si étroitement à leur qualité artistique, leur savoir-faire narratif, leur style rigoureux, que l’on ne le discerne qu’à la réflexion. Ce sont livres utiles. Ils font du bien.
Tel Les Inoubliables de Jean-Pierre Parisis. Avec sobriété et vigueur, sans aucune complaisance sentimentale ou éthique, il conte l’histoire des Juifs disparus dans les tourments de la guerre. Ce sont des enfants mors dans les chambres à gaz d’Auschwitz, mais réapparus pour rendre la vérité et, grâce à elle, la vie au village pétrifié par le mensonge.
La Bachellerie ! Le village était charmant, illustration et véhicule de la douce France qu’on ne se lasse jamais d’évoquer. Enfant dans les années soixante-dix du siècle dernier, l’auteur avait su y goûter le charme et la qualité du grand-père qui parlait encore le patois, du grelot de la porte qui s’ouvre en grinçant, de la vache curieuse aux portes de l’étable, de la grande paix de la Dordogne ─ presque palpable à l’Angélus ou dans les soirs. La Bachellerie gardait pour l’auteur la triple magie du vieux pays, de son enfance, mais aussi celle des vacances qu’il passait là, ce temps si bien nommé réservé au rêve, au jeu, à l’imagination.
Pourtant quand, adulte, vingt ans plus tard, il veut le retrouver, il n’y parvient pas. Le village se tait. Il ne se souvient de rien et oppose un silence hostile à l’adulte qui voudrait y retrouver son passé. « Le feu de la mémoire ne prenait plus. » L’adulte se résigne à la perte de son enfance et rentre à Paris. C’est là qu’il découvre, quelques années plus tard, la photographie des enfants juifs immolés. Elle le bouleverse comme, reproduite, elle ne manquera pas de bouleverser le lecteur.
Elle illustrait un livre de Martial Faucon : Les enfants martyrs de La Bachellerie. L’histoire qu’il contait, le drame qui s’était produit dix ans avant la naissance de l’auteur, mentionnait des noms qui lui étaient familiers. Il en avait connu certains, telle la boulangère « fort gentille mais un brin réservé ». Les lieux lui étaient familiers, décors de son enfance tel le haut du village où avait été fusillé le grand-père des enfants, ou la gare où les Allemands avaient fusillé leur oncle. Ces victimes de La Bachellerie, l’auteur a l’impression de les connaître un peu, « de les avoir beaucoup perdus ». Ce sentiment profond touche et porte le lecteur. Il admirera l’art du narrateur dans le récit des histoires de rafles, de déportations, leur banalité débouchant dans l’horreur que l’on connaît et que certains, dont moi, ont vécue.
Les Alsaciens, dont les Juifs, ont été évacués de Strasbourg au début de la guerre et ont trouvé refuge en Dordogne. Les relations sont d’abord hostiles, les paysans accueillant mal ces bourgeois des villes qui se plaignent des conditions primitives des villages dans lesquels il leur faut vivre. « Nous n’étions pas assez bien pour eux » grommelle le paysan. Survient la défaite. Les Alsaciens sont invités à rentrer « à l’exclusion des Juifs. » Ceux-ci accompagnent les partants. On s’embrasse, on se quitte en pleurs.
Les temps se font plus durs. Les Juifs sont connus et dénoncés pour tels. Les autorités les suspectent ─ à bon droit ! ─ de Gaullisme. On les soupçonne d’appuyer Communistes et Francs-maçons pour « perdre définitivement la France » ou d’écouter la radio anglaise. Pourtant les Juifs arrivent à survivre. La catastrophe s’abat sur le village quelques mois seulement avant la Libération. C’est d’abord la Milice française qui fond sur La Bachellerie, arrêtant et enlevant Juifs et Résistants. Fin mai 1944, la division Brehmer descend de Paris pour « pacifier » la région où les maquis se montrent de plus en plus actifs. Ce sont exécutions de Résistants et de Juifs, rafles des femmes et des enfants juifs, pillages, incendies, viols. On tue, on arrête, on torture le long des chemins enchanteurs, dans les bois où régnaient les fées, les prés où l’on cueillait les fleurs. L’auteur a retrouvé les portraits terribles et les photos des enfants sages, avec leurs petites valises pareilles à des jouets, expédiés vers l’Allemagne et la mort. « La semaine suivante l’école reprendrait à La Bachellerie, une fleur fichée dans l’encrier des enfants absents. »
On ne peut qu’admirer l’art avec lequel Parisis donne un visage à chacun des Inoubliables et retrace leur destinée. Sa plume est sèche à souhait et rend d’autant plus bouleversants le drame qu’elle raconte et la peur des enfants qui le domine. Mais la valeur du livre, sa beauté-bonté sont ailleurs. Il nous enseigne que le présent ne peut vivre que nourri par le passé, dans la connaissance de ses richesses et la reconnaissance de ses crimes. Les enfants martyrs de La Bachellerie ont emporté avec eux la clef qui ouvrait sur la douceur du paysage, ses odeurs d’herbe et des bois, son bonheur sage. Le village se tait. Le village est vide, mieux : il est mort, victime du mensonge qui prétend n’être qu’oubli. Il ne se retrouvera vivant qu’en acceptant la même ascèse que Parisis, en levant les interdits de la mémoire, en se souvenant des Inoubliables et de leur tragédie. Trop d’entre nous ont fait de leur cœur et leur esprit des Bachelleries muettes. Pour retrouver parole, mémoire et vie, il leur faut imiter l’auteur des Inoubliables. Et commencer par le lire.
Jean BLOT
25.04.2015
Nu intérieur
par Belinda CANNONE
(Éditions de l’Olivier)
Éros, Agapé, Philia sont trois idoles dont les conflits n’ont cessé de déchirer le cœur humain. Dans la connaissance et description de ces guerres intimes, Belinda Cannone est virtuose. Mais c’est une autre qualité, plus rare, que j’apprécie, que j’admire, dans son œuvre : elle a l’intelligence tranquille. L’intelligence, en effet, est par nature, inquiète, bientôt angoissée, vite agressive. Celle de Cannone ne perd jamais sa belle tranquillité, ne hausse jamais le ton et s’avance impavide au plus fort des passions. C’est avec cette tranquillité qu’elle aborde dans Nu intérieur la tempête nouvelle qui emporte les cœurs depuis que de beaux esprits et des produits pharmaceutiques fiables ont assuré la liberté de l’amour.
C’est elle qui pousse le héros du roman, architecte dont on devine les qualités et le charme, à fréquenter, bien que marié dans l’harmonie et le bonheur à l’Une (dont l’absence de nom ne peut que promettre au lecteur l’Autre et sa fatalité), à fréquenter donc les dancings. À vrai dire, je les croyais disparus mais si l’auteur les retrouve, c’est bien pour situer, au plus usé des décors de l’amour, au plus peuple des marivaudages, la modernité sexuelle.
Ce dancing est réservé au tango, ce qui nous vaut une belle description de cette danse entre toutes la plus macho, de ce qu’elle promet, de ce qu’elle refuse au désir pour le mieux stimuler. Notre architecte ne manque pas d’y trouver l’Autre, Éléonore. Les corps qui s’accordent dans la danse, ne tardent pas à s’accorder au lit où Éros triomphe. Il apporte au corps un bonheur si complet que l’esprit en est troublé et refuse de comprendre l’impasse où il se trouve. Car Philia (l’Une) demeure aussi douce et profonde, si bien qu’il n’est pas question de la quitter. La nouvelle sexualité doit écouter le désir et le libérer de toute convention, pour aimer l’Une et l’Autre. Il y a bien quelques avertissements : notre héros moderne condamne évidemment la jalousie, issue, on ne le sait que trop, du sens de la propriété bourgeoise. Mais pourquoi alors torture-t-elle aussi bien la modernité ?
Il en va de même du mensonge auquel Éros est contraint. Sans doute, l’Une n’exige plus la vérité bourgeoise. Le mensonge entre modernes demeure par omission. Il n’en est pas moins honteux et Agapé le supporte mal. Mais que peut-il, déchiré entre Éros et Philia, leurs exigences et contradictions ? L’Une se doute-t-elle ? Sait-elle ? On ne l’apprendra qu’au moment où elle quittera le domicile conjugal par renoncement de la Philia. L’Autre, moderne elle aussi, n’exige rien, mais elle souffre et le fait savoir, cherche d’autres désirs, d’autres assouvissements. Éros est vindicatif, violent et bouscule Agapé. Il n’admet pas de n’être aimé qu’au lit ; de même Philia ne peut consentir à être aimée partout sauf là. Notre architecte a tout perdu ; comme le plus obsolète des Ringards, à vouloir « le beurre et l’argent du beurre » : « le cœur d’artichaut finit en poireau ». Dans une très belle scène, et un dernier et violent conflit, Éléonore quitte son amant et sans précaution traverse la rue. Non ! La voiture qui surgit ne la renverse pas ; elle la frôle seulement. La tragédie serait une issue que le romancier refuse. La difficulté d’aimer ne fait que la frôler pour démontrer qu’elle survit à la modernité et que son tourment se situe au-delà des mœurs et des pensées. Cette difficulté, Belinda Cannone, a fait mieux que l’analyser. Elle l’a représentée.
Jean BLOT
13.01.2015
Proust au téléphone
(pour Bénédicte et Jean-Pierre Liber)
On trouve, dans Le côté de Guermantes (vol. 1), l’un des plus beaux passages de la Recherche et, pour moi au moins de toute littérature. On pourrait l’intituler d’un nom emprunté à Proust et désignant une espèce hélas disparue : « les Demoiselles du téléphone ». Étant à Doncières auprès de Saint Loup, le narrateur, attendant un appel de sa grand-mère malade restée à Paris, s’irrite des lenteurs du service jusqu’au moment où il comprend son ingratitude envers le mystère des « forces sacrées », « l’admirable féérie », qui permettent à des êtres chers, « à des centaines de lieues », d’apparaître en un instant à notre oreille. Il suffit d’appeler « les Vierges Vigilantes,… Anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes ;… les ombrageuses prêtresses de l’Invisible, les Demoiselles du téléphone ! » Sans doute le miracle est ambigu. Sans doute, en nous faisant prévoir ce que seront la séparation et l’absence définitives, il peut donner à entendre « une voix qui reviendrait… murmurer » à « (l’) oreille des paroles… » que l’on aurait « voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière ». « Les Vierges Vigilantes » n’en gardent pas moins leur pouvoir ; « les forces sacrées », leur omniprésence ; « l’admirable féérie », son enchantement.
Il y a la beauté du texte : on l’a déjà saluée. Elle cache peut-être son originalité, la gravité de son propos, l’optimisme qui l’inspire. J’ai beau interrogé les trois ou quatre littératures que je connais, je ne parviens pas à me souvenir d’un texte comparable, par la qualité peut-être, par son sujet certainement : l’hommage à Technè (Tέχνη). Sans doute on trouvera sans peine des éloges de la vitesse, des hymnes à la voiture et à l’avion ou au bateau. Mais ils n’ont pas le même sujet : ils parlent des produits, non de la source ; des effets, non de la cause ; des résultats, non des « forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact », leur secret, leur nature. Où sont les éloges du dieu qui fait voir l’invisible, entendre l’inaudible, graver le son dans la cire, confier au vent l’image ─ et si rapide qu’elle est à l’autre bout du monde au moment même où elle surgit ?
Il me paraît qu’il y a là un manquement grave. La littérature est la science du sensible. Or, l’immense extension du sensible que la science nous a donné est singulièrement négligée et, de ce fait, abandonnée à une abstraction stérile. Chacun regarde la télévision mais nul, ou bien rare, qui s’interroge et ressent, comprend le miracle qui fait qu’il voit à distance, et ses conséquences pour la distance et ce qu’elles font de lui ; ce qu’ils ont fait de l’espace, du temps, mais aussi de notre contemporain et de son originalité dans l’histoire du genre humain.
Pourquoi cette surdité, pourquoi cet aveuglement de la littérature, ce refus de la déesse, humble mais si puissante : Technè ? Pourquoi refuser de se pencher, comme elle l’a fait pour les plaisirs de l’amour, la douceur des soirs, les ténèbres du deuil, sur la richesse que Technè apporte à la sensibilité ?
Proust évoque l’habitude, expliquant que, à force d’utiliser le téléphone, on ne remarque plus sa magie. Sans doute, mais il en est de même des plaisirs et des douleurs de la vie, et on ne cesse pourtant d’interroger nos plaisirs et nos douleurs. L’oubli des « Vierges Vigilantes », de leur magie, de leur poésie, trouve peut-être son explication dans l’angoisse qu’inspirent à l’homme ses propres œuvres. Il sait qu’il peut ajouter au Réel, mais il se refuse à reconnaître les conséquences. Qu’il y ait sorcellerie, il y consent, mais non d’être le sorcier. Que l’invisible s’offre au regard, l’inaudible à l’ouïe, l’ailleurs à là où je suis, hier et demain à aujourd’hui, il l’accepte en se détournant, en dénigrant et comme s’il n’y était pour rien. Vite un sorcier ! Vite un dieu qui lui ressemble car si je suis l’auteur du miracle, celui-ci change de nature. Il était un don. Il devient une œuvre. Je ne puis plus espérer qu’en moi-même, ce qui est une forme, vigoureuse, du désespoir ; je ne puis plus rien attendre sauf de moi-même, ce qui n’est pas attente mais exigence. Ce risque alimente les terreurs qu’inspire l’apprenti-sorcier avec la fin du monde lui pendant au nez.
Mais si l’Art n’accompagne pas la vie, refuse la Technè qui la bouleverse, il n’est plus qu’un jeu pour vieillards et Académies. Il lui faut chercher « les forces sacrées » là où elles se trouvent ; ni ailleurs, ni au-delà, mais bien ici ; une forme du temps qui n’est ni autrefois, ni demain, mais bien le secret du maintenant. Nous sommes au contact de ces forces. Toujours sur le point de les deviner, de les surprendre ─ sanglot de la pierre, explosion des soleils, incendie de la nuit ou labeur infini, infiniment caché, des atomes ─, de dévoiler le Réel dont le foyer magique palpite sous le rayon de l’esprit et le défie.
Il faut humaniser nos œuvres, sans quoi elles ne tarderont pas à nous faire peur et à paraître nos ennemis. Il faut établir, entre elles et la sensibilité, tous les liens que l’art a su tisser entre nos cœurs, nos âmes et la Nature pour faire du monde notre séjour. Technè ne nous condamne pas à une solitude que l’on fuit en refusant à ses œuvres nos consciences et sensibilité. « Les forces sacrées » de Proust sont l’objet même d’une recherche qui s’efforce de légitimer l’entendement, de lui conquérir et soumettre l’univers, mais aussi d’une quête morale qui fonde une raison que la raison ne connaît pas. Si l’art renie Technè, nous demeurerons coupés de nos œuvres et des objets qui peuplent nos vies.
Foi et Science sont deux formes d’une même recherche. Peut-être que Technè, par ses œuvres pareilles à des révélations ─ l’âge industriel devenant parousie ─ nous rapproche mieux, ou plus concrètement que la prière, du Grand Mystère. Elle inscrit ses lois dans le quotidien et, en retrouvant ses formes et mouvements, en leur prêtant la vertu d’utilité, la Technè consacre leur réalité et l’enrichit de nos rêves. Si, de l’imaginaire des bottes de sept lieues, on passe à la réalité de l’avion à réaction, c’est non par la négation du rêve, mais par son accomplissement et la manifestation de lois de la Nature qu’elle ne pouvait recevoir que de Dieu. Quant au fait que Technè emprunte autant à la foi qu’à la raison, il suffit d’évoquer les milliards que le contribuable accepte de payer sans rechigner, mais sans bien comprendre, aux entreprises consacrées à l’accélération et à la destruction de particules ou à la cueillette de pierres sur la surface de la lune. Quand bien même la Technè serait plus humble et sans leçon pour le mystère, il incombe à l’art de la servir et de lui donner cette intégration au monde de l’homme, à la sensibilité, à la vie qu’il peut accomplir. Quand bien même il est vain d’espérer qu’elle nous livre le secret de Dieu comme l’avion celui du vol, et nous le donne aussi concrètement qu’elle le fait de l’avion, Technè est dans le monde partout présente. Il la faut apprivoiser par le verbe et la poésie pour la rendre à la sensibilité.
Le peintre, il est vrai, a cherché l’alliance mais n’a pas su l’imposer. Elle demeure limitée. Je crois retrouver en la tour Eiffel ce chant venu d’ailleurs, message d’un monde secret, peut-être celui de la Technè, ces vibrations de l’Insolite que Delaunay lui a prêtées. La gare Saint Lazare, sous le pinceau de Monet, est devenue ce palais de fumées où danse un jeune acier et se prépare le voyage. On l’a confié aux petites locomotives trapues, solitaires, un feu rouge au front et qui s’apprêtent à se lancer dans la nuit avec, pour seul compagnon, le chant sous leurs roues et une clameur dans leur vitesse. Monet les a inscrites dans la réalité que reconnaît la sensibilité. Elles ne sont pas utiles. Elles sont dans leur être et dans nos existences. De même ces voiles et ces mâts peints pour le vent, qui titubent sur les tuiles vert et or du toit marin. Ou bien les tempêtes de Turner brisant nos vaisseaux dans la furie des couleurs déchaînées, l’avion de Villon perdu dans le tourbillon de ses hélices. Et en littérature : les Demoiselles du téléphone.
C’est peu.
Toute recherche est recherche de Dieu. J’entends par là que toutes, quel que soit le chemin qu’elles empruntent, ont même origine et poursuivent, le plus souvent en aveugle, un même but. Doit-on rappeler que ce n’est pas seulement Newton, mais Einstein qui, dans ses travaux, croyait marcher à la rencontre d’un Esprit supérieur qu’il n’hésitait pas à appeler Dieu. Les œuvres de Technè manifestent, illustrent, imposent au concret, aux sens, au vif de l’existence, les lois de la Nature, comme celles-ci témoignent d’un Esprit supérieur que l’on a appris à appeler Dieu. Faut-il choisir : la prière ou la NASA ? Peu importe si l’on a compris qu’elles sont jumelles. C’est peut-être dans la découverte d’un miraculeux électron que Dieu nous attend dans toute sa gloire.
’ailleurs, l’au-delà, l’impossible ne sont que les noms de notre ignorance ou, pire, de notre insensibilité. Pareilles aux voix dans le silence qu’interroge le téléphone, elles sont prêtes à s’épanouir pourvu que l’on trouve leur longueur d’onde, cette patience et cette humilité de l’esprit que l’on nomme science, mais accompagnée par la sensibilité qui lui donne la présence et la traduit en termes de vie. Il faut sentir, explorer, nommer ce mirage dans lequel nous vivons, issu des rêves un peu fous de nos ancêtres, où j’entends et vois l’absent, et l’ailleurs, vais plus vite que le son et où m’accompagne, plus fidèle et discrète qu’une ombre, la lumière de la connaissance. Fidèle aux doigts sur le clavier de l’ordinateur, elle viendra éclairer les conduites d’un empereur du passé, me lire la santé des étoiles, me rappeler la date anniversaire de ma bien aimée ou le vers du poète que je viens d’oublier.
Pour accueillir Technè, la littérature dispose d’un outil puissant : la métaphore. Par sa magie, l’inconnu devient intime. Entre la perle, la larme, la vague chevauchant l’océan, la goutte de pluie hésitant au bord d’une feuille, captive d’un rayon endormi, il est une parenté que le sentiment devine et qui forme le tissu du monde. L’association enrichit chacun des éléments associés. Par la vague, la pluie, la perle, je sais mieux ce qu’est la larme, mais aussi j’entrevois ce qu’elles ont en commun et le sens de leur présence dans le chaos de ce qui est. Les Demoiselles du téléphone ne sont plus. D’autres fées plus subtiles, plus puissantes encore, les ont remplacées. Elles ne se trouvaient ni dans les fables, ni dans l’imagination, ni dans l’enfance, mais bien au sommet de la clairvoyance et de la maturité : Technè. Elles nous guident vers l’énigme ardente qui est là, devant nous, ici et maintenant. Elle garde accessible le secret du monde.
Et de chacun.
Jean BLOT
Le vingtième siècle fut un siècle de grande poésie en Russie. Il fut dominé par deux femmes, Anna Akhmatova et Marina Tsvetaieva. Si la première sut incarner, peut-être, une dernière fois, l’Éternel féminin, la seconde donnait déjà la parole à un nouveau venu en littérature dont on pouvait tout attendre : la femme moderne. Le poème dédié à Stenka Razine, ‒ Ataman cosaque, chef de l’une des grandes jacqueries du XVIIIe siècle, personnage dont la légende est promue par la chanson populaire où on le voit jeter, pour sauvegarder sa virilité, sa princesse persane dans la Volga ‒ illustre cette nouvelle voix féminine.
Jean Blot
*
Stenka Razine
par Marina Tsvetaieva
(traduction de Lena Tsvetkov et Jean Blot)
1
Dans le crépuscule d’or, les vents sont endormis.
La nuit s’avance telle une montagne de pierre
Le fol Atamane prend du repos
Auprès de la princesse des pays chauds.
Il serre dans ses bras les jeunes épaules
Et se perd, la tête renversée
Dans le chant des rossignols
Chantant au-dessus des tentes surchauffées.
2
Sur la Volga, règne la nuit.
Sur la Volga, règne le songe.
Pour l’Atamane et sa princesse persane
Aux noirs sourcils, on a étendu les tapis les plus riches.
On n’entend pas la vague.
On ne voit point l’étoile.
Rien que les rames dans la nuit
Emportant l’Atamane et sa princesse
Pareille à un péché dans l’âme.
Et la nuit entendit murmurer :
« Oh ! viens te coucher plus près.
Parmi nos femmes tu es la perle.
Te ferais-je peur ? Ma prisonnière, ma persane
Je suis ton esclave à jamais. »
Elle a froncé son beau sourcil
Ses sourcils si longs, si longs.
Baissé ses yeux de Persane.
Entre ses lèvres, un seul soupir
Un seul mot : « Djal Eddin »*.
Sur la Volga, l’aube s’est levée.
Vers la Volga, le paradis s’est avancé.
Avinés, ses compagnons lui crient :
« Debout, Atamane !
Tu n’as que trop traîné
Auprès de ta chienne musulmane !
Ne vois-tu pas ses yeux en pleurs,
Sa bouche mordue jusqu’au sang.
Elle se tait comme morte ! »
Les sourcils de l’Atamane sont froncés.
« Tu as refusé ma couche ! Païenne !
Que le fleuve soit ton bénitier.
Si le ciel est clarté
Les fonds des eaux sont ténèbres
Sur la proue n’est resté,
Rouge, qu’un petit soulier.
Comme un chêne menaçant
Blême jusqu’aux lèvres, Stepan
Titube chancelle. « Aidez-moi ! »
Renégats, mes yeux s’assombrissent !
C’est la fin, ma petite persane,
La fin, ma prisonnière.
*Va-t’en
3
Le Songe de Razine
Stepan rêve :
Là où pleure, le héron des marais
On entend une eau qui clapote
Des gouttes d’argent au fond des eaux
Font de l’abîme un tapis en pleurs.
Stepan rêve d’un visage oublié
Aux sourcils si noirs et beaux.
Elle est assise au fond des eaux
Telle la Sainte Vierge ; entre ses doigts
Filent les perles.
Stepan veut lui parler
Mais seules ses lèvres bougent
Son souffle coupé comme par des éclats de verre.
Le long d’un mur transparent
Il veille en sentinelle assoupie.
Elle lui dit : « Eh toi, gabier !
Pourquoi m’as-tu abandonnée ?
Avec un seul de mes souliers
Qui voudra de ma beauté
Si pauvrement chaussée.
Je reviendrai mon bel ami
Te réclamer mon petit soulier… »
Et tintent, tintent, tintent les bracelets.
Le bonheur de Stepan s’est noyé.
Demain l’Occident
par Édouard Valdman
(Éditions L’Harmattan)
Édouard Valdman est un penseur et un poète. Tantôt celui-ci prête ses ailes à celui-là. Tantôt il l’emporte vers des horizons où ce lecteur au moins ne peut le suivre. C’est ainsi que, récemment, par le détour d’un sacré auquel on aimerait tout de même demander ses pièces d’identité, il fait de minuit le fils légitime de midi et montre comment les Lumières conduisent aux ténèbres de la Shoa. Convaincu que celle-ci a pour origine l’obscurantisme chrétien du Chrysostome qui, à travers dix-neuf siècles de pogroms, de persécutions, d’autodafés, de noyades en guise de baptêmes, devait logiquement aboutir à la solution finale, je ne saurais le suivre.
Mieux vaut revenir au livre précédent, Demain l’Occident. On y trouve un scrupule et une gravité de bon aloi. Les analyses y sont fines et hardies toujours, mais sans provocation. Les analyses de Valdman rejoignent les nôtres (et de beaucoup d’autres) sur la triple origine de l’Occident et de sa civilisation. Il expose des menaces pesant sur les valeurs qui faisaient son originalité, le danger des médias, de la crise d’autorité. Cette critique de la société de consommation est généralement acceptée dans le pays au niveau de vie enviable. Mais il est rare ─ et beau ─ de conclure, comme le fait Valdman, que ce qui se cache « derrière la course effrénée au progrès et à l’argent » est « une soif d’absolu ».
On adhère volontiers à l’analyse de l’histoire qui reconnaît au judaïsme les perspectives messianiques constitutives de l’Occident, à Athènes, la formation de l’individu et de son esprit, à Rome, la création d’une conscience collective et d’une société créatrice du Droit, soumise à ses règles.
On suit encore le penseur quand il précise que ce sont ces trois sources qu’il convient de retrouver pour donner un nouveau souffle à une civilisation qui ne trouvera pas ailleurs un moteur, un projet, une lumière. On salue volontiers, et avec gratitude, l’importance accordée, à la suite de Buber, Gabriel Marcel, Levinas, à l’Autre et au rôle de l’altérité dans le succès de l’Occident. L’Homme ?
« Il est né à Athènes… Rome lui a donné le sens du droit et celui de l’État. » Jérusalem lui aura donné « le sens de l’altérité et de la sainteté ». L’analyse du Judaïsme est pleine d’intérêt même si le plus remarquable n’est pas que les Juifs ─ comme tant d’autres ─ aient perdu leur État mais bien qu’ils aient survécu à cette perte.
J’avoue ne pas partager l’enthousiasme de Valdman pour la Repentance catholique. Après les noyades du Tage, les autodafés de Nuremberg, les pogroms polonais, il me paraît un peu léger pour le catholicisme de se repentir de n’avoir pas condamné les lois antisémites de Vichy à l’époque de la Shoa ─ où, curieusement, elle ne se reproche rien. Valdman affirme que cette Repentance annonce une ère nouvelle, le temps de la Réconciliation. On ne demande qu’à le croire. On doit le remercier pour l’analyse qui conduit à cette bonne nouvelle. On préfère pourtant placer notre espérance en les Lumières et la Raison plutôt que ressusciter un Sacré dont le mystère même fait que l’on peut tout en craindre.
Jean BLOT
17.04.2015
Au lieu du péril
par Luba JURGENSON
(Éditions Verdier)
Dès Avoir sommeil, paru en 1981, Luba Jurgenson avait su imposer une personnalité discrète, mais lucide et assurée, où, sous une douceur de conte de fée, une intelligence redoutable se cachait. On la croyait distraite, un peu absente et elle revenait soudain pour frapper dur et juste. On nous dit de l’auteur qu’il est « écrivain, traductrice et universitaire ». Dans Au lieu du péril, c’est la traductrice qui paraît avoir le premier rôle.
Il s’agit bien d’une biographie, mais elle n’est pas à la recherche des événements qui ont composé la personnalité, mais de son noyau dur, de son essence, de ce en quoi et pourquoi elle forme une unité distincte, autonome, libre et, pour l’auteur, d’une grande séduction et d’un pouvoir créateur évident. Que le lecteur évite la quatrième de couverture qui lui enseigne que le bilinguisme révèle « les indices corporels du décentrement ». C’est défaut d’universitaire qui confie à la grosse caisse ce qui appartient au plus discret des échos. Dès que l’écrivain revient à soi, aux récits, anecdotes, situations, il montre avec autant de sensibilité que d’intelligence la mobilité de la personnalité du bilingue, du polyglotte et comment elle change, presque physiquement, selon la langue qu’elle parle. Celle-ci paraît la dominer et la conduire, jouir de volonté et d’autonomie.
L’expérience de l’auteur est originale. Elle ne parvient à gagner la France qu’à vingt ans et c’est alors qu’elle décide de faire du français sa « langue maternelle ». Elle se heurte à une émigration antérieure, à ses enfants (dont je suis) qui refusent de reconnaître ces « Soviétiques » dont l’accent, les manières, l’expérience leur rappellent le cauchemar auquel ils ont échappé. Jurgenson décrit bien l’épreuve du retour à Moscou, une Française, mais reprise par la langue qui lui parle de ses origines. Elle lui enseigne que la pauvreté du russe pour désigner les objets quotidiens révèle, au-delà d’un désintérêt pour le monde matériel, une « réduction de la vie au cru et au cuit » qui la menace de barbarie. Traductrice autant qu’écrivain (elle est l’auteur d’une magistrale traduction de l’énorme Oblomov de Gontcharov), Jurgenson joue avec les mots comme avec des animaux familiers, avertie de leur caprice, de leur imprévisibilité. Elle consacre de merveilleuses analyses au « e » muet, au masculin et féminin, à la langue des rêves, au « rêveur de la langue », à ce qu’elle nomme « la voix off » qui parle sans qu’on le lui demande et que l’on puisse prévoir la langue qu’elle choisira. Et, surtout, au diminutif. On croisera quelques formules énigmatiques enseignant que « la langue se sert de nous pour évoluer » ou que « accentuer l’avant-dernière syllabe, c’est prévenir la mort ». Elles paraissent issues d’un terrorisme mystique lové dans des théories de la littérature qui se succédaient naguère en empire soviétique, et dont le prestige était grand par le martyr de leurs protagonistes. On leur doit, semble-t-il, d’étonnantes révélations. Aveugle, je n’y vois que l’illustration du proverbe russe qui assure que la langue n’a pas d’os et que, en conséquence, on peut dire n’importe quoi. Je me trompe peut-être, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’elles sont les ennemis mortels de cette spontanéité, de cette fraîcheur, de cette intelligence tendre et malicieuse qui fait la valeur de la prose de Luba Jurgenson.
Jean BLOT
13/1/2015
Double exil (Éd. Verdier) par Yannis KIOURTSAKIS
ou « À la recherche du Nous perdu »
Le livre est grave : « À la recherche du NOUS perdu », non pas un passé personnel qui donnerait un sens à l’existence, mais un NOUS qui précède le Moi, une âme collective antérieure à la séparation qui condamne à l’exil. Ce NOUS que Kiourtsakis cherche avec une obstination quasi maniaque à travers des expériences concrètes, il le retrouve enfin dans une vieille chanson populaire, le geste d’un marin, le mot d’un berger. Ce sont là les dernières voix qui peuvent parvenir jusqu’à nous de ce NOUS que nous avons perdu et qui est au secret de la recherche entreprise.
J’ai toujours pensé que la force d’un auteur venait des contradictions qui l’habitent. Kiourtsakis est partagé entre une douceur de nature et un acharnement quasi obsessionnel à trouver ce qu’il cherche. C’est avec cette douceur de nature qu’il apprivoise les expériences qu’il a projeté de percer à jour. C »est par cette obstination qu’il y parvient. Doux par nature, Kiourtsakis est aussi solitaire par nature. Mais, à cette belle solitude s’oppose en lui un observateur passionné et peut-être que celle-là est au service de celui-ci. C’est par l’observation intense de notre exil qu’il entend, et parvient, à retrouver notre patrie. Il est pourtant un autre élément dans ce livre qui, pour moi, demeure le plus cher : c’est l’amour. L’amour de Kiourtsakis est un amour pur, aussi loin des passions meurtrières de Tristan et Iseult ou de Roméo et Juliette que du mariage fécond que promet et exige le judéo-christianisme. Un amour qui aboutit au couple ─ et à ceci que Gisèle (la femme de l’auteur), qui n’est décrite nulle part ou très peu, est le personnage le mieux dessiné, le plus vivant, le plus immédiatement perceptible du roman.
Elle n’est en scène que rarement, mais dans les coulisses elle est toujours présente. Elle parle assez peu, mais on l’entend en sourdine partout. Et cet amour aboutit à une scène de balcon la plus émouvante et la plus drôle que je connaisse. Scènes de balcon : Roméo et Juliette, Don Juan et Elvire, mais il s’y mêle ici une folle jeunesse, une tendresse que je ne connais dans aucune des scènes de balcon de quatre ou cinq littératures que j’ai un peu fréquentées. Et c’est ainsi que le Double exil se transforme en une double patrie, celle du NOUS et de l’amour qui y conduit.
Jean BLOT
29.1.2014


Laisser un commentaire