LA DÉDICACE
OLIVIER POIVRE D'ARVOR
Sur ce rocher sublime qu’Achille a honoré de son nom, où Thésée a disparu et où repose dans un décor de petits chevaux sauvages le poète anglais Rupert Brooke, il est un miracle qui ne se découvre que difficilement. Le courage ne manque cependant pas à l’amoureux de Skyros, habitué à suivre la trace de la chèvre là où il ne semble pas qu’un chemin puisse passer, entre ronces et caillasse, entre ronces et ronces, avec un regard un peu effrayé pour la carcasse rongée tout en bas de celle-là, sortie du troupeau, dont le sabot a glissé. L’œil ne fait pas défaut, non plus, qui distingue au loin la faible traînée de la piste parmi les pierres rouges et la poussière en lévitation permanente ; le corps est exercé, il saura non seulement grimper le long de la falaise mais, plus difficile, ne jamais redescendre trop bas, sous peine d’être condamné au grand saut dans le vide.
Il est une chapelle qui contredit l’idée que l’on se fait ordinairement des chapelles de l’île de Skyros.
De ces chapelles, où l’on n’accède qu’après de longues marches, écrasé de soleil et de lumière et la cheville ensanglantée ; de ces chapelles à flancs de collines; à califourchon sur la montagne; visibles de la seule mer; blotties dans la main verte d’une source haute; creusées à même la pierre et s’habillant de salpêtre; perdues dans la pinède et faisant de l’ombre à l’eau déjà fraîche d’un puits miraculeux.
L’île est ainsi balisée, constellée. Petits oratoires, cailloux blanchis à la chaux une fois l’an, histoire d’habiller de neuf, quand vient sa fête, le saint consacré. Les chapelles gardent, longtemps après ce jour, les odeurs et la mémoire un peu tourmentée de ces antiques agapes : le sacrifice y a été renouvelé, l’encens a brûlé et l’huile est encore tiède, le vin a coulé largement, tachant les vieux bancs en bois tout râpeux. Un peu de viande grillée au bout des broches. Le feu est éteint, le pain consommé, les bergers sont étourdis, le pope est ailleurs, les femmes sont déjà descendues. Elles remonteront, plus tard, pour ranger. Le festin d’Ulysse a pris fin et la chapelle retourne à son silence.
Ces chapelles-là sont légion. Elles appartiennent à une famille et font autant penser à une bergerie qu’à un sanctuaire. Les animaux de la crèche broutent à proximité et frappent à la porte. Le saint y est sans cérémonie, sans érudition. Un bidon d’huile, des petits morceaux de charbon, les images naïves comme des bons points, des mèches lissées de cire, des pièces et des billets graisseux sur la table d’offrande, un petit fatras chirurgical qui impressionne toujours le profane : la cuisine de Dieu, ses pinces, ses petites casseroles, sa verroterie et les soucoupes de cuivre avec les cristaux qu’on prend de loin pour du sucre candi. Dans le sable où sont plantés les cierges, la cire a fondu et la main retire au fond des bacs ces concrétions, pareilles à des coquillages enfouis par la marée. Le miracle n’est pas dans ces édifices qu’il faut souvent mériter avant de les atteindre. Les cartes les recensent mais les cartes de Skyros sont anciennes. Il faudra attendre une nouvelle édition pour que le miracle soit consigné. Le miracle est en contrebas. En bord de mer.
C’est chose rare de découvrir à Skyros une chapelle ainsi placée au bord de la mer – elle lui fait le dos rond, il est vrai -, plus rare encore de devoir descendre pour s’y recueillir. J’ai connu le site quand il n’était que herbes et roseaux, au bout de ce chemin qui serpente un peu pour ne pas se déverser trop vite dans la Méditerranée. J’ai connu la maison, seule ; c’était déjà très beau.
Puis vint la chapelle : un don singulier, n’est-ce pas ? On ne construit plus guère d’édifice religieux, de notre temps. Des pierres, un plan inspiré par l’une de ces promenades à la recherche des grands sœurs chapelles de l’île, un habile maçon, la chaux par-dessus tout. Alors que l’époque est à l’immatériel, et que la maison ne connaissait de lumière que la clarté du jour ou l’enivrante lueur de la lampe à pétrole, cette construction était une vivante dédicace.
C’est ainsi qu’elle m’est apparue à moi, l’élève des Jésuites, cette chapelle orthodoxe. Je dormais non loin mais avant le sommeil, elle me semblait, avec son sol rouge sang, un passage obligé. Foi du charbonnier : j’aimais faire grésiller l’encens et en partage d’un vœu, j’allumais un cierge pour traverser la nuit. Premier été : je ne me souviens que de ma surprise face à cette petite maison de Dieu et d’un livre que j’avais feuilleté à mon retour en France pour mieux comprendre. On y parlait des Iconoclastes, du Christ Pantocrator et de la chute de l’Église chrétienne d’Orient et de la prise de Constantinople par les Turcs. Pour un pur produit de l’Ouest catholique, cet Est-là, si orthodoxe, était encore à découvrir. Tant de mystères et d’ombres sur ces murs blancs. Le bruit de la mer, juste à côté, m’avait, il est vrai, rassuré.
Je ne suis pas venu à Skyros pendant quatre ou cinq ans. Suis retourné un jour, traversant les roseaux pour gagner la maison, en me réservant la chapelle pour plus tard. Je savais à quoi m’attendre, ou plutôt je savais qu’un livre d’images allait s’y dévoiler, le long des murs, j’en avais entendu parler, je savais que la chapelle était devenue une œuvre.
La peinture, technique préférée des artistes byzantins, a donné quelques chefs-d’œuvre à la gloire des Alexandre. Alexandre, l’empereur du x• siècle, dont on découvre le portrait magnifique à Sainte-Sophie; Alexandre montant au ciel. La peinture religieuse murale, d’après ce que j’en sais, a cependant privilégié d’autres figures : ma préférence, comme celle de beaucoup d’autres, va aux Miracles du Christ de l’église de la Vierge Péribleptos à Mistra, autrement dit l’ancienne Sparte. Mais ce qui me frappe et me frappa dans cet art byzantin, en découvrant les fresques de la chapelle de Nadia Blokh, c’est la continuité extraordinaire : six siècles plus tard, on retrouve les mêmes qualités techniques, esthétiques et religieuses dans cette simple chapelle que dans les élégantes églises de la capitale de la Morée. Tout comme la géographie artistique de Byzance s’est largement affranchie de la géographie poli tique, l’histoire de cet art s’est bien gardée de suivre les péripéties et les éclipses du pouvoir byzantin : et si l’on ne peint plus dans nos églises romaines comme on peignait au temps de la Renaissance, on peut encore, et la chapelle de Skyros en est un témoignage, peindre avec les mêmes ingrédients et la même conscience du monde qu’à la glorieuse époque de Constantinople.
Pour moi, cette chapelle est un livre ouvert que j’aime à feuilleter dès que j’y pénètre, un manuscrit magnifiquement et simplement illustré, le psautier de l’amour. J’en aime les figures annonciatrices, la Résurrection et tous ces détails qui font la richesse de cette lecture : souliers qu’on délace, buissons ardents, ailes, anges qui sont comme des mouettes ou d’autres qui portent des livres rouges, rideau que l’on tire, tête couron née, auréolée, tête ancienne, inachevée, rêveuse. Et ces bleus, ces jaunes, ces rouges, ces couleurs qui entretiennent un feu permanent dans la chapelle.
Ce qui me frappe encore, comme dans la plupart des œuvres byzan tines, c’est que ce livre semble totalement indifférent aux choses ordinaires de ce monde, qu’il est insensible aux mouvements de l’histoire et qu’à la différence de l’art occidental, le signe compte plus que la représentation. Pourtant, l’anonymat de la dédicace est vite levé : je garde de mes étés de Skyros cette image belle et forte, une image qui m’accompagne dans l’hiver de Londres : cette femme en blouse blanche, de dos, en bas, face au chevalet et à l’escabeau, cette femme qui peint. C’est l’histoire du monde, l’histoire de ce don que l’homme fait à la femme d’une maison pour y célébrer la divinité, l’histoire de ces pierres blanches et nues que l’homme entasse et dont il espère que la femme saura les disposer mieux, les habiller, les habiter plutôt. C’est la femme qui crée l’amour : voilà la dédicace dernière, celle de l’artiste Nadia Blokh, une dédicace à taille humaine et à portée divine.
Il est une chapelle qui contredit l’idée que l’on se fait ordinairement des chapelles de l’île de Skyros.
De ces chapelles, où l’on n’accède qu’après de longues marches, écrasé de soleil et de lumière et la cheville ensanglantée ; de ces chapelles à flancs de collines; à califourchon sur la montagne; visibles de la seule mer; blotties dans la main verte d’une source haute; creusées à même la pierre et s’habillant de salpêtre; perdues dans la pinède et faisant de l’ombre à l’eau déjà fraîche d’un puits miraculeux.
L’île est ainsi balisée, constellée. Petits oratoires, cailloux blanchis à la chaux une fois l’an, histoire d’habiller de neuf, quand vient sa fête, le saint consacré. Les chapelles gardent, longtemps après ce jour, les odeurs et la mémoire un peu tourmentée de ces antiques agapes : le sacrifice y a été renouvelé, l’encens a brûlé et l’huile est encore tiède, le vin a coulé largement, tachant les vieux bancs en bois tout râpeux. Un peu de viande grillée au bout des broches. Le feu est éteint, le pain consommé, les bergers sont étourdis, le pope est ailleurs, les femmes sont déjà descendues. Elles remonteront, plus tard, pour ranger. Le festin d’Ulysse a pris fin et la chapelle retourne à son silence.
Ces chapelles-là sont légion. Elles appartiennent à une famille et font autant penser à une bergerie qu’à un sanctuaire. Les animaux de la crèche broutent à proximité et frappent à la porte. Le saint y est sans cérémonie, sans érudition. Un bidon d’huile, des petits morceaux de charbon, les images naïves comme des bons points, des mèches lissées de cire, des pièces et des billets graisseux sur la table d’offrande, un petit fatras chirurgical qui impressionne toujours le profane : la cuisine de Dieu, ses pinces, ses petites casseroles, sa verroterie et les soucoupes de cuivre avec les cristaux qu’on prend de loin pour du sucre candi. Dans le sable où sont plantés les cierges, la cire a fondu et la main retire au fond des bacs ces concrétions, pareilles à des coquillages enfouis par la marée. Le miracle n’est pas dans ces édifices qu’il faut souvent mériter avant de les atteindre. Les cartes les recensent mais les cartes de Skyros sont anciennes. Il faudra attendre une nouvelle édition pour que le miracle soit consigné. Le miracle est en contrebas. En bord de mer.
C’est chose rare de découvrir à Skyros une chapelle ainsi placée au bord de la mer – elle lui fait le dos rond, il est vrai -, plus rare encore de devoir descendre pour s’y recueillir. J’ai connu le site quand il n’était que herbes et roseaux, au bout de ce chemin qui serpente un peu pour ne pas se déverser trop vite dans la Méditerranée. J’ai connu la maison, seule ; c’était déjà très beau.
Puis vint la chapelle : un don singulier, n’est-ce pas ? On ne construit plus guère d’édifice religieux, de notre temps. Des pierres, un plan inspiré par l’une de ces promenades à la recherche des grands sœurs chapelles de l’île, un habile maçon, la chaux par-dessus tout. Alors que l’époque est à l’immatériel, et que la maison ne connaissait de lumière que la clarté du jour ou l’enivrante lueur de la lampe à pétrole, cette construction était une vivante dédicace.
C’est ainsi qu’elle m’est apparue à moi, l’élève des Jésuites, cette chapelle orthodoxe. Je dormais non loin mais avant le sommeil, elle me semblait, avec son sol rouge sang, un passage obligé. Foi du charbonnier : j’aimais faire grésiller l’encens et en partage d’un vœu, j’allumais un cierge pour traverser la nuit. Premier été : je ne me souviens que de ma surprise face à cette petite maison de Dieu et d’un livre que j’avais feuilleté à mon retour en France pour mieux comprendre. On y parlait des Iconoclastes, du Christ Pantocrator et de la chute de l’Église chrétienne d’Orient et de la prise de Constantinople par les Turcs. Pour un pur produit de l’Ouest catholique, cet Est-là, si orthodoxe, était encore à découvrir. Tant de mystères et d’ombres sur ces murs blancs. Le bruit de la mer, juste à côté, m’avait, il est vrai, rassuré.
Je ne suis pas venu à Skyros pendant quatre ou cinq ans. Suis retourné un jour, traversant les roseaux pour gagner la maison, en me réservant la chapelle pour plus tard. Je savais à quoi m’attendre, ou plutôt je savais qu’un livre d’images allait s’y dévoiler, le long des murs, j’en avais entendu parler, je savais que la chapelle était devenue une œuvre.
La peinture, technique préférée des artistes byzantins, a donné quelques chefs-d’œuvre à la gloire des Alexandre. Alexandre, l’empereur du x• siècle, dont on découvre le portrait magnifique à Sainte-Sophie; Alexandre montant au ciel. La peinture religieuse murale, d’après ce que j’en sais, a cependant privilégié d’autres figures : ma préférence, comme celle de beaucoup d’autres, va aux Miracles du Christ de l’église de la Vierge Péribleptos à Mistra, autrement dit l’ancienne Sparte. Mais ce qui me frappe et me frappa dans cet art byzantin, en découvrant les fresques de la chapelle de Nadia Blokh, c’est la continuité extraordinaire : six siècles plus tard, on retrouve les mêmes qualités techniques, esthétiques et religieuses dans cette simple chapelle que dans les élégantes églises de la capitale de la Morée. Tout comme la géographie artistique de Byzance s’est largement affranchie de la géographie poli tique, l’histoire de cet art s’est bien gardée de suivre les péripéties et les éclipses du pouvoir byzantin : et si l’on ne peint plus dans nos églises romaines comme on peignait au temps de la Renaissance, on peut encore, et la chapelle de Skyros en est un témoignage, peindre avec les mêmes ingrédients et la même conscience du monde qu’à la glorieuse époque de Constantinople.
Pour moi, cette chapelle est un livre ouvert que j’aime à feuilleter dès que j’y pénètre, un manuscrit magnifiquement et simplement illustré, le psautier de l’amour. J’en aime les figures annonciatrices, la Résurrection et tous ces détails qui font la richesse de cette lecture : souliers qu’on délace, buissons ardents, ailes, anges qui sont comme des mouettes ou d’autres qui portent des livres rouges, rideau que l’on tire, tête couron née, auréolée, tête ancienne, inachevée, rêveuse. Et ces bleus, ces jaunes, ces rouges, ces couleurs qui entretiennent un feu permanent dans la chapelle.
Ce qui me frappe encore, comme dans la plupart des œuvres byzan tines, c’est que ce livre semble totalement indifférent aux choses ordinaires de ce monde, qu’il est insensible aux mouvements de l’histoire et qu’à la différence de l’art occidental, le signe compte plus que la représentation. Pourtant, l’anonymat de la dédicace est vite levé : je garde de mes étés de Skyros cette image belle et forte, une image qui m’accompagne dans l’hiver de Londres : cette femme en blouse blanche, de dos, en bas, face au chevalet et à l’escabeau, cette femme qui peint. C’est l’histoire du monde, l’histoire de ce don que l’homme fait à la femme d’une maison pour y célébrer la divinité, l’histoire de ces pierres blanches et nues que l’homme entasse et dont il espère que la femme saura les disposer mieux, les habiller, les habiter plutôt. C’est la femme qui crée l’amour : voilà la dédicace dernière, celle de l’artiste Nadia Blokh, une dédicace à taille humaine et à portée divine.


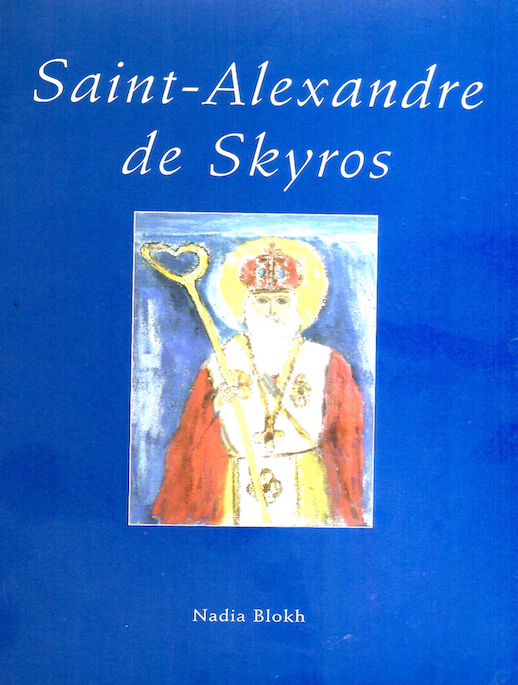



Laisser un commentaire